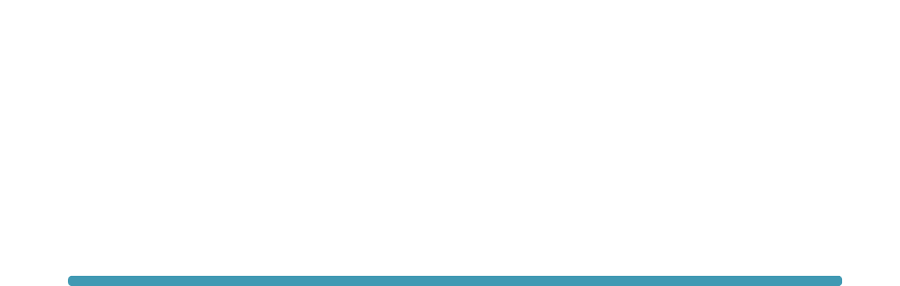Sillonner une année entière de droit public en seulement quelques pages, voilà un exercice bien irréaliste tant il est ambitieux ! On ne saurait en livrer qu’une vue partielle, en dresser qu’un exposé laconique, tout ceci au prisme d’une forte subjectivité collective. Vingt actualités – riches et bigarrées – ont été retenues dans cette présentation : de l’Open Data à la liberté de manifester, du délai raisonnable à la réforme de la fonction publique, des fichiers biométriques au référendum d’initiative partagée, des expérimentations à la conservation des données, etc. Si le tableau est inévitablement parcellaire, le panorama offre déjà de beaux points de vue.
I. Institutions
A. La commune-communauté
Source : Loi n° 2019-809 du 1er août 2019 visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires.
Votée au 1er août 2019, la loi « Gatel » modifie l’article L. 2113-9 du Code général des collectivités territoriales pour instaurer un nouveau choix de régime juridique relatif à la formation des communes nouvelles. Pour rappel, la commune nouvelle est un dispositif issu de la loi du 16 décembre 2010 (n° 2010 ‑1563) permettant la fusion de communes contigües qui devaient, une fois fusionnées, se rattacher à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Or la présente loi autorise les communes nouvelles à se passer du rattachement à un EPCI en s’attribuant leurs prérogatives mais aussi leurs obligations légales. Les communes nouvelles peuvent désormais cumuler les compétences de la commune et de la communauté et former une « commune-communauté » isolée au régime juridique hybride. Le choix de rattacher la commune nouvelle à un EPCI ou bien de choisir ce nouveau régime doit être déterminé lors de son projet de création par délibération des communes à son initiative, et être soumis au contrôle du représentant de l’État dans le département.
La loi « Gatel » a deux ambitions. Il s’agit d’abord de faciliter et rendre plus attractif la formation de communes nouvelles en préservant l’ensemble des compétences des acteurs locaux à son initiative. La loi ambitionne aussi de donner de nouvelles marges de manœuvre aux acteurs locaux pour adapter l’organisation territoriale aux spécificités locales. La réforme crée cependant une nouvelle complexification au fameux mille-feuille territorial pouvant éloigner davantage le citoyen de l’intelligibilité de l’organisation des collectivités territoriales et des répartitions des compétences. La loi s’inscrit donc dans un objectif global de réduction du nombre de communes, un objectif qui doit cependant être interrogé. En effet, si des intérêts économiques et structurels existent pour justifier cette réduction, le rôle et l’intérêt démocratique que possède l’institution communale par sa proximité avec le citoyen doivent être pris en compte. Quoi qu’il en soit, les communes nouvelles soumises à ce statut serviront de laboratoire aux autorités publiques pour observer les transformations de l’institution communale et étudier son basculement vers l’échelle supérieure que constituent les EPCI. Cela ne peut qu’être bénéfique pour déterminer au mieux les futures réformes territoriales.
B. Une loi pour l’engagement citoyen
Source : Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.
Donner un nouveau souffle à l’engagement citoyen dans la vie politique locale, il s’agit bien là de l’ambition portée par la loi du 27 décembre 2019. Pour parvenir à cet objectif, le législateur souhaite revaloriser la fonction d’élu local et mise sur son attractivité. Sa stratégie repose sur deux axes-clefs qui s’articulent dans les 118 articles présents dans la loi. Le premier axe recherche l’amélioration des conditions entourant la fonction d’élu local. Dans le détail, on peut relever la mise en place de congés de dix jours pour les candidats en campagne, de nouveaux avantages pécuniaires liés à l’exercice des fonctions électives, ainsi que l’amélioration de leur protection juridique et de leur accès à la formation. Le second axe s’intéresse au renforcement du pouvoir des élus. La loi procède d’abord à un renforcement externe des pouvoirs de la commune par la revalorisation de sa place au sein des EPCI et à l’octroi de nouvelles marges de manœuvre quant au choix de son organisation locale. Puis elle renforce les pouvoirs internes de la commune en élargissant le pouvoir d’astreinte du maire dans le cadre de ses missions de police. Le maire peut désormais agir plus efficacement en usant du pouvoir d’astreinte en cas de non‑respect de la fermeture d’un établissement recevant du public ou pour lutter contre les constructions irrégulières.
Si la stratégie choisie par le législateur s’entend, son efficacité doit encore être démontrée. La loi ne répond pas à de nombreux enjeux expliquant les crises qui parcourent l’institution communale et l’engagement citoyen. Notamment les difficultés d’ordre budgétaire et administratif qui sont vectrices de frustrations pour les acteurs locaux. Enfin, le désamour des citoyens pour l’engagement local possède des sources culturelles et conjoncturelles liées aux actuelles tensions sociétales auxquelles la loi ne saurait répondre. Si l’on peut s’interroger sur la capacité de cette loi à réaliser ses ambitions, ces nouvelles mesures restent des avancées au profit de l’institution communale et un signal positif participant à l’apaisement des relations entre les maires et l’État.
C. Un cadre juridique pour l’Open Data des décisions de justice
Source : Projet de décret relatif à la mise à disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives du 13 décembre 2019.
Si le principe de mise à disposition des décisions de justice en ligne existe depuis l’adoption de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, son application n’est pas encore effective. En effet, les exigences relatives à la protection de la vie privée des personnes et des données personnelles constituent des obstacles majeurs à la mise en œuvre de la loi. Or, le projet de décret du 13 décembre 2019 entend poser un cadre juridique protecteur des droits permettant la mise en Open Data des décisions de justice. Pour réaliser son ambition, le projet crée deux nouveaux mécanismes juridiques. Le premier offre au juge la possibilité d’occulter les éléments de l’arrêt qu’il estime susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à la vie privée des personnes en complément des règles d’occultation obligatoires prévues par la loi. Le deuxième permet à toute personne intéressée de présenter une demande d’occultation de données ou de levée d’occultation devant la Cour de cassation ou le Conseil d’État. Le projet de décret s’intéresse ensuite à la protection du personnel judiciaire en précisant, pour chaque organe juridictionnel, le responsable chargé de prendre la décision d’occultation des informations du personnel en cas de risque (le président du tribunal rendant la décision en général). Enfin, il harmonise l’occultation des informations pour la mise en Open Data des décisions avec leur copie délivrée aux tiers.
Les solutions apportées par le projet de décret offrent de véritables leviers d’action pour garantir les droits des individus. D’un point de vue purement légal, le projet semble répondre aux enjeux liés à l’Open Data des décisions de justice de protection de la vie privée. Quelques points doivent cependant attirer notre attention. Tout d’abord, la pertinence de faire reposer sur les épaules du juge de nouvelles missions et responsabilités dans un contexte délicat de saturation des tribunaux. Ensuite, les marges de manœuvre qu’offrent ces mécanismes font peser un risque sur l’accessibilité au droit ; une utilisation trop précautionneuse et extensive de ces outils pour garantir la protection des personnes pourrait compliquer grandement la compréhension des décisions de justice. Le risque étant que, finalement, l’Open Data facilite l’accès à des décisions de justice devenues paradoxalement trop incomplètes pour permettre de suivre le juge dans son raisonnement et comprendre sa décision.
II. Actes
Nature privée des contrats relatifs à la sûreté portuaire
Source : TC, 8 avril 2019, Société Compagnie nouvelle de manutentions portuaires c/Grand port maritime du Havre, n ° C 4157.
Tentant de braver « les mirages du contrat administratif2 », le Tribunal des conflits a conclu à la nature privée d’un contrat destiné à assurer la sûreté portuaire. La société Compagnie nouvelle de manutentions portuaires (CNMP) avait confié la mise en œuvre de mesures de sécurité au Grand port maritime du Havre. Mais la société exploitante a cessé d’exécuter les paiements auprès du port, prestataire des missions de surveillance et de gardiennage. Les juges administratif et judiciaire ayant respectivement décliné leur compétence, le Tribunal des conflits a été saisi du litige. Par un raisonnement en trois temps, il conclut que ce type de contrat est de droit privé et que le juge judiciaire est donc compétent pour en connaître.
Tout d’abord, le Tribunal a exclu la présence des critères jurisprudentiels permettant de qualifier un contrat d’administratif. Selon eux, il faut que l’une des deux parties au contrat soit une personne publique et que le contrat ait soit un lien avec le service public, soit une clause impliquant un régime exorbitant. Ce premier raisonnement est surprenant, notamment au regard de la jurisprudence du Conseil d’État qui avait affirmé que les marchés conclus par les exploitants d’aérodromes pour l’exécution de leur mission de police étaient des contrats de droit public (CE, 3 juin 2009, Société Aéroport de Paris, n° 323594). Il justifia cette solution par la théorie du mandat administratif en affirmant « que la mission d’inspection et de filtrage des passagers, des personnels et des bagages, exécutée par les cocontractants des exploitants d’aéroports, est réalisée pour le compte de l’État et sous son autorité dans le cadre de son activité de police administrative des aérodromes et des installations portuaires ». Or, le Tribunal refuse de voir un mandat dans le domaine portuaire. Il est possible d’y voir une rupture avec la jurisprudence administrative mais ce serait négliger les évolutions récentes – notamment de restriction de la qualification administrative des contrats – que vient confirmer la présente décision.
Ensuite, le juge départiteur a réfuté l’idée que le contrat litigieux puisse constituer un contrat accessoire à la convention du 3 juin 2004 ayant autorisé la société CNMP à occuper des dépendances du domaine public du port du Havre. Si le contrat d’occupation du domaine public est de nature administrative par détermination de la loi, il faut néanmoins que le contrat litigieux ait pour objet l’occupation de ce domaine. Par ce raisonnement, il rejoint le juge administratif qui avait refusé de considérer que le contrat ayant pour objet la fourniture de carburant à une compagnie aérienne constituait l’accessoire du contrat d’occupation de l’aéroport en question (CAA Bordeaux, 19 mai 2016, SA Aéroport de La Réunion Roland Garros, n° 15BX01130).
Enfin, le Tribunal relève que le contrat n’est pas un marché public au motif qu’il répondait, non pas à un besoin du port, mais à un besoin de la société privée pour les mesures de surveillance et de gardiennage. Dès lors, la société CNMP n’étant pas soumise aux règles de la commande publique, la qualification de marché public du contrat litigieux devait nécessairement être exclue.
III. Droits et libertés
A. Le Conseil constitutionnel garant de la liberté de manifestation ?
Source : CC, 4 avril 2019, Loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations, n° 2019-780 DC.
L’année 2019 fut marquée par les manifestations « gilets jaunes ». Craignant de revivre le passé, les pouvoirs publics ont élaboré une loi « visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations ». Cette proposition de loi fut adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture le 5 février 2019, puis par le Sénat dans la même version le 12 mars 2019. Cependant rien n’est simple, les vertus démocratiques favorisent – à juste titre – la critique des textes venant restreindre les libertés au nom de l’ordre public. Ainsi, pour arbitrer constitutionnellement les débats, le président de la République a soumis au Conseil constitutionnel la loi adoptée. Au cours de la Ve République, ce n’est que la deuxième fois que le président de la République défère une loi ordinaire au gardien de la Constitution.
Dans une décision du 4 avril 2019, le Conseil constitutionnel a délivré son interprétation, au regard de la liberté de manifestation et de la liberté d’aller et venir, des articles 2, 3 et 6 de ladite loi. Si le Conseil constitutionnel a reconnu la validité des articles 2 et 6, la mesure la plus controversée de la loi – l’article 3 – fut quant à elle censurée. En effet, le volet administratif avait vocation à permettre « à l’autorité administrative, sous certaines conditions, d’interdire à une personne de participer à une manifestation sur la voie publique et, dans certains cas, de prendre part à toute manifestation sur l’ensemble du territoire national pour une durée d’un mois ». Compte tenu des dispositions dudit article, le Conseil admet que « le législateur a porté au droit d’expression collective des idées et des opinions une atteinte qui n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée ». En déclarant inconstitutionnel cet article, le Conseil constitutionnel nourrit l’idée selon laquelle le droit s’adapte aux défis de la société tout en restant fidèle aux droits et libertés fondamentaux. Le maintien de l’ordre public ne doit pas être un outil d’anéantissement des libertés.
B. Fichiers biométriques et étrangers mineurs non accompagnés
Source : CC, 26 juillet 2019, Unicef et autres, n° 2019-797 QPC.
Le Conseil constitutionnel a statué, dans sa décision QPC du 26 juillet 2019, sur la constitutionnalité des dispositions de l’article L. 611-6-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) issu de la loi du 10 septembre 2018. Cet article dispose que les données personnelles biométriques des mineurs non accompagnés pourront être « relevées, mémorisées, et faire l’objet d’un traitement automatisé ». Cet article s’inscrit dans la création du nouveau fichier « Appui à l’Évaluation de la Minorité » (AEM) par le ministère de l’Intérieur. Ce fichier a pour objectif de lutter contre l’immigration irrégulière et faciliter l’action des autorités en charge de la protection des mineurs. Les nombreuses associations requérantes soutenaient que les dispositions attaquées du CESEDA méconnaissaient notamment l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit à la vie privée.
Le Conseil a considéré que le législateur avait assuré une conciliation proportionnée entre la sauvegarde de l’ordre public et le droit au respect de la vie privée. Le Conseil constitutionnel a en effet relevé, d’une part, que la conservation des données biométriques sera limitée et, d’autre part, que les dispositions de la loi ne modifient pas les règles attachées à la détermination de l’âge d’un individu et aux protections des étrangers mineurs. Pourtant dès décembre 2018 le Défenseur des droits avait fait part de ses inquiétudes quant à la création du fichier AEM. Il soulignait que l’enregistrement des informations biométriques des mineurs non accompagnés « formalise le fait qu’ils sont considérés d’abord comme des étrangers fraudeurs plutôt que comme de potentiels enfants en danger ». Il semblerait, ainsi que ce dernier l’a indiqué, que d’autres dispositifs moins liberticides soient aptes à assurer une conciliation entre la sauvegarde de l’ordre public et l’intérêt supérieur de l’enfant. En outre la nomination d’administrateur ad hoc ou de tuteurs permettrait de lutter contre le « nomadisme administratif » et de garantir un accès effectif des mineurs à leurs droits.
C. La CEDH et la conservation des données
Source : CEDH, 24 janvier 2019, Catt c/Royaume-Uni, n° 43514/15.
La décision Catt c/Royaume-Uni rendue par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) prend à bras le corps la question de la conservation des données. Chose d’autant plus délicate lorsqu’il est question de sécurité publique. Dans cet arrêt, la Cour estime que les autorités britanniques ont violé l’article 8 de la Convention en raison d’un manquement à leurs obligations de protection à la vie privée de Mr John Oldroyd Catt, le requérant. Pour se faire, elle fonde son raisonnement sur un ensemble de trois arguments. Tout d’abord, l’ambiguïté et le flou entourant la notion de « domestic extremism » (qui renvoie aux extrémistes nationaux radicalisés employant des moyens d’actions politiques illégaux et violents) sur laquelle s’appuient les autorités anglaises pour ficher des individus, donnant ainsi une trop large marge d’appréciation aux pouvoirs publics. Les juges relèvent, ensuite, l’absence de cadre juridique clair présentant des limites temporelles et des garanties procédurales satisfaisantes. La seule règle à ce sujet, au Royaume-Uni, était le réexamen de la conservation des données qui s’effectuait tous les six ans. La Cour juge à cet égard que l’absence de garantie viole de facto l’article 8 de la Convention en accord avec sa jurisprudence M. M. c/Royaume-Uni (CEDH, 13 novembre 2012, n° 24029/07, § 193). Enfin, les juges soulèvent le caractère disproportionné de la conservation litigieuse des données en appréciant leur nature et les circonstances de fait. En l’espèce, ces données ont été récoltées lors d’événements pacifiques et concernent une personne désormais âgée qui n’a jamais été condamnée. À cela s’ajoute la teneur politique des données qui rend délicate, aux yeux du juge, leur conservation par les pouvoirs publics en l’absence de motivation particulière.
Si la décision sanctionne le Royaume-Uni, sa lecture montre toutefois une certaine indulgence de la Cour envers la conservation des données. En effet, la Cour établit un rapport déséquilibré entre la protection de la vie privée et la sécurité publique au profit de cette dernière. Ce déséquilibre s’observe à deux égards. Tout d’abord, par l’indulgence de la Cour en ce qui concerne les motifs entraînant le fichage des individus (deux juges de la Cour dénoncent cette indulgence dans une opinion dissidente) ; puis l’absence de limites « raisonnables » à la conservation des données imposées par la Cour pour encadrer davantage les pouvoirs publics. Un principe est néanmoins posé, celui de l’impossibilité de ficher indéfiniment un individu pour les États membres. À l’heure où de nombreux pays souhaitent user du fichage, comme la France à l’encontre des individus interdits de manifestation prévu par la loi « anti-casseur » (n° 2019-290 votée le 23 janvier 2019), on peut s’interroger sur la capacité de la Cour à garantir les droits des individus en la matière.
D. Hanouna et le CSA : touche pas à mon humour ?
Source : CE, 13 novembre 2019, Société C8, n° 415397.
Par une décision du 13 novembre 2019, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a été condamné par le Conseil d’État à indemniser la société C8 à 1,1 million d’euros. Le 18 juin 2018, le Conseil d’État avait annulé la décision de sanction du CSA à l’encontre de la société C8 à la suite de la diffusion d’une séquence polémique de l’émission « Touche pas à mon poste » (CE, 18 juin 2018, n° 412074). La décision de sanction du CSA consistait en la suspension durant une semaine de la diffusion de séquences publicitaires au sein de l’émission, ainsi que de celles pendant les quinze minutes qui précèdent et suivent la diffusion de cette émission. Le Conseil d’État a justifié l’annulation de cette sanction par le fait que la séquence litigieuse n’aurait révélé aucune méconnaissance des stipulations de la convention de service. Cette dernière veille à la protection de la dignité de la personne humaine dans le domaine audiovisuel et interdit la diffusion d’images ou de témoignages susceptibles d’humilier des personnes.
En l’espèce, le Conseil d’État jugea que « l’illégalité de cette décision de sanction constitue une faute de nature à engager sa responsabilité » et que « la société C8 est en droit d’obtenir de lui la réparation des préjudices directs et certains ayant résulté pour elle de cette décision ». Il condamna donc le CSA à verser à la société C8 1,1 million d’euros. Ainsi, si vous êtes victime d’une caméra cachée mettant en scène une fausse agression mortelle durant une émission télévisée, le Conseil d’État considérera qu’il n’y a pas méconnaissance du principe du respect de la dignité de la personne humaine, le caractère humoristique de l’émission et la liberté d’expression pouvant a priori prévaloir sur celle-ci. In fine, la conciliation des valeurs est un art particulièrement délicat pouvant conduire le juge à adopter des décisions incertaines.
E. Accouchement sous X
Source : CE, 16 octobre 2019, Mme F., n° 420230.
Le Conseil d’État a considéré, dans un arrêt du 16 octobre 2019, que la législation française opère une conciliation équilibrée entre le droit des enfants à connaître leurs origines et le droit des mères au secret de leur identité. Le Conseil a en effet rejeté le pourvoi d’une femme née sous X et demandant à connaître ses origines. Cette dernière avait saisi le Conseil National d’Accès aux Origines Personnelles (CNAOP) d’une demande en obtention de l’identité de ses parents. Le CNAOP a retrouvé et contacté la mère de la requérante, laquelle a refusé que son identité soit révélée. Néanmoins, elle a apporté des réponses aux questions de sa fille biologique qui lui avaient été transmises par le Conseil. La requérante a ainsi pu obtenir des informations relatives à sa naissance.
La cour administrative d’appel s’est fondée à tort sur les dispositions de la loi du 27 juin 1904 pour confirmer le refus de la CNAOP de révéler l’identité de la mère de la requérante. Cette erreur a été jugée sans incidence sur le sens de la décision de la Cour. En effet, à la naissance de la requérante en 1993, la loi du 27 juin 1904 avait été abrogée par la loi du 15 avril 1943. Néanmoins, celle-ci organisait « la possibilité pour une mère de confier son enfant à des tiers en maintenant le secret de son identité ». Le Conseil d’État a donc opéré une substitution de pur droit de ces dispositions. Le Conseil a également écarté le moyen selon lequel les dispositions du Code de l’action sociale et des familles violaient l’article 8 de la CEDH sur le droit au respect de la vie privée et familiale. Les juges ont relevé que les articles 147-1 à 147-6 du Code « organisent la possibilité de lever le secret de l’identité de la mère de naissance (…) et définissent ainsi un équilibre entre le respect dû au droit à l’anonymat garanti à la mère et le souhait légitime de l’enfant de connaître ses origines ». Cette position est celle que la Cour Européenne des Droits de l’Homme a adoptée (CEDH, 13 février 2003, Odièvre c/France, n° 42326/98), considérant que la législation française atteignait un équilibre et une proportionnalité suffisante entre le droit d’accès à ses origines personnelles et le droit des femmes à accoucher de manière anonyme et secrète. Toutefois, il est nécessaire de souligner que le Conseil d’État ne s’est pas borné à constater cet équilibre dans la conciliation des droits pour apprécier la non-violation de l’article 8 de la CEDH. Le juge administratif a souligné le fait que la requérante avait pu disposer « hormis l’identité de sa mère biologique encore en vie, d’informations relatives à sa naissance recueillies par le CNAOP ».
Cette incise dans le dispositif de la décision interroge. La méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale aurait-elle été reconnue si la requérante n’avait pas obtenu de réponses aux questions relatives à sa naissance ? Partant, cet arrêt montre-t-il la volonté du Conseil d’ajouter de nouvelles conditions nécessaires afin de caractériser l’équilibre dans la conciliation des droits des mères et ceux des enfants nés sous X ? Seuls les prochains développements jurisprudentiels pourront le dire.
F. Le domaine cultuel d’une commune
Source : CE, 7 mars 2019, Commune de Valbonne, n° 417629.
La loi de 1905 est chaque année sujette à débats, controverses, interprétations et critiques. L’année 2019 ne fut pas une exception. Effectivement, la législation concernant la séparation des Églises et de l’État a été mentionnée par le Conseil d’État dans son arrêt du 7 mars 2019. En l’espèce, à la suite d’une délibération municipale, le maire d’une commune a conclu une convention d’occupation avec une association cultuelle pour lui allouer un local. Ainsi, le Conseil d’État a dû s’atteler à définir les conditions dans lesquelles une commune peut conclure une telle convention.
L’article 2 de la loi de 1905 énonce que « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte [ainsi] seront supprimées des budgets de l’État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes ». À la lecture de cette disposition, il semble impossible que le Conseil d’État contredise les juridictions qui le précèdent en validant la délibération du conseil municipal et la convention d’occupation. Cependant, comme l’a à juste titre qualifié le tribunal administratif, les locaux en question appartiennent au domaine privé de la commune. Dans ces conditions le Conseil d’État affirme que « les collectivités territoriales peuvent donner à bail, et ainsi pour un usage exclusif et pérenne, à une association cultuelle un local existant de leur domaine privé sans méconnaître les dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 ». Le Conseil d’État ne fait pas d’interprétation littérale de cet article. Ainsi, tant que les locaux appartiennent au domaine privé d’une commune, le juge administratif considère que cette dernière peut l’allouer de manière « exclusive et pérenne » à une association cultuelle. La condition sine qua non de cette location est une contrepartie financière de la part de l’association, sans quoi, elle serait favorisée par la collectivité.
IV. Responsabilité
L’engagement de la responsabilité de l’État pour inconstitutionnalité de la loi
Source : CE, Ass., 24 décembre 2019, M. B., n° 428162.
Cela fait maintenant plus de douze ans que le Conseil d’État a reconnu dans un arrêt Gardedieu, la possibilité d’engager la responsabilité de l’État pour obtenir réparation des dommages subis du fait de l’application d’une loi contraire aux engagements internationaux (CE, Ass., 8 février 2007).
Il aura fallu attendre décembre 2019 pour que le Conseil d’État reconnaisse la possibilité d’engager la responsabilité de l’État due à l’application d’une loi contraire à la Constitution. En l’espèce, des salariés souhaitaient se prévaloir de l’inconstitutionnalité de dispositions législatives (v. CC, 1er août 2013, Participation des salariés aux résultats de l’entreprise dans les entreprises publiques, n° 2013-336 QPC) pour obtenir une indemnisation. Outre l’évolution jurisprudentielle majeure, ce fut ainsi l’occasion pour le Conseil d’État de préciser les conditions requises pour qu’une telle demande de réparation puisse aboutir.
Tout d’abord, le juge administratif rappelle qu’il est possible d’engager la responsabilité de l’État « du fait d’une disposition législative contraire à la Constitution que si le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition inconstitutionnelle ». De surcroît, le juge constitutionnel « détermine [également] les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». Ainsi, le Conseil constitutionnel apparaît comme un chef d’orchestre étant, d’une part, à l’initiative – inconstitutionnalité de la loi – et, d’autre part, à l’ordonnancement d’une telle procédure. En effet, dans cette décision le juge constitutionnel décide que la déclaration d’inconstitutionnalité de la disposition législative prend effet le 4 août 2013. Cela fait donc obstacle à la demande des requérants. Ensuite, dans son arrêt du 24 décembre 2019, le Conseil d’État met un point d’honneur à la nécessité d’établir un lien de causalité direct entre la loi jugée inconstitutionnelle et le préjudice subi. En l’espèce, la demande est rejetée faute de lien direct. Toujours au titre de l’imputabilité du préjudice, il est notable que le juge ait mobilisé dans cette décision un fait générateur original, se fondant sur « les exigences inhérentes à la hiérarchie des normes », et non en qualifiant une éventuelle faute du législateur. Enfin, le juge administratif rappelle dans cet arrêt la règle de prescription quadriennale. Fidèle au principe de répartition des compétences entre les juges, le Conseil constitutionnel semble être dans ce schéma l’acteur le plus important sans pour autant oublier que la question prioritaire de constitutionnalité est l’instrument permettant d’initier une telle procédure.
V. Fonction publique
A. L’amorce d’une fonction publique ouverte ?
Source : Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
La transformation de la fonction publique est un mouvement croissant en France, à un point tel que ce dernier a été consacré par la loi du 6 août 2019. Ses objectifs s’inscrivent dans le programme « Action publique 2022 », politique visant à transformer en profondeur le service public. Cette loi propose cinq axes qui relativisent profondément l’adhésion du système français au modèle « fermé » de fonction publique. Par opposition au modèle « ouvert », la fonction publique française fonctionne sur les principes d’un système carriériste, d’un droit spécifique par rapport au droit du travail et de la neutralité politique. Or, l’hybridation des modèles à laquelle elle est soumise la conduit progressivement à s’aligner avec ces États où le système est ouvert (voir par exemple, la situation aux États-Unis).
L’idée de simplifier et garantir la transparence et l’équité du cadre de gestion des agents publics (titre III) et de renforcer l’égalité professionnelle (titre V) sont deux axes à saluer. Il apparaissait nécessaire de les renforcer davantage afin d’améliorer l’accès à la fonction publique ainsi que le contenu de la situation juridique des agents publics. Par exemple, la loi prévoit que les procédés de recrutement et d’admissibilité aux emplois publics doivent davantage garantir l’égal accès aux emplois publics et la transparence des procédures de recrutement hors concours. Elle prévoit aussi une extension et un renforcement du dispositif de nominations équilibrées pour les emplois de direction et la composition des jurys et comités de sélection.
En revanche, les perspectives de promotion du dialogue social (titre Ier), de transformation et de simplification de la gestion des ressources humaines (titre II) et d’accompagnement des transitions professionnelles des agents publics dans la fonction publique et le secteur privé (titre V) laissent perplexe et sceptique. L’idéologie managériale américaine a notablement influencé les politiques publiques françaises en matière de fonction publique. La conséquence est que le droit de la fonction publique a vu son degré de spécificité par rapport au droit du travail être réduit. À titre d’exemple, il faut citer la création d’une nouvelle instance unique de dialogue issue de la fusion des comités techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cette réorganisation a été effectuée avec pour modèle la réforme de septembre 2017 dans le secteur privé. En outre, il faut évoquer la mesure phare et controversée de l’élargissement du recours au contrat. Par principe, l’occupation des emplois permanents de l’État par des fonctionnaires demeure dans le statut général. Or, les risques de cette multiplication du recours au contrat sont la pratique du « copinage », l’accroissement de la précarité de l’emploi public mais encore le découragement à l’inscription aux concours.
B. Dépression et droit de la fonction publique
Source : CE, 13 mars 2019, Mme D., n° 407795.
Dans une décision du 13 mars 2019, le Conseil d’État fut sollicité par un agent public souhaitant obtenir la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un syndrome dépressif sévère. En l’espèce, il affirma qu’« une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service ». Ainsi, il confirma l’application en droit de la fonction publique du principe d’absence de présomption d’imputabilité : un agent public doit donc démontrer le lien de causalité entre l’accident subi et le service dans lequel il est employé.
À cet égard, le Conseil d’État avait déjà pu définir l’accident de service comme « un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal », à condition qu’il n’y ait pas de « faute personnelle » ou « toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service » (CE, Sect., 16 juillet 2014, Mme G., n° 361820)3. Par conséquent, l’imputabilité au service de l’infirmité invalidante est admise lorsque le juge constate qu’aucun fait personnel de l’intéressé et qu’aucune circonstance quelconque ne rompt le lien entre les actes accomplis dans l’exercice des fonctions et le service. Plus particulièrement, le Conseil d’État avait déjà pu admettre l’imputation d’un syndrome dépressif à un service par une décision du 11 avril 2014 dans laquelle il avait jugé que la dépression d’un gendarme, résultant d’une persécution pour corruption devant une juridiction pénale, était imputable au service (CE, 11 avril 2014, n° 346086).
En conclusion, un syndrome dépressif peut être qualifié de maladie professionnelle et l’éventuelle imputabilité au service est soumise à une appréciation particulière de la part du juge administratif. Cette solution est bienvenue, notamment en ce qu’elle permet d’accroître la protection d’agents publics victimes d’abus de position d’autres agents. Elle est également bien encadrée avec la technique de l’appréciation particulière car elle évite en parallèle l’invocation systématique de ce chef de préjudice.
VI. Environnement
A. Électricité nucléaire et marché concurrentiel
Source : CC, 7 novembre 2019, Loi relative à l’énergie et au climat, n° 2019-791 DC.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 octobre 2019 dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 61 de la Constitution. Plus de 60 sénateurs lui demandaient de se prononcer sur la conformité à la Constitution de la loi relative à l’énergie et au climat. Cette saisine visait exclusivement l’article 62 de cette loi prévoyant une augmentation de la quantité d’électricité nucléaire pouvant être vendue par Électricité de France (EDF), en situation de monopole, aux autres fournisseurs d’électricité. Les sénateurs requérants soutenaient que cette augmentation méconnaissait le principe d’égalité devant la loi ainsi que la liberté d’entreprendre.
Le Conseil constitutionnel, pour apprécier la constitutionnalité de l’article 62 de la loi, a rappelé que les mesures attaquées avaient pour but de permettre aux entreprises ne détenant pas le monopole de production d’énergie nucléaire d’accéder à cette énergie. Ces dispositions s’inscrivaient donc dans l’ouverture à la concurrence de l’énergie nucléaire. Ainsi, le Conseil relève que l’objectif de ces dispositions était « d’éviter la situation où les fournisseurs, faute d’accéder au volume d’énergie nucléaire nécessaire pour fournir leurs clients, seraient contraints d’acquérir sur le marché une électricité plus chère entraînant ainsi un renchérissement des prix pour le consommateur final ». Le Conseil a souligné le fait que la détermination du seuil à 150 térawattheures par an est proportionnée « aux objectifs de développement de la concurrence sur les marchés de la production d’électricité et de fourniture ». Néanmoins il a émis une réserve quant à la détermination du prix de l’électricité. Dans l’attente de la proposition de la Commission de régulation de l’énergie, les ministres doivent provisoirement arrêter le prix de l’électricité, mais en tenant compte toutefois « des conditions économiques de production d’électricité par les centrales nucléaires ».
Le Conseil contrôle, au regard de la situation de monopole d’EDF, que l’interventionnisme économique sur le marché de production d’électricité nucléaire respecte notamment la liberté de commerce et de l’industrie des autres opérateurs. En l’espèce, il considère que les dispositions de la loi poursuivent, dans le cadre de ce marché réglementé, un objectif d’intérêt général en garantissant notamment le fonctionnement concurrentiel du marché de l’électricité et la stabilité des prix sur ce marché. Néanmoins, le Conseil précise les modalités de fixation des prix de l’énergie, notamment au regard des règles du marché. Il s’assure ainsi sans le dire explicitement, que le monopole d’EDF ne conduise pas à un abus de position dominante qui méconnaîtrait les règles de concurrence et de fonctionnement normal de fixation des prix du marché.
B. La notice jurisprudentielle des expérimentations
Source : CE, 17 juin 2019, Association Les amis de la Terre France, n° 421871.
Jouant « le rôle d’une petite bonne à tout faire4 », le processus d’expérimentation consacré à l’article 37 ‑1 de la Constitution a été précisé par le Conseil d’État dans une décision du 17 juin 2019.
Cet enrichissement du concept est bienvenu car l’article 37-1 fixe maigrement que « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». Dans cette affaire, l’association « Les amis de la Terre France » a demandé l’annulation du décret du 29 décembre 2017, adopté en application de l’article 37-1, qui prévoit une expérimentation territoriale. Ce droit de dérogation de deux ans reconnaît aux préfets de certains départements et certaines régions la possibilité de s’affranchir de certaines normes juridiques. Particulièrement, le décret attaqué leur permettait d’édicter des décisions dérogatoires à certains règlements régissant sept matières (environnement, construction, logement, etc.). Dans un deuxième moyen, l’association appuyait sa demande d’annulation en faisant valoir que le décret permettait un détournement des règles de protection de l’environnement, notamment du principe de non-régression5 qui interdit au pouvoir réglementaire de réduire le niveau de protection de l’environnement.
Le Conseil d’État précise qu’il résulte de l’article 37-1 que le pouvoir réglementaire peut autoriser des expérimentations dérogatoires à des normes à caractère réglementaire sous certaines conditions. En effet, il faut tout d’abord qu’elles respectent les normes supérieures, qu’elles présentent ensuite un objet et une durée limités, et enfin que leurs conditions de mise en œuvre soient définies précisément. Il ajoute que, dans l’hypothèse où le pouvoir réglementaire ne peut pas préciser ces normes réglementaires ou celles ayant vocation à s’y substituer, il est impératif qu’il énumère les matières dans lesquelles cette dérogation peut intervenir, ainsi que les objectifs et conditions auxquels elle doit répondre. En l’espèce, ces conditions sont présentes selon le juge administratif : dérogation ponctuelle respectant les normes supérieures, limitée à certaines règles et assujettie à des motifs précis. Suivant les conclusions du rapporteur public, la juridiction administrative a conclu à la régularité du décret et a rejeté le pourvoi de l’association. Si les conditions apparaissent restrictives, le juge est néanmoins souple dans leur appréciation, ce qui permet d’équilibrer la balance et de ne pas décourager l’expérimentation.
C. La prévention des risques environnementaux et sanitaires
Source : CE, 26 juin 2019, Association générations futures, n° 415426.
La décision du 26 juin 2019 rendue par le Conseil d’État aboutit à l’annulation partielle de l’arrêté du 4 avril 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. C’est sur le terrain de la prévention des risques environnementaux et sanitaires que le Conseil d’État va construire son raisonnement. S’appuyant sur le droit interne et le règlement européen n° 1107/2009, le Conseil décide d’annuler certaines dispositions de l’arrêté dont les lacunes font peser des risques sur les individus et les écosystèmes. Sur le terrain de la prévention des risques sanitaires, le Conseil relève l’illégalité des articles 1er et 2 de l’arrêté. En effet, l’encadrement trop partiel du délai d’entrée des personnes sur une zone traitée par les produits aux seuls cas où l’on se trouve sur « une végétalisation en place » et donc excluant les sols vierges crée un risque. De même, le Conseil déplore l’absence de « dispositions destinées à protéger les riverains des zones traitées » dans l’ensemble de l’arrêté. Concernant les insuffisances faisant peser des risques environnementaux, le Conseil sanctionne, d’une part, les articles 1er et 12 de l’arrêté en ce qu’ils n’incluent pas dans leur champ d’application de nombreuses techniques d’utilisation des produits (notamment l’épandage de granulés ou l’injection de produits dans les sols) qui de facto auraient échappé à la réglementation. D’autre part, l’article 2 de l’arrêté en ce qu’il n’intègre pas de mesures restreignant l’utilisation des produits en cas de « période de forte pluviosité » pouvant provoquer des pollutions par ruissellements.
Auparavant, le Conseil avait pour habitude de privilégier la sécurité juridique et donc la régularisation à l’annulation des actes (v. par ex, au sujet du nucléaire : CE, 1er mars 2013, Sté Roozen et autres, n° 340859). On ne peut que constater, à la lecture de l’arrêt, la mue de l’institution qui semble avoir atteint une certaine maturité en matière de protection de l’environnement et de santé publique par l’utilisation d’une l’annulation choisie. Le Conseil s’offre désormais la possibilité de contraindre pleinement l’action publique à davantage de rigueur dans la rédaction des actes ayant un intérêt environnemental et de santé publique. Deux questions subsistent : tout d’abord les incertitudes juridiques concernant l’étendue des exigences et de la vigilance du Conseil pour prévenir les risques environnementaux et sanitaires ; enfin, jusqu’où le Conseil est-il prêt à aller dans cette voie sinueuse et sensible en raison des multiples intérêts économiques, pratiques et parfois même diplomatiques qui gravitent autour de ces questions ?
D. Carence fautive de l’État en matière de pollution de l’air
Sources : TA Montreuil, 25 juin 2019, n° 1802202 ; TA Paris, 4 juillet 2019, n° 1709333 ; TA Paris, 4 juillet 2019, n° 1810251 ; TA Paris, 4 juillet 2019, n° 1814405.
Le 25 juin 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a reconnu la carence fautive de l’État en matière de pollution de l’air. Moins de deux semaines plus tard, le Tribunal administratif de Paris reconnaissait à son tour, dans trois jugements, cette carence fautive. Les requérants soutenaient dans chaque affaire la méconnaissance par l’État français de ses engagements en matière de qualité de l’air, notamment sur la base des articles 13 et 23 de la directive du 21 mai 2008 dont les exigences ont été transposées dans le Code de l’environnement. Ces dispositions prévoient, d’une part, que les États membres doivent veiller à ce que dans leurs agglomérations, « les niveaux d’anhydride sulfureux, de PM10, de plomb et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l’annexe XI » de la directive. Des seuils sont également fixés concernant le dioxyde d’azote et le benzène. D’autre part, lorsque dans certaines agglomérations les niveaux de polluants dans l’air dépassent les seuils prévus, les États doivent veiller « à ce que des plans relatifs à la qualité de l’air soient établis pour cette zone ou agglomération ». Ces plans de protection de l’atmosphère doivent prévoir « des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible ».
Les deux tribunaux administratifs ont relevé que les seuils de polluants ont été dépassés systématiquement dans la région Île-de-France entre l’année 2012 et 2016. Les juges considèrent ainsi, d’une part, que « le dépassement des valeurs limites de concentrations en particules fines et en dioxyde d’azote constitue, pour les zones concernées, une méconnaissance des dispositions des articles L. 221-1 et R. 221-1 du Code de l’environnement ». D’autre part, si les juges relèvent qu’un plan de protection de l’atmosphère a été établi par le préfet, ils considèrent néanmoins que « eu égard à la persistance des dépassements observés depuis plusieurs années en Île-de-France, les plans relatifs à la qualité de l’air et leurs conditions de mise en œuvre doivent être regardés comme insuffisants au regard des obligations rappelées, dès lors qu’ils n’ont pas permis que la période de dépassement des valeurs limites soit la plus courte possible ». Les demandes indemnitaires des requérants ont néanmoins été écartées en ce que les juges n’ont pas pu établir le lien de causalité entre les problèmes de santé allégués et la carence fautive de l’État en matière de pollution de l’air.
Cette carence fautive de l’État a été sanctionnée postérieurement par le juge européen. La Cour de Justice de l’Union européenne, dans sa décision du 24 octobre 2019, a en effet condamné la France pour avoir manqué à ses obligations découlant des articles 13 et 23 de la directive du 21 mai 2008. Il sera intéressant de surveiller, pour les années à venir, de quelle manière l’État français prendra en compte ces condamnations nationales et européennes.
VII. Procédure législative
L’entrave législative par le Référendum d’initiative partagée
Source : CC, 9 mai 2019, Proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris, n° 2019-1 RIP.
Les différents mécanismes référendaires ont marqué de leur empreinte l’année 2019. D’une part, tel fut le cas avec les revendications en faveur d’un Référendum d’Initiative citoyenne (RIC) et, d’autre part, avec l’utilisation du Référendum d’Initiative partagé (RIP) qui est quant à elle constitutionnellement garantie. Effectivement, ce mécanisme adopté en 2008 est consacré l’article 11 de la Constitution. Il fut utilisé pour la première fois au cours de l’année dernière. Dans ce contexte, le Conseil constitutionnel a dû se prononcer à son sujet dans une décision relative au caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris. L’article 11 de la Constitution permet à un cinquième des parlementaires d’organiser un référendum. Pour cela, il faut ensuite que ces derniers soient soutenus par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Dans ces conditions l’article 11 de la Constitution énonce que « cette initiative prend la forme d’une proposition de loi ». Il est important de noter que l’objet de cette proposition de loi ne peut pas être l’abrogation d’une législation promulguée depuis moins d’un an. C’est cette dernière condition qui va nous intéresser dans ces observations.
Dans une publication parue dans le journal Le Monde le 14 mai 2019, Olivier Duhamel considère que le Conseil constitutionnel « joue avec le feu ». En effet, la condition de recevabilité de l’article 11 a pour objectif d’empêcher que le référendum d’initiative partagée entrave une nouvelle loi. En somme, éviter la négation du pouvoir législatif par un mécanisme constitutionnel. Cependant, en l’espèce, la loi pacte n’est pas encore promulguée. Ainsi le Conseil constitutionnel considère que la proposition de loi initiée par le référendum d’initiative partagée ne contrevient pas à l’esprit de l’article 11 de la Constitution. À cette occasion Olivier Duhamel estime que la décision du Conseil constitutionnel « pourrait bien constituer une double faute, juridique et démocratique » (Olivier Duhamel et Nicolas Molfessis, « ADP. Avec le RIP, le Conseil constitutionnel joue avec le feu », Le Monde, 14 mai 2019). L’interprétation du Conseil est des plus audacieuses et le jeu politique confine au parasitage démocratique.
VIII. Procédure contentieuse
A. 10 ans après Béziers I, la saga continue !
Source : CE, Sect., 1er juillet 2019, Association pour le musée des Iles Saint-Pierre et Miquelon, n° 412243
Voilà maintenant une décennie que le Conseil d’État a transformé l’office du juge administratif vis-à-vis des contrats avec sa fameuse trilogie « Béziers ». Dans un arrêt du 1er juillet 2019, le Conseil d’État a eu l’occasion d’en écrire un nouvel épisode ; ou plutôt un « hors-série ». Dans celui-ci, une association conteste la validité d’une convention conclue avec une collectivité le 31 décembre 1998. Faisant application de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du Code civil, le tribunal administratif, le 15 juillet 2015, ainsi que la cour administrative d’appel ont rejeté la demande par laquelle l’association requérante contestait la validité de la convention.
Cependant, dans son arrêt du 1er juillet 2019, le Conseil d’État énonce que la prescription quinquennale n’est « pas applicable à l’action en contestation de validité introduite par l’association requérante ». Ainsi, le juge administratif affirme que la contestation de validité du contrat « est ouverte aux parties au contrat pendant toute la durée d’exécution de celui-ci ». Il s’agit pour le Conseil d’État de ne pas restreindre dans un carcan temporel, la possibilité pour les parties de saisir le juge du contrat. L’idée étant, comme le relève le rapporteur public Alexandre Lallet dans ses conclusions, d’alléger les conditions énoncées dix ans auparavant en évinçant le délai prescriptible. Dans ces conditions, nous pourrions craindre une recrudescence d’annulation entraînant une fragilité des relations contractuelles. Dans cette même décision, le Conseil d’État apporte une réponse à ces craintes en réglant l’affaire au fond. En l’espèce, le juge administratif rejette la demande en annulation de la convention de l’association, démontrant ainsi que les rigoureuses conditions énoncées par « Béziers I » suffisent à protéger les relations contractuelles.
B. Czabaj joue les prolongations
Source : CE, 29 novembre 2019, M. B., n° 426372.
L’arrêt d’Assemblée Czabaj du 13 juillet 2016 a précisé le délai de recours dont bénéficie un requérant pour attaquer par la voie de l’excès de pouvoir une décision administrative qui ne mentionne pas les voies et délais de recours. Le Conseil d’État a fixé à un an ce délai de recours raisonnable, à compter de la notification de la décision à la personne ou de la date à laquelle il est établi qu’elle en a eu connaissance. Le Conseil d’État affirmait pour appuyer cette décision, que le principe de sécurité juridique « fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle ».
Le Conseil d’État, dans trois décisions du 29 novembre 2019, devait se prononcer sur l’annulation de décrets portant libération de liens d’allégeances avec la France. Encadrées par l’article 91 du Code de la nationalité française, les demandes de perte de nationalité peuvent être formulées par la personne majeure ou, durant sa minorité, par ses parents. En l’espèce, les requérants contestaient les décrets de libérations de leurs liens d’allégeance avec la France, sollicités par leurs parents. Le Conseil d’État s’est prononcé dans deux des affaires sur le délai de recours raisonnable applicable à ces situations. Il a ainsi considéré que « s’agissant d’un décret de libération des liens d’allégeance, ce délai ne saurait, eu égard aux effets de cette décision, excéder, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, trois ans à compter de la date de publication du décret ou si elle est plus tardive, de la date de la majorité de l’intéressé ».
Le rapporteur public avait formulé cette proposition d’extension du délai raisonnable dans ses conclusions. Il relevait notamment que « le bénéficiaire d’un décret de libération de liens d’allégeance est recevable à contester ce décret lorsqu’il ne l’a pas personnellement demandé. (…) Cela revient à dire, alors même que la demande a été faite au nom de l’enfant, que cette demande ne lui est pas, au stade de la recevabilité du recours, directement opposable dès lors qu’elle a été exprimée par ses parents ». Il concluait en affirmant que la fixation d’un nouveau délai raisonnable plus long s’avérait être nécessaire dans cette situation : « il nous semble que le délai raisonnable dans lequel il peut légitimement être exigé que l’intéressé agisse devrait alors être porté à trois ans, à compter, donc, de la date de publication du décret, ou de la date de la majorité si elle est plus tardive, pour tenir compte de l’écart entre la faculté de solliciter le décret et celle d’agir en justice ». La fermeture du prétoire aux administrés opérée par la jurisprudence Czabaj sous couvert de la sécurité juridique est atténuée par cette nouvelle jurisprudence du Conseil. Néanmoins, cette exception a pour vocation de demeurer rare. Il semble que la vulnérabilité des requérants ait permis, en l’espèce, en matière de libération des liens d’allégeance, de remettre en cause le délai raisonnable d’un an. Le principe de sécurité juridique semble être ici renversé, au bénéfice des administrés. Partant, il est légitime de se demander si dans d’autres « contentieux de niche » le Conseil pourrait faire application d’un nouveau délai raisonnable de plus d’un an.