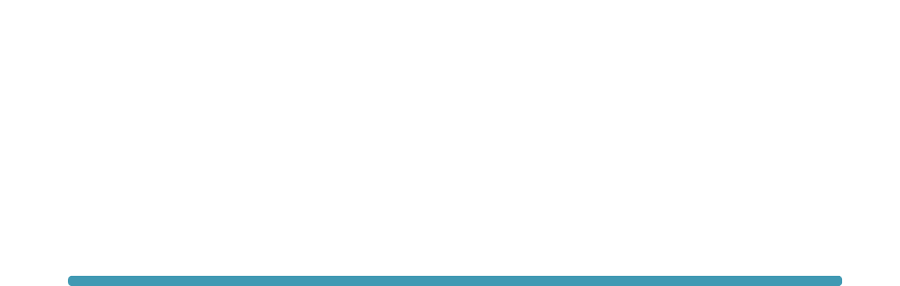Sillonner une année entière de droit public en seulement quelques pages, voilà un exercice bien irréaliste tant il est ambitieux ! On ne saurait en livrer qu’une vue partielle, en dresser qu’un exposé laconique, tout ceci au prisme d’une forte subjectivité collective. De surcroît, 2020 fut, et demeurera, une année très singulière dans laquelle la crise sanitaire aura largement monopolisé l’action publique. Vingt actualités — riches et bigarrées — ont été retenues dans cette présentation : de la protection de l’environnement à la loi d’accélération et de simplification, des libertés fondamentales en état d’urgence aux responsabilités pour exposition à l’amiante, des cantines scolaires au référendum en Nouvelle-Calédonie, etc. Si le tableau est inévitablement parcellaire, le panorama offre déjà de beaux points de vue.
I. Action publique
A. Une loi pour faciliter l’accès aux services publics
Source : Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
Promulguée le 7 décembre 2020, la Loi d’accélération et de simplification de l’action publique, dite loi « Asap », a pour objectif de répondre aux attentes, exprimées lors du grand débat national lancé le 15 janvier 2019 par le président de la République dans le contexte du mouvement des Gilets jaunes. Son but est de « rapprocher l’administration du citoyen, simplifier les démarches des particuliers et faciliter le développement des entreprises, en accélérant les procédures administratives ». Pour concrétiser cela, plusieurs mesures ont été prises notamment dans les domaines de l’urbanisme, de l’environnement, de la commande publique, dans les relations entre l’usager et l’administration. Ces dispositions concernent donc directement les collectivités territoriales.
La loi « Asap » vient donc transformer l’action publique. Elle est, tout d’abord, dans la continuité du mouvement de rationalisation du nombre de commissions obligatoirement consultées avant de prendre une décision administrative. Ce mouvement est à l’œuvre depuis le début des années 2000. L’objectif est une transformation du service public afin que les décisions administratives soient plus proches des territoires. De plus, cette loi permet la simplification de certaines démarches administratives. C’est notamment le cas de la dispense d’un justificatif de domicile pour l’obtention de plusieurs documents officiels ou encore de la simplification des formalités d’ouverture d’un livret d’épargne populaire. Enfin, les procédures administratives sont allégées concernant les entreprises qui avaient auparavant plus de contraintes. L’objectif est d’accélérer « les installations industrielles et de développer ou relocaliser l’activité et les emplois dans les territoires ».
Cependant, la loi « Asap » a donné lieu à de nombreux débats. En effet, le 3 décembre 2020, le Conseil constitutionnel avait été saisi par plus de soixante députés et a jugé le projet de loi partiellement non conforme à la Constitution. Cela s’est concrétisé par la censure de certains articles : on en compte 26 qui sont caractérisés de « cavaliers législatifs ». Au contraire, certains articles critiqués pour leurs incidences sur l’environnement ont été jugés par le Conseil constitutionnel comme ne méconnaissant pas la Charte de l’environnement. La loi « Asap » du 7 décembre 2020 comporte en définitive des dispositions très disparates, elle a été ainsi qualifiée comme une loi « fourre-tout ». Censée concilier simplification administrative et protection de l’environnement, elle a reçu de nombreuses critiques concernant sa réglementation environnementale. Dès lors, il convient de s’interroger sur le succès réel de cette simplification.
B. Le choc des titans : la colère du Palais-Royal ?
Source : CE, 16 décembre 2020, Fédération CFDT des Finances et autres, n° 440258
Le 16 décembre 2020 marque le dénouement d’une guerre de position entre le Palais-Royal et la rue de Montpensier. En cause ? La non-ratification des ordonnances par le Parlement, leur valeur et la compétence en cas de délai d’habilitation dépassé. En effet, le Gouvernement peut par ordonnance prendre des mesures du domaine de la loi (article 38 de la Constitution), par loi d’habilitation, alors que cela est réservé au Parlement (article 34 de la Constitution), provoquant une difficulté pour attaquer ces ordonnances devant les juridictions.
Acte 1 : Le 28 mai, le Conseil constitutionnel accorde la valeur législative aux ordonnances non ratifiées dont le délai est dépassé et issues de l’article 38, auparavant considérées comme des actes administratifs susceptibles de recours devant le Conseil d’État, en se fondant sur l’article 61-1.
Acte 2 : Le 1er juillet, la Haute Assemblée botte en touche, s’estimant compétente pour connaître d’un recours pour excès de pouvoir pour ces mêmes ordonnances.
Acte 3 : Le 3 juillet, le Conseil constitutionnel contre-attaque, suggérant dans une décision sans réel rapport que « leur conformité (…) ne peut donc être contestée que par une question prioritaire de constitutionnalité ».
Acte 4 : Le 28 septembre le Conseil d’État semble flancher et estime que la question de la conformité aux droits et libertés de ces ordonnances pas encore ratifiées « soit transmise au Conseil constitutionnel ».
Après huit mois rythmés par de franches oppositions et provocations, le 16 décembre marque la victoire partielle du Conseil constitutionnel. Le Conseil d’État retient en effet que la conformité des ordonnances « aux droits et libertés garantis par la Constitution devra être mise en cause devant le Conseil constitutionnel » par la voie de la QPC, lorsque le délai d’habilitation est expiré, tout en ajoutant qu’il est compétent en matière de contestation et de conformité d’une ordonnance au regard d’une loi d’habilitation, des engagements internationaux, des règles de forme, de procédure ou des principes généraux du droit, afin d’apporter une solution plus claire et simple pour les requérants. Outre la complexe articulation de cette décision avec certaines dispositions législatives et une légalité incomplète, il paraît nécessaire que le Conseil d’État entre de nouveau en scène, dans un « acte 5 » afin de permettre une véritable clarification.
II. Contentieux public
« Contest or not contest » : telle est la question
Source : CE, 12 juin 2020, GISTI, n° 418142
Une note d’actualité étant un document de portée générale, sans caractère décisoire, peut-elle faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et donc, d’une demande en annulation ? Telle a été la question posée au Conseil d’État, à l’occasion de la décision GISTI du 12 juin 2020, octroyant au soft law (droit souple), une toute nouvelle dimension. En effet, le soft law et les documents de portée générale émanent d’autorités publiques et ont des effets directs sur les relations entre l’Administration et les usagers, mais aussi, sur le public. Il semble alors logique d’accepter la possibilité d’un recours pour excès de pouvoir, permettant le contrôle d’un acte, même s’il ne s’agit pas d’une décision. Deux apports sont à retenir : d’une part, la création des actes administratifs appelés « documents de portée générale » et de l’autre, la précision des critères du contrôle de légalité par le juge administratif.
Preuve d’une continuité jurisprudentielle, à la suite de l’admission de cette possibilité pour les lignes directrices, les circulaires et les actes de droit souple des autorités de régulation (arrêts Fairvesta de 2016 et Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente de 2017), il faut y ajouter les « documents de portée générale » des autorités publiques, qu’ils soient matérialisés ou non, et qu’il s’agisse de « circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif ». Cela ne serait‑il pas une fusion des jurisprudences précédentes ?
Quatre critères de contrôle sont à retenir selon la Haute Assemblée : la « portée générale », l’émanation « d’autorités publiques », la nature et le support, et enfin, la justification principale, qu’ils soient « susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre (…), notamment par leur caractère impératif » ou ceux qui « présentent le caractère de lignes directrices ». Ainsi, si cette décision permet d’étendre le contrôle du juge administratif à des actes de droit souple, cela révèle de réelles difficultés, puisqu’il n’existe pas de liste exhaustive de documents ; alors, que contrôlera-t-il ? Cela demande donc une redéfinition de la recevabilité des requêtes et ouvre le risque à une augmentation du taux de recevabilité.
III. Droits et libertés
A. La limitation de l’exercice des libertés fondamentales en période de crise sanitaire
Sources : (1) CE, 18 mai 2020, La Quadrature du Net, n° 440442 ; (2) CE, 18 août 2020, M. E. et autres c./ministre des Solidarités et de la Santé, n° 442581 ; (3) CE, 16 octobre 2020, LC Sport et autres, n° 445102 ; (4) CE, 23 décembre 2020, M. Y. et autres c./ministre des Solidarités et de la Santé, n° 447698.
L’année 2020, riche en restrictions liées à l’épidémie de Covid-19, a donné lieu à de nombreux recours en référé-liberté, consacrant notamment quatre nouvelles libertés fondamentales : le droit à la protection des données personnelles (1), le droit pour un ressortissant français d’entrer sur le territoire français (2), la liberté de pratiquer un sport (3) et la liberté de création artistique et d’accès aux œuvres culturelles (4). En raison de la situation d’urgence sanitaire, le Conseil d’État a été amené à produire une jurisprudence mesurée, devant allier la protection des libertés fondamentales à la prévention des effets de l’épidémie par des mesures nécessaires, adaptées et proportionnées. Dans une décision du 18 mai 2020, les juges du Palais-Royal se sont prononcés sur la violation du droit à la protection des données personnelles (composante du droit au respect de la vie privée) par la préfecture de police de Paris qui procédait à une surveillance par drones. Bien qu’une telle surveillance puisse être justifiée par la prévention des effets de l’épidémie, le Conseil d’État a retenu le manque de garanties quant au respect du règlement général sur la protection des données (RGPD), résultant de l’absence de base juridique, pour enjoindre à l’État d’arrêter cette surveillance par drones.
Dans une autre décision du 23 décembre 2020, le Conseil d’État a été amené à se prononcer sur le caractère proportionné d’un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture des salles de sport. Contre l’avis du ministre des Solidarités et de la Santé, le juge du référé a affirmé que la liberté de pratiquer un sport participait du droit au respect de la liberté individuelle. La proportionnalité de cette liberté fondamentale désormais reconnue doit cependant, là encore, être appréciée au regard de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 : la haute juridiction administrative a confirmé la légalité de l’interdiction, appropriée à l’objectif visé, la garantie de son effectivité résidant dans sa simplicité et sa lisibilité par le public. Si le Conseil d’État ne faillit pas à son devoir de reconnaître les libertés fondamentales, il apparaît néanmoins difficile pour ce dernier d’en assurer l’effectivité en période de pandémie. La recherche d’équilibre entre sécurité sanitaire et garantie des libertés se révèle, après un an d’exercice, toujours périlleuse.
B. Confirmation de l’illégalité de la surveillance policière par drones
Source : CE, 22 décembre 2020, La Quadrature du Net, n° 446155
Le juge des référés du Conseil d’État a suspendu, à la demande de l’association La Quadrature du Net, l’exécution de la décision du préfet de police de Paris concernant la prise de clichés photographiques diffusés par la presse montrant que la police utilise toujours des drones à des fins de police administrative. En effet, le juge retient qu’en l’absence d’encadrement législatif, le dispositif de surveillance par drones transmettant des images à la préfecture de police de Paris pour un visionnage en temps réel constitue un traitement illégal de données à caractère personnel.
Le Conseil d’État, par une ordonnance du 22 décembre 2020, vient rappeler les limites fixées au recours par la puissance publique à des aéronefs. Le juge s’appuie sur la directive 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel de l’Union européenne. Il est important de rappeler que les données à caractère personnel désignent « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ». De ce fait, le Conseil d’État considère que le dispositif de surveillance mis en place par la préfecture de police, au regard de ses caractéristiques et de la finalité qu’il poursuit, relève du champ d’application matériel de la directive. De plus, le juge s’est déjà attardé sur le sujet, puisqu’il a ainsi précisé que l’emploi des drones de surveillance couplé à un système de traitement de données personnelles pouvait être légal, mais sous deux conditions (v. ci-dessus, CE, 18 mai 2020, La Quadrature du Net, n° 440442). La première est de se conformer à l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés qui impose de recourir à un arrêté autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel. La seconde condition consiste à doter les appareils embarqués de dispositifs techniques de nature à rendre impossible l’identification des personnes filmées. Le Conseil d’État a estimé que seul le législateur pouvait fixer les conditions d’usage des caméras aéroportées par l’Administration le 20 octobre 2020. Il n’est donc pas étonnant que la haute juridiction administrative censure le dispositif utilisé par la préfecture de police en attendant qu’un encadrement législatif voie enfin le jour.
C. Surpopulation carcérale et absence de recours effectif, la France condamnée pour ses prisons indignes
Source : CEDH, 30 janvier 2020, J.M.B. et autres c/France, n° 9671/15 et 31 autres.
Saisie de 32 requêtes individuelles de personnes incarcérées en Martinique, en Polynésie, en Guadeloupe, à Nîmes, Nice et Fresnes, par un arrêt du 30 janvier 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France pour violations de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison de traitements inhumains et dégradants du fait des conditions de détention, et de l’article 13 compte tenu du non-respect du droit à un recours effectif.
La Cour opère en deux temps. En premier lieu, elle a détaillé pour chaque établissement les conditions insalubres et la surpopulation en déplorant notamment un taux d’occupation jusqu’à 213,7 %, mais aussi la présence de nuisibles ou l’insuffisance de nourriture. Ainsi, la Cour invite la France à prendre des mesures générales pour améliorer les conditions de détention et mettre fin à la surpopulation carcérale. Si cet arrêt est important en ce qu’une instance européenne reconnaît la défaillance et le caractère inhumain du système carcéral français, sa portée est nuancée car la Cour n’a pas adopté la procédure de l’arrêt pilote, mise en place par son arrêt Broniowski c/Pologne (CEDH, Gde ch., 22 juin 2004, Broniowski c/Pologne, n° 31443/96). Cette procédure permet d’identifier des problèmes structurels relatifs à des affaires répétitives et de demander aux États concernés de les traiter. Dès lors, la Cour aurait pu donner des indications sur les mesures de redressement à prendre par l’État français. En second lieu, la Cour constate l’ineffectivité des voies de recours offertes aux détenus. Effectivement, elle estime que le référé‑liberté est inefficace en raison de la portée limitée du pouvoir d’injonction notamment, car il n’est pas de l’office du juge des référés de prononcer des mesures structurelles. Cette impossibilité découle du principe de la séparation des pouvoirs empêchant le juge de faire des choix de politique publique ou de se prononcer sur des choix de société. En conséquence, des améliorations sont attendues, mais seule une refonte systémique permettrait de corriger les défauts de l’administration pénitentiaire. Or il semble légitime de se demander si ces mesures isolées seront suffisantes…
D. Les Français ne feront pas de ski à l’étranger
Source : CE, 17 décembre 2020, Ligue des droits de l’homme, n° 447431
La fin d’année 2020 n’aura pas échappé à la pandémie de Covid-19. Pour faire face à l’épidémie, le Premier ministre Jean Castex a jugé nécessaire d’interdire aux Français de se rendre dans les stations de sport d’hiver à l’étranger pour pratiquer le ski. Par une requête enregistrée le 10 décembre 2020, la Ligue des droits de l’Homme a demandé au juge des référés du Conseil d’État d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du Premier ministre. Elle soutient que la décision prise lors de l’interview du Premier ministre méconnaît « le principe de proportionnalité, qu’elle engendre une rupture d’égalité entre les personnes qui auraient pratiqué le ski à l’étranger et celles qui s’y seraient rendues pour d’autres motifs, et qu’elle est entachée d’un détournement de pouvoir ».
Par la décision du 17 décembre 2020, le Conseil d’État a jugé que la mesure du Premier ministre interdisant aux Français la pratique du ski à l’étranger, a pour objet d’éviter que cette pratique n’aboutisse à propager et à faire augmenter le nombre de victimes du Covid-19. Ainsi, pour le Conseil d’État, cette mesure ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, à la liberté d’aller et venir et à la libre circulation, mais elle répond à un motif sanitaire, qui fait partie de l’ordre public, et apparaît proportionnée à l’objectif poursuivi. Par conséquent, le Conseil d’État a rejeté la requête de la Ligue des droits de l’Homme. En effet, dans certaines circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut prendre certaines mesures afin de limiter les risques de transmission de la Covid-19, ceci conformément au Code de la santé publique. Le juge rappelle les dangers du virus, qualifié d’urgence de santé publique de portée internationale par l’OMS, conduisant le gouvernement à prendre des mesures allant jusqu’à la prorogation de l’état d’urgence sanitaire. Ainsi, la mesure du Premier ministre visant à éviter la propagation du virus ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés invoquées. Par ailleurs, l’existence d’un détournement de pouvoir ne peut qu’être écartée notamment du fait d’une marge de manœuvre laissée aux préfets. Pour conclure, l’épidémie de Covid-19 illustre bien, une nouvelle fois, qu’il est souvent difficile de concilier les notions de liberté et de sécurité en France.
E. Lieux de culte : pas plus de 30 fidèles ou ça cloche ?
Source : CE, ord., 29 novembre 2020, Association pour la messe CIVITAS, n° 446930
Prenant en considération l’évolution de la situation sanitaire inédite, le Premier ministre a fixé dans le décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020, à l’article 47, une limite de trente personnes lors des cérémonies religieuses dans les lieux de culte, accordant ainsi un assouplissement des mesures. En effet, le Conseil d’État avait confirmé l’interdiction de se rendre dans les lieux de culte et de s’y rassembler, durant le confinement, le 7 novembre 2020.
En se basant sur l’article L. 521-2 du CJA, était-il possible d’avoir accès au référé-liberté ? Concernant l’atteinte grave à une liberté fondamentale, la liberté de culte est retenue comme une liberté fondamentale. Pour la condition de l’urgence, les juges du Palais-Royal retiennent que les fidèles ne pourront, pour certains, plus participer aux activités, en raison des limites de fréquentation imposées, malgré une amélioration de la situation sanitaire. Enfin, au sujet de l’atteinte manifestement illégale, la nécessité est écartée puisque « les cérémonies religieuses exposent à un risque de contamination (…) dans un espace clos, de taille restreinte, pendant une durée importante, avec un grand nombre de personnes » qui chantent, se déplacent et sont en contacts physiques. Une réglementation semble donc nécessaire, au vu de la situation sanitaire, tout en étant conciliée avec la liberté de culte. La décision du Conseil d’État s’établira avec la proportionnalité, puisqu’aucune autre activité ne se voit limitée par un tel plafond alors que les rassemblements ayant pour limite six personnes n’ont pas les mêmes caractéristiques étant fondés sur la superficie des locaux. La particularité, quelle que soit la taille du lieu de culte, n’étant pas une justification, le critère est donc disproportionné et porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte. Le Conseil d’État enjoindra au Premier ministre de modifier les dispositions dans un délai de trois jours. Cette jurisprudence permet une rare consécration d’une liberté face à une composante de l’ordre public : la salubrité publique. Les circonstances en l’espèce sont le critère retenu pour justifier une telle position, cela peut donc être critiqué, notamment, dans le cadre d’une situation sanitaire nationale inédite. Ne faudrait-il pas craindre des solutions jurisprudentielles au cas par cas ?
F. La Covid : l’illégalité de l’interdiction des soins de conservation du corps et de toilette mortuaire
Source : CE, 22 décembre 2020, Mmes A…, G…, D..., F..., C…, E... et B..., H… et MM. Gilles Guyon et Pierre Boileau, n° 439804
La décision s’inscrit dans une réponse globale donnée par le Conseil d’État. Elle s’étend, en effet, sur les sujets tels que le respect du principe d’égalité concernant le fonds de solidarités, mais également les soins des défunts probablement atteints de la Covid-19 au moment de leur décès. Le Haut Conseil de la santé publique recommandait, par son avis du 24 mars, d’effectuer des pratiques strictes de règles d’hygiène et de mesures de distance physique. Aussi les dispositions du décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 interdisant les soins de conservation sur le corps des défunts et la pratique de la toilette mortuaire pour les personnes décédées de la Covid-19 ont porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit à une vie privée et familiale.
Il convient de relever que le gouvernement n’a pas suivi l’avis du Haut Conseil dans sa totalité. En effet, le gouvernement n’a pas apporté d’élément de nature à justifier d’imposer, de façon générale et absolue, les restrictions prévues par le décret, selon le Conseil d’État. Le Gouvernement n’a pas suivi l’avis du Haut Conseil concernant les possibilités envisageables, par manque de temps très certainement. Mais il faut rappeler que l’avis fut ignoré concernant les conditions de pratiques religieuses et rituelles vis-à-vis de la toilette du corps des défunts. En effet le Haut Conseil proposait que le personnel en charge de la toilette soit équipé d’une tenue de protection adaptée, hospitalière ou funéraire, mais également de laisser la possibilité aux proches de voir le visage de la personne décédée dans la chambre hospitalière ou funéraire, tout en respectant les mesures barrières. La haute juridiction administrative par cette décision permettra de rendre, peut-être, plus supportable la perte d’un être cher sans avoir eu l’occasion de lui dire adieu.
G. Respect du droit à la défense : pas de vidéoconférence pour les cours d’assises et les cours criminelles
Source : CE, ord., 27 nov. 2020, ADAP et autres, n° 446712
L’État de droit aura été malmené durant la pandémie de la Covid-19 et en particulier nos institutions. La fermeture des tribunaux et leurs réouvertures furent difficiles, tant dans la détresse habituelle dans laquelle sont plongés nos tribunaux, tant sur les difficultés d’application des procédures dans une situation sanitaire difficile. C’est dans ce contexte que le recours à la visioconférence après la fin de l’instruction à l’audience devant les juridictions criminelles, plus particulièrement lors du réquisitoire de l’avocat général et des plaidoiries des avocats, a été adopté afin de respecter le protocole sanitaire et de permettre d’éviter le report des audiences.
Cependant, le Conseil d’État, dans un arrêt du 27 novembre 2020, retiendra que le recours à la vidéoaudience porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et au droit à un procès équitable. Par conséquent le juge des référés a donc suspendu l’exécution des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020, introduite dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Il est important de noter que l’article 4 de cette ordonnance est quant à lui bien maintenu. Les dispositions de l’article 4 permettent de maintenir les restrictions de l’accès du public aux audiences car elles ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et au droit à un procès équitable. En effet, le Conseil d’État considère que les restrictions apportées ne concernent pas les journalistes, de ce fait l’information du public sur la teneur des débats permet d’assurer une publicité suffisante. Enfin, le juge rappelle de manière liminaire qu’il appartient aux magistrats de s’assurer que ces restrictions soient justifiées et proportionnées au moment de l’audience. Or que peut-on penser des décisions récentes de certains magistrats limitant totalement le réquisitoire de l’avocat général et les plaidoiries des avocats du Tribunal de Grande Instance de Cusset, en guise de simple exemple ?
IV. Environnement
A. La protection de l’environnement : un nouvel objectif à valeur constitutionnelle
Source : CC, 31 janvier 2020, Union des industries de la protection des plantes, n° 2019-823 QPC
Une question prioritaire de constitutionnalité, soulevée par l’Union des industries de la protection des plantes, a été transmise par la haute juridiction administrative au Conseil constitutionnel. Étaient en cause les dispositions de l’article L. 253-8 (IV) du Code rural et de la pêche maritime. Elles ont pour objectif d’interdire la production, le stockage et la circulation en France des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées au niveau européen pour leurs effets sur la santé humaine, animale ou l’environnement. Le recours pour excès de pouvoir initial était précisément dirigé contre une circulaire du 23 juillet 2019 précisant les modalités de mise en œuvre de l’interdiction.
Par sa décision du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel a écarté le grief de l’Union et déclaré par là même les dispositions législatives conformes à la Constitution. De surcroît, le Conseil a déduit l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains, des termes de la Charte de l’environnement et a rappelé celui de la protection de la santé. En effet, la conciliation réalisée entre la liberté d’entreprendre et les objectifs à valeur constitutionnelle de protection de l’environnement et de la santé n’était pas manifestement déséquilibrée.
Si cette décision reste à confirmer pour donner toute sa portée à ce nouvel outil, la protection de l’environnement semble être un sujet en vogue politiquement. Néanmoins, il semble opportun de veiller à ne pas l’instrumentaliser. Par exemple, lundi 14 décembre 2020, le président de la République a annoncé son souhait d’un référendum pour intégrer la défense du climat et la préservation de l’environnement dans la Constitution. Or cette protection est déjà globalement assurée par l’intégration de la Charte de l’environnement de 2004 dans le bloc de constitutionnalité, mais également par la jurisprudence qui tend à se faire de plus en plus volontariste, comme le montre la décision commentée. Plutôt que d’inscrire des dispositions superfétatoires, assurer une plus grande effectivité de celles qui existent déjà semble préférable. Une systématisation de la jurisprudence pourrait se révéler plus adéquate pour que les déclarations politiques se concrétisent juridiquement.
B. Lutter contre le gaspillage et pour l’économie circulaire
Source : Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire
La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a pour objectif selon un communiqué de presse du Conseil des ministres du 10 juillet 2019 « d’accélérer le changement des modèles de production et de consommation afin de réduire les déchets et préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat ». Cette loi s’inscrit donc dans la mise en œuvre de la Charte de l’environnement de 2004. Elle compte 130 articles. On peut voir qu’elle a été nettement modifiée et approfondie lors des travaux parlementaires, car le projet de loi du Gouvernement ne comprenait que 13 articles. Pour résumer, la loi s’articule autour de plusieurs grandes orientations : sortir du plastique jetable, mieux informer les consommateurs, lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire, agir contre l’obsolescence programmée et enfin, mieux produire.
Le texte de loi entend répondre aux attentes formulées lors du grand débat national lancé le 15 janvier 2019 par le président de la République dans le contexte du mouvement des Gilets jaunes. En effet, lors de ce débat, certaines problématiques ont été soulevées notamment concernant la protection de l’environnement. Cela vient confirmer l’intérêt que portent les Français pour les questions environnementales, abordées avec la feuille de route économie circulaire qui avait été dévoilée le 23 avril 2018 par l’ancien Premier ministre, Édouard Philippe. Elle venait déjà présenter des mesures qualifiées de « concrètes » pour engager la transition de la France vers une économie circulaire. Ces revendications expriment un mécontentement des Français face au gaspillage, aux déchets abandonnés, à la surconsommation de plastiques, à l’obsolescence programmée des produits et tant d’autres questions relatives à l’environnement. Cette loi s’inscrit donc pleinement dans le mouvement de valorisation des questions environnementales initié par la Charte de l’environnement de 2004. Cette loi pourrait demeurer comme l’une des plus importantes en matière environnementale de notre législature actuelle.
C. Qualité de l’air : le Conseil d’État prononce une astreinte record à l’encontre de l’État
Source : Conseil d’État, Ass., 10 juillet 2020, Association Les amis de la Terre, n° 428409
Par une décision du 10 juillet 2020, le Conseil d’État a décidé de prononcer une astreinte de 10 millions d’euros par semestre à l’encontre de l’État tant qu’il n’aura pas pris les mesures ordonnées concernant la qualité de l’air. Le 2 octobre 2018, plusieurs associations de défense de l’environnement ont demandé au Conseil d’État de constater que les mesures nécessaires concernant la pollution de l’air, conformément à l’article 23 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen, n’avaient pas été mises en œuvre par le Gouvernement et, par conséquent, de prononcer une astreinte pour le contraindre à exécuter cette décision. En effet, cet arrêt fait suite à une décision du 12 juillet 2017, dans laquelle le Conseil d’État a enjoint au Gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soit élaboré et mis en œuvre un plan relatif à la qualité de l’air concernant certaines zones. Ce plan doit permettre de ramener les concentrations en dioxyde d’azote et en particules fines PM10 sous les valeurs limites fixées par la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008, qui a été transposée en droit interne à l’article R. 221-1 du Code de l’environnement.
En l’espèce, on peut constater que les éléments mettent en évidence un dépassement persistant des valeurs limites pour huit zones s’agissant du dioxyde d’azote et pour trois zones s’agissant des particules fines. De plus, le Gouvernement a adopté quatorze feuilles de route, dans lesquelles il n’y a aucune estimation de l’amélioration de la qualité de l’air, malgré les préconisations législatives. De plus, il n’y a aucune précision concernant les délais prévus pour la réalisation de ces objectifs. Le Conseil d’État indique que « l’État ne peut être regardé comme ayant pris des mesures suffisantes propres à assurer l’exécution complète de cette décision ». Par conséquent, le Conseil d’État a décidé de prononcer contre l’État une astreinte de 10 millions d’euros par semestre tant qu’il n’aura pas pris les mesures qui lui ont été ordonnées. Cette décision record n’est pas la seule en matière climatique. En effet, cet arrêt du Conseil d’État s’inscrit dans un contexte où apparaissent des contentieux de plus en plus nombreux, et parfois fructueux.
D. Inaction climatique : l’État assigné en justice
Source : CE, 19 novembre 2020, Commune de Grande-Synthe, n° 427302
La préoccupation des Français pour la protection de l’environnement s’est illustrée en 2020 par un flot médiatique autour des « décrocheurs de portraits », des militants climatiques partis à l’assaut des effigies d’Emmanuel Macron dans des mairies pour pointer la responsabilité du président de la République. Dans le même temps, « l’affaire du siècle » prenait de l’ampleur. Après rejet par le Gouvernement d’une demande préalable indemnitaire adressée fin 2018, les associations Fondation pour la nature et l’homme, Greenpeace France, Notre affaire à tous et Oxfam France avaient intenté un recours devant le tribunal administratif de Paris le 14 mars 2019 pour inaction de l’État en matière climatique. Le Gouvernement, par la voix du ministre de la Transition écologique, a alors déposé un mémoire en défense le 23 juin 2020 concluant au rejet de la requête, réfutant l’ensemble des accusations portées par les quatre associations.
Si l’audience, initialement prévue le 2 juillet 2020, sera finalement reportée au 14 janvier 2021 — et aboutira à la reconnaissance par le tribunal administratif de Paris de carences fautives de l’État « dans le respect de ses engagements en matière de lutte contre le changement climatique » —, elle fait surtout écho à la décision historique du Conseil d’État dans « l’affaire de Grande-Synthe ». À l’initiative de l’action, le maire de la commune de Grande-Synthe avait demandé en 2018 au Gouvernement et au président de la République de prendre des mesures supplémentaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et ainsi respecter les engagements climatiques de la France. Après un refus implicite de leur part, l’édile du Nord a engagé un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État, qui a sursis à statuer en novembre 2020. Bien que l’affaire n’en soit probablement qu’à ses débuts, la décision de la haute juridiction administrative n’en est pas moins inédite et prometteuse.
Ainsi, en reconnaissant la recevabilité du recours de la commune de Grande-Synthe — appuyée, notamment, par les villes de Paris, Grenoble et les ONG initiatrices de « l’affaire du siècle » —, le Conseil d’État a observé, sur le fond, que malgré ses engagements, les plafonds d’émission de GES étaient régulièrement dépassés par la France et que les efforts souscrits avaient pour l’essentiel été reportés à l’après-2020. À défaut, pour le moment, d’une injonction au Gouvernement de diminuer ses émissions, à l’instar de la retentissante décision Urgenda c/État des Pays-Bas de la Cour suprême de La Haye en 2015, les juges du Palais-Royal ont donné un délai de trois mois au Gouvernement pour justifier la compatibilité de ce refus implicite avec le respect des engagements de la France à horizon 2030. Vu le délai désormais très court pour tenir les objectifs 2030 de la France en matière de protection de l’environnement, la seule solution pour le climat semble aujourd’hui demeurer dans la perspective de décisions fortes du Conseil d’État, au risque de raviver le spectre d’un « gouvernement des juges »…
E. Protection de l’environnement : une année de bilans et de propositions
Sources : (1) Convention citoyenne pour le climat (2) Bilan du CESE du 23 octobre 2020 « Bilan de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages »
2020 a été une année riche de chantiers en matière de protection de l’environnement, à l’instar notamment de la constitution d’une Convention citoyenne pour le climat annoncée par le président de la République durant la crise des « Gilets jaunes ». (1) Cette Convention est innovante à bien des titres : création sui generis d’une instance réunissant cent cinquante citoyens tirés au sort et devant représenter la société française dans sa diversité, réunis au Palais d’Iéna à Paris, dont les travaux — dans un premier temps indemnisés par l’État — doivent aboutir à des propositions transposables par voie réglementaire, législative ou référendaire. Le travail de la Convention s’est matérialisé, en juin 2020, par un rapport de cent quarante-neuf propositions remis à la ministre de la Transition écologique et solidaire.
Si la mise en œuvre d’une partie de ces mesures a été annoncée par le Gouvernement à l’issue des travaux, certains espoirs s’estompent néanmoins pour ces néo-conventionnés : rejet de certaines propositions par le président de la République (trois initialement), et transcription a minima de nombre d’autres dans les projets règlementaires et législatifs élaborés par l’exécutif. Reste, pour l’année 2021, à voir la réalité de ces retranscriptions dans les lois de finances 2021 (qui octroie un tiers du budget de l’État au nouveau Plan de relance, un « budget vert » selon le Gouvernement) et projet de loi climat et résilience. Du côté de la symbolique, le chef de l’État s’est également engagé à proposer par référendum l’inscription du climat et de la biodiversité à l’article 1er de notre Constitution, malgré la Charte de 2004 qui lui est déjà adossée.
(2) En tout état de cause, à en croire le Conseil économique, social et environnemental, ces innovations ne seront pas de trop ! Dans son rapport du 23 octobre 2020, l’hériter du Conseil national économique dresse un Bilan de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages très négatif. Notamment, il étrille « le caractère très lacunaire de [la] mise en œuvre » de la loi de 2016, pointant des « carences particulièrement préoccupantes dans les outre-mer ». Le Conseil, finalement, conclut que la reconquête naguère annoncée n’est « pas amorcée », les outils nécessaires étant demeurés « largement virtuels ». Alors, peut-être les nouveautés législatives seront-elles, cette fois, à la hauteur des enjeux identifiés. Une attente à tempérer cependant, tant l’étude d’impact gouvernemental sur le projet de loi climat et résilience ne laisse espérer, dans le meilleur des cas, atteindre seulement la moitié — voire les deux tiers — des objectifs fixés d’ici 2030.
V. Institutions
Nouvelle victoire du « non » au référendum du 4 octobre 2020 concernant l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie. Jamais deux sans trois ?
À la suite de la signature de l’accord de Nouméa le 5 mai 1998, un référendum d’autodétermination devait être organisé d’ici 2018, posant la question : « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? ». Cet accord a prévu la possibilité d’organiser deux autres référendums en cas de résultats négatifs. Ainsi, après un premier référendum organisé le 4 novembre 2018 avec une victoire du « non » à 56,40 % des électeurs, le deuxième vote du 4 octobre 2020 est allé dans le même sens, mais avec une majorité en baisse en réunissant 53,26 % des électeurs. Dès lors, un troisième référendum pourra être organisé à la demande d’un tiers des élus du Congrès à partir du 4 avril 2021. Or cette situation semble fort probable. En effet, le Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) estime que le « oui » a le vent en poupe à la suite de sa progression.
Partant, différentes perspectives sont envisageables. Dans une première hypothèse, si le « non » l’emporte en 2022, les partenaires politiques se réuniront pour examiner la situation ainsi créée. Toutefois, il existe une certitude sur le fait que la France ne récupérera aucune compétence étant donné que l’article 77 de la Constitution de 1958 évoque « les compétences de l’État qui seront transférées de façon définitive ». Dans une seconde hypothèse, si le « oui » l’emporte, la Nouvelle-Calédonie deviendra un État indépendant, acquérant sa souveraineté après une période de transition et la citoyenneté néo‑calédonienne deviendra une nationalité. Néanmoins, les réflexions menées sur cette hypothèse n’envisagent pas de rupture avec la République française. Ainsi, un partenariat privilégié avec la France ou une autonomie renforcée semblent privilégiés mais, quelle que soit l’issue, l’exercice des compétences régaliennes semble difficilement réalisable à court terme sans une association étroite avec la France. Enfin, ces référendums pourraient susciter l’intérêt de territoires souhaitant une autonomie renforcée à l’image de la Polynésie française. Cette dernière pourrait alors être incitée à réclamer un statut équivalent à la Nouvelle-Calédonie en cas de réponse négative au référendum et donc de la fin de son statut transitoire.
VI. Service public
A. Une cantine pour tous : à prendre ou à laisser ?
Source : CE, 11 décembre 2020, Ligue de défense judiciaire des musulmans, n° 426483
Si la France est une République laïque, comme posé par l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, la conciliation entre le principe de laïcité, garanti par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905, et le service public, demeure un sujet récurrent et d’actualité. En 2015, le conseil municipal de Chalon-Sur-Saône a mis un terme à la tradition trentenaire de la collectivité de proposer un menu de substitution dans les cantines scolaires, dès qu’un plat contenant du porc était servi. Cela au motif que « le principe de laïcité interdit la prise en considération de prescriptions d’ordre religieux dans le fonctionnement d’un service public », imposant donc un plat unique, quels que soient les aliments proscrits par les convictions religieuses des enfants.
Après l’annulation de cette décision par le tribunal administratif de Dijon et la Cour administrative d’appel de Lyon, les juges du Palais-Royal se sont prononcés le 11 décembre 2020. Ils ont retenu, d’une part, qu’il « n’existe aucune obligation pour les collectivités territoriales gestionnaires d’un service public de restauration scolaire de distribuer à ses usagers des repas différenciés leur permettant de ne pas consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses » et, d’autre part, que cela n’est pas non plus un droit, notamment opposable aux principes de neutralité et d’égalité des usagers devant le service public. Confirmant les précédentes décisions, il s’agit donc d’une faculté pour la collectivité territoriale, afin de garantir aux enfants la possibilité d’un bon fonctionnement du service public et un accès à un menu équilibré. De plus, le Conseil d’État rappelle la nécessaire prise en considération de l’intérêt général, lors de la redéfinition de règles, particulièrement, alors qu’une telle faculté avait été concédée auparavant, dans l’intérêt d’un égal accès au service public et non pas, si la décision se fonde seulement sur le principe de laïcité et de neutralité du service public. Subséquemment, il convient alors de comprendre la neutralité comme une renonciation à un choix dans les menus et donc, à l’appréhender comme une discrimination indirecte.
B. Apprendre ou à payer ?
Source : CE, 1er juillet 2020, Association UNEDESEP et autres, n° 430121
L’arrêté interministériel du 19 avril 2019 prévoyant la hausse des frais d’inscription à l’université des étudiants étrangers extracommunautaires, en mobilité internationale, a connu de nombreuses controverses médiatiques. Des syndicats se sont élevés contre cet arrêté, du plan « Bienvenue en France », d’Édouard Philippe, le coût d’un master ou doctorat passant de 243 euros et 380 euros à 3 770 euros, et de 170 euros à 2 770 euros pour une licence. Les bases légales retenues ont été les principes constitutionnels de « gratuité de l’enseignement supérieur public » et de « l’égal accès à l’instruction », rappelés par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 11 octobre 2019, émanant du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Cependant, une réserve quant à des « frais d’inscription modiques » a été reconnue. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel ne précise pas les frais d’inscription fixes ; ainsi, lui a été reproché par des juristes le fait de ne pas aller au bout de ses idées, laissant le « sale boulot » au Conseil d’État.
Cependant, a été retenu par le Conseil d’État que, s’agissant des étudiants en mobilité internationale, les droits d’inscription peuvent représenter 30 % à 40 % du coût de la formation ; ces mêmes étudiants pouvant bénéficier d’aides ou d’exonérations, cela ne fait pas obstacle au principe d’égal accès à l’instruction. Quid du principe de « gratuité de l’enseignement » ? Premièrement, ce principe ne s’applique qu’aux formations donnant lieu à un diplôme national, comme les licences, masters ou doctorats. Les diplômes autonomes ou d’ingénieur n’entrent pas dans le domaine du principe. Secondement, cette augmentation s’applique aux étudiants étrangers, ne provenant pas d’un pays européen ou étant déjà résidents en France. Subséquemment, pour le Conseil d’État, les étudiants en mobilité internationale n’ont pas vocation à s’établir en France définitivement ou durablement, puisqu’ils viennent pour se former, ce qui justifie donc des frais d’inscription qui diffèrent et ne font pas obstacle aux principes.
Ainsi, cette décision permet plusieurs apports : la consécration d’une différence entre étudiants nationaux et étudiants en « mobilité internationale », une précision sur le champ d’application du principe d’égal accès à l’instruction et l’exigence de gratuité. Il permet aussi l’existence d’exceptions, avec la notion de « frais modiques ». Cependant, que sont des « frais modiques » ? L’interprétation juridique peut être très constructive.
C. Football : fin de la saison sifflée par le Conseil d’État et mise hors-jeu des clubs d’Amiens, Toulouse et Lyon
Sources : CE, ord., 9 juin 2020, n° s 440809, 440813 et 440824, Olympique Lyonnais Groupe et autres, SASP Toulouse Football Club et SASP Amiens SC ; CE, ord., 9 juillet 2020, n° s 441559 et 441585, Société Amiens Sporting Club Football.
En avril 2020, le gouvernement a annoncé la fin des compétitions de sports collectifs professionnels en raison de l’épidémie de Covid-19. Par suite, le conseil d’administration de la Ligue de Football professionnel (LFP) a prononcé la fin de la saison 2019-2020. Elle a figé le classement des championnats de ligue 1 et de ligue 2 sur la base d’un « indice de performance », c’est-à-dire un quotient prenant en compte le nombre de points obtenus et le nombre de rencontres disputées. En outre, la Ligue a décidé de reléguer en deuxième division les clubs d’Amiens et de Toulouse, plutôt que d’organiser un championnat à 22 clubs l’année suivante.
Partant, l’Amiens Sporting Club, le Toulouse Football Club et l’Olympique Lyonnais se sont sentis lésés. Les deux premiers ont invoqué leur relégation tandis que le troisième a déploré la privation d’une participation à une compétition européenne, un enjeu sportif et financier. Ils ont alors saisi le Conseil d’État sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative. Par une ordonnance du 9 juin 2020, la haute juridiction administrative a rejeté les requêtes à l’encontre des décisions mettant fin à la saison et enregistrant le classement de la ligue 1 et de la ligue 2 de football, mais a suspendu les relégations des clubs concernés. Effectivement, le juge des référés a énoncé que la convention liant la LFP à la Fédération française de Football (FFF) et fixant le nombre de clubs en première division à 20 arrivait à échéance le 30 juin 2020. Dès lors, la LFP ne pouvait pas légalement se fonder sur ce texte. Il a donc enjoint à la Ligue, en lien avec la Fédération, de réexaminer la situation avant le 30 juin et rejeté la requête de l’Olympique Lyonnais. Prenant acte de la décision, le 26 juin 2020, une nouvelle convention liant la LFP à la FFF a prévu un maintien de la Ligue 1 à 20 clubs, reléguant de facto les clubs de Toulouse et d’Amiens.
Le club d’Amiens a alors demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre l’exécution des décisions en question. Finalement, dans une ordonnance du 9 juillet 2020, ce dernier a considéré que les décisions contestées n’ont méconnu ni les principes d’égalité et d’équité sportive ni le principe de sécurité juridique en rappelant qu’il appartenait au conseil d’administration de la Ligue de football de « déterminer, dans le cadre de son pouvoir réglementaire, les conséquences à tirer de l’interruption des championnats ». En statuant de la sorte, le Conseil d’État a donc conforté les décisions mettant fin à la saison, figeant les classements et prononçant les relégations. Ces décisions illustrent parfaitement la complexité de la mission d’organisation des compétitions par les fédérations sportives délégataires d’un service public lorsque se mêlent des enjeux économiques et sanitaires sans précédent.
VII. Responsabilité
Amiante : responsabilité de l’État pour faute simple de l’inspection du travail
Source : CE, 18 décembre 2020, ministre du Travail c/M. B., n° 437314
Mettant fin à quatre années d’intenses contentieux pour les salariés des Chantiers navals de La Ciotat et La Seyne-sur-Mer, le Conseil d’État a admis dans une ultime cassation la possibilité d’engager la responsabilité de l’État pour faute simple dans sa mission d’inspection du travail. Une jurisprudence fournie était déjà établie depuis les premiers arrêts du 3 mars 2004 reconnaissant la responsabilité de l’État dans l’exposition des salariés à l’amiante. Ces décisions distinguaient entre les faits antérieurs et postérieurs au premier décret réglementant l’usage de l’amiante du 17 août 1977 : d’abord, pour absence de réglementation (inapplication des principes de précaution et de prévention), ensuite, en raison d’une réglementation insuffisante et de carences de l’État dans la prévention des risques. Chaque fois, la responsabilité a pu être partagée (ou écartée s’agissant de l’État), faute de protection suffisante mise en place par l’employeur.
Le 18 décembre 2020, les juges du Palais-Royal ont rendu une nouvelle décision étendant la responsabilité de l’État en la matière, en raison d’une « carence fautive dans le contrôle du respect de la réglementation destinée à prévenir les risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante » qui aurait dû être entrepris par l’inspection du travail. Le Conseil d’État précise notamment la « large marge d’appréciation dans le choix des moyens juridiques » offerte à l’inspection du travail pour « assurer l’application effective des dispositions légales », sans que ne soit nécessitée sa saisie par les salariés. La carence résidant dans l’absence de contrôle de l’application de la réglementation par l’employeur peut ainsi être analysée comme constitutive d’une faute simple de l’État à même d’engager sa responsabilité. Cependant, cette nouvelle décision semble plus illusoire qu’efficace en matière d’indemnisation : en rejetant tout lien de causalité entre le préjudice et la carence de l’inspection du travail, l’abandon de la faute lourde n’apparaît pas suffisant pour assurer la réparation par l’État.