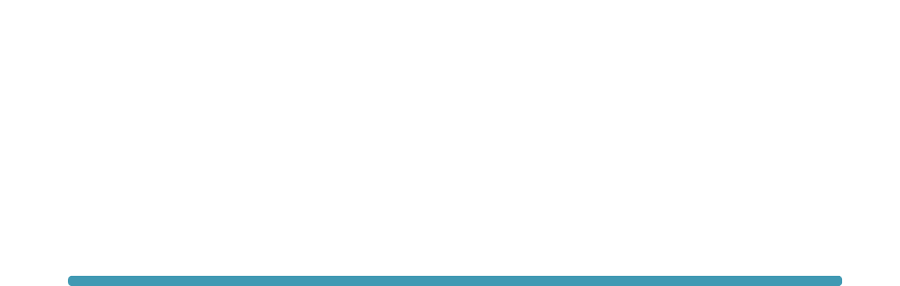Quand les sociétés étaient holistes, tout était « bien commun », attaché à des communautés diverses et emboitées, il n’y avait pratiquement pas de bien individuel.
L’individualisme occidental moderne a largement dévalorisé le « bien commun ». D’autant que celui-ci, porté ici par des sociétés chrétiennes, revêtait une connotation spirituelle – le « bien » était plutôt le Bien, issu de la transcendance, et le « commun » représentait un rapprochement imparfait de la Communion des Saints (le récit de la Pentecôte représentait l’archétype du Commun).
Quand au xviiie siècle la chrétienté commence à s’effacer, le bien commun est remplacé par l’intérêt général (à partir de Rousseau), ce qui traduit à la fois le matérialisme naissant (« intérêt » à la place de « bien »), et l’apparition du collectif (qui va devenir la masse au xxe siècle avec les totalitarismes) à la place de la communauté (« général » au lieu de « commun »). La communauté représente un groupement d’individus hiérarchisés et pratiquant la solidarité par l’entraide des différences ; tandis que le collectif est un groupement d’individus égaux, recevant chacun les mêmes subsides – mais c’est une autre histoire).
Cela signifie-t-il qu’il n’y a plus de « bien commun » dans les sociétés individualistes ? Il est difficile d’imaginer une société dont les membres ne se verraient rien en commun. Ou alors ce serait l’idéal du pur libéralisme (pour Hayek le bien commun ne signifie rien d’autre que l’addition des biens individuels séparés). Mais cela n’existe pas (c’est du moins ma conviction) : même dans une société individualiste, les citoyens sont fiers de leurs monuments et honteux de voir la misère envahir leurs rues.
Cependant toute l’histoire de la modernité est l’histoire d’un rejet des communautés, depuis la plus petite (la famille) jusqu’à la plus grande (la nation). Car la communauté hiérarchise (et la modernité veut l’égalité), elle soumet l’individu (et la modernité veut la liberté individuelle), et elle engendre la guerre pour sa survie et son expansion (et la modernité veut la paix). Mais surtout, les communautés de la plus petite à la plus grande sont particulières, c’est-à-dire qu’elles englobent une partie seulement de l’humanité, de la société etc. Or la modernité ne veut plus la particularité : elle veut l’universel. Elle ne veut plus des Français ou des Anglais, mais des citoyens du monde. Elle ne veut plus des défenseurs de telle culture, elle veut le multiculturalisme couronné. Le Bien commun dépendait d’une certaine anthropologie, elle-même dépendant d’une culture. Les post-modernes ne veulent plus dépendre que de valeurs universelles, et de ce qui, dans l’anthropologie qu’on peut décrire, est universel.
Ainsi, pendant longtemps et jusqu’au tournant du dernier siècle, la notion de bien commun a pratiquement été effacée, on ne l’utilisait plus : remplacée par « intérêt général ».
À ce moment – il y a quelques décennies, apparaît et se développe la question écologique. Elle avait été évoquée depuis la seconde guerre par des textes comme ceux de Gustave Thibon, mais on n’y avait pas prêté attention. Le climat commence à devenir un souci. On soupçonne que l’économie mondiale et les modes de vie surtout occidentaux, mais bientôt mondiaux, ont un effet délétère sur le climat. Autrement dit, alors que des éléments comme l’air ou l’eau apparaissaient comme des biens communs infinis et dont la consommation pouvait être sans limites… on comprend à l’inverse que certains (surtout nous les Occidentaux) sont en train de jouer vis-à-vis de ces biens le rôle des pirates dans la « tragédie des communs » : ils pillent pour leur propre jouissance un bien commun limité, le raréfient et le dénaturent.
Je pense que c’est l’apparition ou le développement du souci écologique, qui a par nécessité remis en circulation le concept de bien commun, et même de Bien Commun.
J’ai dit plus haut que la post-modernité récuse la particularité : elle a vu par exemple la modernité tomber dans les pièges des nationalismes, fauteurs d’affreuses guerres. Elle a vu les totalitarismes instrumentaliser les familles. Pour échapper à ses fantômes, elle vise le seul universel. Nous n’avons plus à être citoyens d’une patrie, mais citoyens du monde. Un bien commun particulier, celui de la patrie ou de la famille, est aussitôt suspecté de chauvinisme et vite de terrorisme. Nos contemporains ne veulent plus se passionner pour le bien-être des Bretons, mais le bien-être de l’humanité leur importe.
C’est pourquoi le souci écologique était le seul par lequel pouvait se redéployer le bien commun. Lorsqu’apparaît la nécessité de protéger des « biens communs » planétaires, c’est-à-dire universels, le concept nous va comme un gant. La nécessité n’est plus de défendre une patrie ou une culture particulière, mais l’eau ou l’air dont a besoin toute la planète. Que l’on prenne l’exemple des biens écologiques, ou celui des biens immatériels (l’information), il s’agit toujours de biens qui concernent l’humanité tout entière, et non pas une communauté particulière.
C’est le phénomène de mondialisation qui transforme la teneur du bien commun. C’est lui aussi qui rend la notion de bien commun acceptable et même importante pour des sociétés individualistes, parce qu’avec la mondialisation disparaissent les particularités (du moins c’est ce que l’on croit ou ce que l’on voudrait).
L’apparition des « biens communs » écologiques ou climatiques, c’est le retour du « bien commun » adapté à une époque cosmopolite, pour laquelle seul compte l’universel.
Mais le problème est le suivant :
La passion pour l’universel a toujours été une idée, je dirais une idéologie plus qu’un souci concret. Il suffit de se rappeler Rousseau. Et plus tard l’idéologie communiste. A force d’aimer l’humanité, on assassine les humains qu’on a devant soi (on chante l’Internationale en tuant les humains concrets). L’amour de l’universel traduit en général dans l’histoire un mépris de la particularité. Après un siècle d’idéologies meurtrières, les passionnés de l’humanité nous font sourire : qu’ils s’occupent d’abord de leur voisin de palier !
Et pourtant, aujourd’hui le bien commun universel, qu’il soit climatique ou autre, a cessé d’être le nuage des idéologues et est devenu une chose réelle. En raison de la mondialisation, beaucoup de choses sont devenues communes à tous les humains de la terre. En raison d’une spécifique « tragédie des communs » qui affecte les ressources naturelles et le climat, l’eau ou les forêts sont devenues effectivement des biens communs universels de l’humanité (ce qui n’existait pas auparavant parce qu’on les croyait infinis, ou on faisait comme s’ils l’étaient – c’est toujours le cas quand arrive finalement la tragédie des communs).
Autrement dit : la tragédie des communs au niveau global, nous force à concrétiser ce qui apparaissait auparavant comme une simple utopie, nous impose de réaliser notre désir d’universel. Y parviendrons-nous ? Déjà nombre d’écologistes avancent que nous devrons pour cela anéantir (ou dépasser ?) la démocratie – car la démocratie est incapable, par nature, de décider pour le long terme.
L’évolution de la notion de bien commun dans la période post-moderne (à partir du début du xxe siècle), suit l’évolution de la plupart des concepts que la Chrétienté ne parvient plus à légitimer par son dogme. Ils ne tombent pas dans l’oubli ni ne sont rejetés. Ils sont récupérés par l’esprit moderne, qui tient à eux mais nourrit le besoin de les légitimer autrement que par les dogmes chrétiens. On leur trouve donc une nouvelle légitimité, afin que dans l’aventure ils ne perdent ni leur assise ni leur importance (c’est ainsi que Kant avait proposé de conférer une nouvelle légitimité à la dignité humaine : l’autonomie – à la place de l’image de Dieu). Cette nouvelle recomposition des légitimités correspond aux commencements de l’école phénoménologique. C’est l’exigence existentielle qui fait la légitimité, celle des dogmes ayant disparu. Il en va ainsi pour le bien commun. Peut-être peut-on considérer le xixe siècle (ou au moins sa seconde moitié) comme le moment où la société libérale d’après la révolution ayant anéanti le bien commun, les sociétés occidentales ont compris dans leur chair à quel point inhumaine était cette situation où le commun était littéralement aboli. C’est à la fin du xixe que naissent les Chrétiens sociaux et la doctrine sociale de l’Église, c’est au début du xxe siècle que naissent les mouvements solidaristes, personnalistes. Dorénavant, le bien commun va se légitimer par son exigence avérée dans le monde des humains, et cette exigence se révèle par l’absence. Grande leçon qui manifeste à quel point les principes édictés par les dogmes étaient si souvent anthropologiques, inscrits dans les besoins premiers de la nature, émanés d’une loi naturelle. Supprimez les dogmes, et on cherche d’autres assises : dans le cas qui nous occupe, une société sans bien commun n’est tout simplement pas viable. Dans des sociétés individualistes, on refuse de se voir imposer une définition du bien commun par l’une ou l’autre instance – et cependant on désigne ensemble les biens communs en fonction de l’exigence avérée.
Enfin, si par le biais du souci écologique nous avons retrouvé le Commun, nous avons aussi retrouvé, d’une autre manière, le Bien – avec une majuscule. Pourquoi ? parce que l’écologie est devenue une religion, une idéologie si l’on veut. Elle s’impose avec la force de l’évidence, et n’admet pas la tolérance. Ceux qui s’y opposent sont traités comme des délinquants. Autrement dit, ce qu’elle poursuit ce n’est pas le bien, mais le Bien, retrouvant en cela l’esprit de l’ancienne chrétienté.