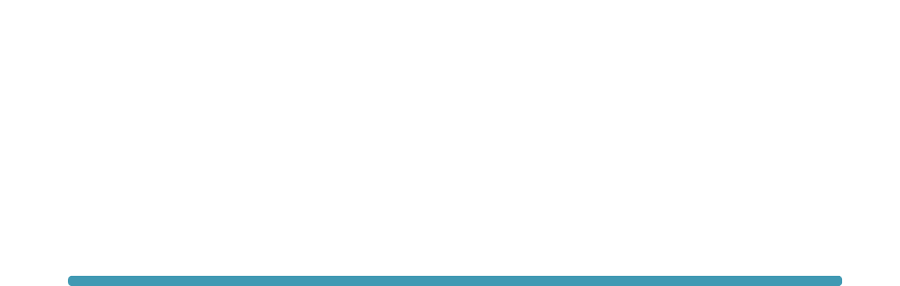« Le droit médical face aux risques » : le sujet, digne d’intérêt, se révèle malgré tout d’une réelle complexité en raison de son envergure. Un thème empreint d’une grande richesse, qui pourrait conduire à une multitude de discussions, et qui exige donc de se fixer une ligne de conduite. Aussi, pour les besoins de cette présentation, nous avons fait le choix d’opérer notre raisonnement en deux temps de réflexions, suivant une logique chronologique. Nous proposons d’analyser d’abord les traitements préventifs à la sécurité des soins (I), pour ensuite aborder la question des traitements curatifs en cas de réalisation d’un accident médical (II)1.
Il convient toutefois de préciser que la question de la réparation des accidents médicaux sériels occasionnés, notamment, par des produits de santé, est volontairement écartée de notre analyse, car cela aurait appelé à des développements particuliers qui auraient mérité, à eux seuls, une étude d’ensemble à laquelle cette manifestation n’avait pas vocation à se prêter.
I. Traitements préventifs à la sécurité des soins
La notion de prévention est, pour la première fois, définie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1948 comme l’ensemble « des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps ». À cette époque, l’OMS préconise d’opérer une distribution entre :
- la prévention primaire (visant à empêcher l’apparition des pathologies) ;
- la prévention secondaire (visant à limiter la prévalence d’une maladie dans une population) ;
- et la prévention tertiaire (visant à réduire les complications ou rechutes consécutives à la maladie).
En 1982, Robert S. Gordon invite à une relecture de cette classification. Selon cet auteur, la catégorisation devrait davantage s’opérer autour d’un critère populationnel, plutôt que selon une approche clinique visant à refléter les différents stades de la maladie. Il invite alors à distinguer :
- la prévention universelle (pour tous) ;
- la prévention sélective (pour des sous‑groupes de populations spécifiques tels que les automobilistes) ;
- et la prévention ciblée (pour des sous‑groupes de populations spécifiques présentant des facteurs de risques identifiés).
S’inspirant des avantages et des inconvénients de ces deux représentations, le professeur San Marco propose, quelques années plus tard, une nouvelle conceptualisation de la prévention, fondée sur une anticipation positive, qui inspirera le député André Flajolet dans son rapport sur les disparités territoriales des politiques de prévention sanitaire, en 20082.
Finalement, il nous est possible d’en conclure que la prévention fait, sans conteste, partie de ces concepts dont nous avons tous une appréhension intuitive, mais pour lesquels il apparaît difficile d’en livrer une définition exacte. Ce dont on est sûr, c’est que la sécurité du patient est aujourd’hui considérée comme une priorité pour le Haut Conseil de santé publique (HCSP3), et que la prévention sanitaire représente l’un des objectifs centraux de la loi n° 2204‑806 du 9 août 20044. Suivant cela, il est possible de considérer qu’il s’agit de l’ensemble des mesures et actions qui ont vocation à éviter l’apparition, à limiter le développement ou l’aggravation des maladies et des accidents médicaux (article L. 1417‑1 du Code de la santé publique).
On peut alors observer que c’est un véritable « management » des risques associés aux soins qui s’opère dans notre système (A), bien qu’il puisse paraître insuffisant à bien des égards (B).
A. Le management des risques associés aux soins
Cette « politique de prévention » se scinde aujourd’hui en trois temps successifs. Il s’agit d’abord d’« appréhender », c’est‑à‑dire de chercher à identifier les menaces, les origines des risques (1). Il s’agit ensuite d’« anticiper », c’est‑à‑dire de mettre en place une stratégie afin de limiter les risques et de restreindre leurs impacts (2). Il s’agit enfin de « sécuriser », c’est‑à‑dire de se donner les moyens et les ressources de se protéger efficacement contre la réalisation des risques (3).
1. Appréhender : comprendre pour pouvoir agir efficacement
Pour pouvoir agir efficacement à titre préventif, il paraît nécessaire, au préalable, de connaître les risques, de pouvoir les cartographier, et de savoir les prioriser selon une échelle de valeurs. Prévenir un risque suppose inévitablement, en amont, d’en maîtriser la connaissance. C’est pourquoi, en pratique, la remontée d’informations apparaît essentielle. Il est indispensable que les accidents médicaux puissent faire l’objet, a posteriori, d’une modélisation, par le biais d’outils, et notamment d’une data visualisation (ou « Dataviz »). Ce procédé permet d’en identifier et d’en comprendre les origines, donc d’agir sur les causes humaines, techniques, ou encore organisationnelles – aussi appelés événements porteurs de risques (EPR) qui en sont à l’origine, et par voie de conséquence, d’en éviter la répétition. Plusieurs outils sont actuellement mis en œuvre dans cette intention.
On pense, tout d’abord, à la mise en place d’un retour d’expérience (RETEX). Cette « mémoire collective des situations d’urgence sanitaire5 », comme aime à l’appeler le ministère de la santé, est avant tout considérée comme un processus d’apprentissage constructif : une « culture positive de l’erreur6 ». Différents procédés sont actuellement utilisés par les établissements médicaux et paramédicaux – revue de mortalité et de morbidité (RMM), comité de retour d’expérience (CREX), audits cliniques, etc. – afin d’analyser, en temps réel, les défaillances internes de l’établissement (surcharge du volume d’activité, fatigue des équipes soignantes, détresse émotionnelle, etc.), et ainsi y remédier avec efficacité pour éviter que des accidents ne puissent se renouveler. La crise sanitaire liée à la Covid‑19 est d’ailleurs venue prouver que ces remontées du terrain sont la meilleure méthode pour anticiper les risques, et améliorer en continu la sécurité des soins7.
On pense, ensuite, à la procédure de déclaration des événements indésirables associés aux soins (EIAS, EIGAS). Conformément à la réglementation8, tous les professionnels de santé (quel que soit leur secteur d’activité) sont désormais invités à communiquer ces événements indésirables sur une plateforme nationale, afin de pouvoir les analyser. Un dispositif qui apparaît louable. Pourtant, bien qu’il soit toujours en progression – 4 962 déclarations ayant été transmises à la Haute Autorité de santé (HAS) depuis sa création –, on doit remarquer qu’on est toujours en sous déclaration. En 2021, ce sont seulement 1 874 déclarations d’EIGAS qui ont été transmises9, ce qui apparaît relativement peu, quand on sait que l’enquête nationale (« Eneis 3 ») portée par la HAS en 2019, considère qu’il y aurait environ entre 176 000 et 372 000 séjours hospitaliers annuellement causés par un EIGAS, dont 9 300 à 197 000 sont évitables10. Bien que les événement indésirables associés aux soins soient nombreux11, ils sont encore très peu signalés par les professionnels. Plusieurs raisons peuvent certainement expliquer cette réticence :
- le manque de temps ;
- la peur d’un jugement de valeur ou de sanctions de la part de la hiérarchie (malgré l’anonymat de la plateforme) ;
- le défaut de sensibilisation des équipes médicales, etc.
Un tel constat apparaît toutefois problématique dans la mesure où ces analyses permettent de comprendre les causes profondes de ces événements, de les partager, et de proposer des solutions pour éviter qu’ils ne se reproduisent.
On pense enfin à l’Observatoire des risques médicaux (ORM) créé par la loi n° 2004‑810 du 13 août 2004 à l’article L. 1142‑29 du Code de la santé publique. Cet observatoire est rattaché à l’Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM). Il a pour mission d'analyser les données relatives aux accidents médicaux et à l'ensemble des conséquences, notamment financières, qui en découlent. Toutefois, alors que diverses enquêtes épidémiologiques récentes soulignent l’insuffisance de données médicales dont dispose notre pays12, on remarque que paradoxalement l’ORM ne produit plus de données, et que son dernier rapport public date de 2015. Un dispositif qui se révèle donc très peu fonctionnel, alors que les professionnels ne cessent de clamer leur besoin de données nationales détaillées, fiables, et actualisées de manière régulière.
2. Anticiper : pallier les risques et limiter leur impact par la mise en place d’orientations stratégiques de prévention
Une fois que les risques sont identifiés, il convient, ensuite, d’asseoir une stratégie de prévention efficace visant à en éviter la survenance, et à en atténuer les répercussions. Cette stratégie est construite, selon nous, par l’intermédiaire de trois acteurs complémentaires.
D’abord, par la mise en place d’actions de terrain internes, propres à chaque établissement. On pense par exemple à :
- l’élaboration de protocoles et de check‑lists ;
- la multiplication des audits internes ;
- la réalisation annuelle de programmes d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins par la direction (PAQSS) ;
- l’utilisation d’indicateurs de qualité et de sécurité des soins (IQSS) ;
- ou encore la mise en place de programmes visant à améliorer la collaboration et la communication des équipes (dans le cadre du Pacte de confiance lancé par la HAS en 2013 afin de remédier aux dysfonctionnements organisationnels), etc.
Ensuite, par la multiplication de recommandations de « bonnes pratiques » communiquées par la HAS. Entre 2021 et 2022, ce sont plusieurs centaines de recommandations – consultables en toute transparence13 – qui ont été émises par cette autorité afin de guider les acteurs de santé dans leur quotidien. Il est incontestable que ces actes imprègnent le paysage médical et qu’ils y jouent un rôle fondamental. Ces outils peuvent être considérés comme des références essentielles d’appréciation des risques fréquents ou graves normalement prévisibles. Ainsi que l’indique, notamment, le Conseil d’État en 2021, ces outils apportent des repères utiles puisque :
[Ils] ont pour objet de guider les professionnels de santé dans la définition et la mise en œuvre des stratégies de soins à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique les plus appropriées, sur la base des connaissances médicales avérées à la date de leur édiction14.
Enfin, par la mise en place d’un cadre législatif et règlementaire. On pense, d’une part, à la multiplication des normes relatives à la sécurité des soins et à la réduction des risques, avec adoptions de :
- la loi « Hôpital Patient Santé Territoire » (HPST), le 21 juillet 2009 ;
- la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (MNSS) ;
- la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation du système de santé ;
- la loi « Rist » du 26 avril 2021, etc.
On pense, d’autre part, au développement de normes ciblées, parfois au décours d’événements indésirables graves et médiatisés :
- pharmacovigilance (médicaments),
- matériovigilance (dispositifs médicaux),
- toxicovigilance (produits toxiques),
- infectiovigilance (risques infectieux),
- radiovigilance, etc.
3. Sécuriser : rationnaliser la gestion des risques associés aux soins grâce à un pilotage opérationnel et à une coordination cohérente
Il s’agit, dans un dernier temps, de rationnaliser la gestion des risques associés aux soins grâce à un pilotage opérationnel, et à une coordination cohérente. Cela passe d’abord par la mise en place d’un système de communication interne (afin de rendre lisible le dispositif de gestion des risques) et d’un protocole d’alerte. Cela passe ensuite par la création de postes autonomes appliqués à cette fonction :
- coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins ;
- responsable opérationnel de la qualité ;
- équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) ;
- centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins (CPIAS), etc.
Cela passe également par l’accompagnement du corps professionnel :
- mise en place de formations adéquates, que ce soit pour la direction ou pour le reste de l’équipe médicale ;
- accréditation des médecins et des équipes médicales ;
- évaluation des pratiques professionnelles (EPP) ;
- obligation de développement professionnel continu (DPC), etc.
Cela passe enfin par la garantie de certains moyens financiers. Il convient de rappeler que tous les professionnels et établissements de santé (sauf l’assistance publique des hôpitaux de Paris depuis 2003) doivent souscrire à une couverture assurantielle afin de garantir leur responsabilité (article L. 1142‑2 du Code de la santé publique). La mutuelle d’assurance Société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM) du groupe Relyens détient sur ce point un quasi‑monopole. Il s’agit d’un partenaire de référence qui se donne pour objectif d’accompagner les établissements dans la prise en charge des conséquences d’un incident éventuel (gérer le sinistre et l’indemniser auprès de la victime).
Bien qu’il existe aujourd’hui une réelle « politique de prévention » ayant vocation à réduire les risques associés aux soins, cette démarche se révèle défaillante (B).
B. Une démarche préventive insuffisante
La mise en œuvre de cette démarche préventive se révèle complexe à configurer dans la pratique, pour trois raisons majeures, selon nous.
Premièrement, on comprend assez aisément que le premier maillon de la chaîne se révèle plutôt déficient. Pourtant, sans la remontée de toutes ces informations, il est évidemment bien plus compliqué d’orienter une politique de prévention efficace. La connaissance de la sinistralité est un facteur de prévention important de notre système.
Deuxièmement, il est une réalité que le système de santé évolue de manière perpétuelle. De nouveaux risques apparaissent régulièrement, ce qui implique de devoir constamment adapter ou élaborer de nouvelles stratégies de prévention. Ainsi, par exemple, l’accentuation de la chirurgie ambulatoire ces dernières années est venue impliquer d’exposer les patients à une augmentation des dangers, notamment postopératoires. Cela a donc obligé les établissements de santé à développer, en la matière, une politique de prévention différente de celle à laquelle ils étaient accoutumés jusque‑là. La révolution numérique qui frappe aujourd’hui le domaine de la santé, implique également la mise en œuvre d’une politique préventive atypique. En effet, aussi profitable que puisse être l’informatisation, ces changements technologiques entraînent de nouvelles menaces auxquelles il est indispensable de trouver des solutions, comme le démontre, de manière répétée, les attaques vécues par plusieurs établissements ; notamment ceux de Dax et de Villefranche‑sur‑Saône en février 2021. D’après les données statistiques de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), depuis 2019, les violations liées à des attaques par cryptolockers sur les établissements de santé – centres hospitaliers, cliniques, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), laboratoires, etc. – auraient été multipliées par trois. Cela nous conduit à affirmer que le danger d’une cyber‑attaque, d’un cyber‑espionnage, ou encore d’un cyber‑terrorisme, n'est plus contingent et doit inciter à la prudence. En ce sens, rappelons que le président de la République a récemment annoncé un plan économique visant à accélérer la mise en œuvre d’une stratégie nationale en matière de cyber‑sécurité dans le secteur de la santé15. Espérons que cette annonce porte ses fruits et permette de réaliser des avancées concrètes.
Troisièmement, même s’il est évident que la prévention des risques médicaux (et paramédicaux) demeure une priorité centrale pour le ministère de la santé, on doit affirmer qu’il s’agit d’une quête difficile – oserait‑on dire impossible ? – à mener, car la réussite de cette stratégie préventive est également dépendante des modes de vie de la population et des inégalités sociales du pays. Ainsi, par exemple, alors que l’on croyait avoir vaincu certaines maladies grâce aux nombreuses campagnes de sensibilisation et aux recommandations médicales, quelques‑unes reviennent en force depuis le début du xxie siècle et suscitent même l’inquiétude des autorités sanitaires. On songe, notamment, à la syphilis, au scorbut, ou encore à la tuberculose. Pour que la prévention puisse fonctionner, elle doit être fondée sur une anticipation positive grâce à la participation de chacun. Cela oblige donc à associer, de manière active, les patients, et à mettre plus globalement en œuvre une « éducation pour la santé16 » :
- sensibiliser les patients aux risques de la prise de médicaments en dehors des posologies ;
- aider le patient à l’apprentissage de l’autosurveillance de sa maladie ;
- développer une information pédagogique préventive (brochures, affiches, vidéos, etc.).
D’ailleurs,
Depuis quelques années, la communauté médicale et de gestion des risques n’imagine plus pouvoir progresser sans une participation beaucoup plus active des patients17.
En conclusion, bien que la prévention des risques associés aux soins soit un objectif louable, elle s’apparente, pour l’heure, à une quête illusoire. Malgré tous les efforts déployés afin de prévenir les risques, un incident peut toujours advenir. Les accidents médicaux sont une réalité, et ils impliquent qu’une action en réparation soit menée (II).
II. Traitement curatif : la prise en charge des accidents médicaux
L’accident médical peut se définir comme un événement non souhaitable et non souhaité, potentiellement préjudiciable pour un patient, et survenant à l’occasion ou comme suite à une prestation de soins de santé aux fins de diagnostic ou thérapeutique. On pense, notamment, à :
- une faute de diagnostic,
- une négligence médicale,
- ou encore une erreur médicale au cours d’une opération.
En revanche, l’échec d’une thérapie ou encore les inconforts liés à une opération ne peuvent pas être considérés comme des accidents médicaux. Ainsi que l’exprime parfaitement un auteur :
L’accident médical est donc la conséquence malheureuse d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, et qui a pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé et son évolution prévisible18 .
La loi n° 2002‑303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système, aussi appelée loi « Kouchner », constitue aujourd’hui le socle unique du droit de la responsabilité médicale, tant pour les actes accomplis en secteur public, que pour ceux accomplis en secteur privé (A). Cependant, malgré les nombreuses avancées offertes par ce texte, diverses pistes d’évolution sont aujourd’hui concevables (B).
A. Le régime d’indemnisation organisé par la loi « Kouchner »
Le patient qui s’estime victime d’un accident médical détient, actuellement, deux voies d’indemnisation possibles : celle d’un règlement à l’amiable (1), ou celle d’une procédure contentieuse (2).
1. La procédure amiable
Dans le cadre d’une procédure amiable, le patient est d’abord invité à exprimer son insatisfaction et à obtenir des explications auprès de l’établissement de santé (a), avant d’engager une demande indemnitaire (b).
a. Exprimer son insatisfaction et obtenir des explications
Dans un premier temps, les établissements de santé préconisent généralement au patient de contacter le médecin qui a assuré la prise en charge (ou le chef de service), afin de pouvoir s’entretenir avec lui ; ou de solliciter le service des relations avec des usagers en lui adressant une réclamation (article L. 1142‑4 du Code de la santé publique). On lui recommande aussi de :
- demander la copie de son dossier médical ;
- s’adresser à la Commission des usagers (CDU) de l’établissement afin d’expliquer sa situation et d’obtenir des réponses ;
- et demander une rencontre avec un médecin médiateur.
Ce dernier sera alors en charge d’organiser une médiation en présence des parties dans l’objectif d’aider l’usager à déchiffrer sa prise en charge et à la comprendre, de restaurer un dialogue, et in fine de limiter le contentieux. Précisons également que le patient peut, parallèlement, informer et saisir l’Agence régionale de santé (ARS) de sa région.
b. Engager la demande indemnitaire
Le patient pourra, ensuite, choisir une voie alternative de règlement du litige. La demande peut être réalisée auprès de la direction des affaires juridiques (ou au directeur général) de l’établissement afin que l’indemnisation puisse être discutée et traitée directement avec l’assureur. Le directeur pourra également décider d’engager, ou non, une procédure à l’encontre du professionnel auprès de l’ordre des médecins afin de sanctionner son irrespect aux règles déontologiques (avertissement, blâme, interdiction temporaire, radiation, etc.).
En revanche, lorsque l’atteinte présente un certain seuil de gravité (article D. 1142‑1 du Code de la santé publique), il est recommandé à la victime (ou à ses ayants droit) de saisir la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI). Cette condition est évidemment remplie en cas de décès. Pour les autres victimes, le seuil de gravité peut être atteint dans cinq hypothèses alternatives :
- taux d’Atteinte à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) supérieur à 24 % (suivant l’application du barème du concours médical) ;
- arrêt des activités professionnelles pendant minimum six mois consécutifs (ou six mois non consécutifs sur une période de douze mois) ;
- déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50 % pendant au moins six mois consécutifs (ou six mois non consécutifs sur une période de douze mois) ;
- victime déclarée définitivement inapte à exercer une activité professionnelle antérieure ;
- victime de troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence (y compris d’ordre économique).
Il convient alors de préciser que d’après les derniers rapports d’évaluation de la Commission nationale des accidents médicaux (CNAMed), l’absence de ce seuil de gravité représente la première cause d’irrecevabilité des demandes d’indemnisation devant les CCI. Or, cette décision d’irrecevabilité n’est susceptible d’aucun recours, comme le rappelle le Conseil d’État en 2007 :
La déclaration par laquelle une commission s’estime incompétente pour connaître de la demande ou estime celle‑ci irrecevable quand bien même elle fait obstacle à l’ouverture d’une procédure de règlement amiable, ne fait pas grief et n’est pas susceptible d’être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir dès lors que la victime conserve la faculté de saisir si elle s’y croit fondée le juge compétent d’une action en indemnisation19.
Ainsi que l’indique la Cour de cassation :
La mission des CCI est de faciliter, par des mesures préparatoires, un éventuel règlement amiable des litiges relatifs à des accidents médicaux, des affections iatrogènes ou des infections nosocomiales20.
Ces commissions, de nature administrative, indépendantes de l’ONIAM, ont donc été mises en place depuis 2002, dans l’objectif de faciliter le parcours des victimes, et de désengorger les tribunaux. Cela explique, d’une part, que le dispositif soit purement facultatif, et d’autre part, que le formalisme y soit réduit. Contrairement à une procédure judiciaire, les victimes n’ont pas à réaliser d’avances financières. Cette commission ordonne une expertise médicale contradictoire, et émet ensuite un avis sur la responsabilité de l’établissement, ainsi que sur la répartition de l’indemnisation entre les débiteurs potentiels. L’avis doit, en principe, être rendu dans les six mois de la saisine. Si celui‑ci aboutit à une proposition d'indemnisation, le dossier est ensuite transmis à l'assureur ou à l’ONIAM, au regard des situations.
D’après de nombreux professionnels, il ressort toutefois de la pratique que ce mécanisme n’est pas aussi convaincant que souhaité. La procédure devant ces commissions se révèle, en réalité, plutôt longue (le délai moyen de remise d’un avis par la commission étant de douze mois), et n’aboutit pas nécessairement (l’ONIAM refusant certaines indemnisations faute de se considérer comme lié par les avis des commissions). En outre, il est de notoriété publique que l’indemnisation proposée par les CCI est généralement réduite entre 10 % à 15 % par rapport à un tribunal, de sorte que beaucoup de victimes décident d’agir directement en justice contre le ou les potentiels responsables, même si cette procédure est traditionnellement plus longue et plus coûteuse.
2. La procédure contentieuse
Il est également possible, pour la victime, d’opter pour la voie juridictionnelle, et d’engager la responsabilité de l’établissement de santé et/ou du professionnel. Rappelons que les juridictions administratives sont concernées s’il s’agit d’un établissement public. Les juridictions judiciaires sont, quant à elles, concernées s’il s’agit de médecins libéraux (mais aussi pour faute détachable du service à l’égard du médecin hospitalier, ou à l’égard du médecin ayant une activité privée au sein du service hospitalier au titre de l’article L. 6154‑1 du Code de la santé publique) ou d’établissements privés. Enfin, la responsabilité peut également être recherchée devant les juridictions pénales afin d’obtenir une sanction personnelle du praticien poursuivi (atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne, omission de porter secours, etc.).
L’article L. 1142‑1 du Code de la santé publique indique :
- que la responsabilité des professionnels de santé et des établissements ne peut être recherchée qu’en cas de faute (a) ;
- qu’en cas d’infection nosocomiale, la responsabilité de l’établissement peut être recherchée même sans faute, sauf pour l’établissement à établir l’existence d’une cause étrangère (b) ;
- et que les conséquences d’un accident thérapeutique sans faute, sous condition de gravité, sont supportées par la solidarité nationale (c).
a. Responsabilité pour faute des professionnels et établissements de santé
Avec l’arrêt « Mercier » rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 20 mai 1936, la responsabilité des professionnels de santé dans le domaine privé était de nature contractuelle. Elle reposait sur le contrat de soin qui liait le patient et le professionnel :
Il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l’engagement, sinon, bien évidemment, de guérir le malade, du moins de lui donner des soins, consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science21.
Dans le secteur public, le Conseil d’État considérait, pour sa part, que si le service engageait sa responsabilité pour faute22, le professionnel de santé ne pouvait être personnellement poursuivi, sauf à démontrer l’existence d’une faute détachable du service. La loi du 4 mars 2002 rend désormais inutile cette distinction, puisqu’elle institue un régime unique de responsabilité pour faute à l’article L. 1142‑1 du Code de la santé publique :
Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent Code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
Lorsque l’accident résulte d’une faute médicale du praticien, celui‑ci engage sa responsabilité. À cet égard, il pèse sur le patient la charge de rapporter la preuve de cette faute, à moins que le manquement résulte d’un défaut d’information.
Définir avec précision la notion de « faute médicale » peut toutefois s’avérer être une tâche difficile. Effectivement, sa qualification est nécessairement amenée à varier au regard des situations, suivant qu’il s’agit :
- d’un établissement de santé,
- d’un professionnel,
- d’un établissement public,
- d’un établissement privé, etc.
On admet généralement que la faute médicale doit être appréciée « par rapport aux devoirs et obligations qui pèsent sur le praticien ou sur l’établissement23 ». Les juges doivent donc évaluer souverainement les circonstances de l’espèce, afin d’apprécier si le comportement du professionnel est conforme « aux données acquises de la science », c’est‑à‑dire à ce qu’autorise la connaissance à l’instant T où se situe l’acte médical (article L. 1110‑5 du Code de la santé publique). Ainsi que l’indiquent deux auteures :
Il doit rechercher les moyens dont disposait le soignant et les comparer avec ceux qui ont été mis en œuvre24.
Afin de l’aider dans cette démarche, le juge peut, bien entendu, s’appuyer sur une expertise, mais il peut également compter sur les nombreuses « recommandations de bonnes pratiques » ou « règles de l’art », communiquées par la HAS. Sans être exhaustif, plusieurs types de « faute » ressortent aujourd’hui de notre jurisprudence :
- faute de diagnostic,
- défaut d’indication thérapeutique,
- défaut de surveillance,
- manquement à l’obligation d’information, etc.
b. Responsabilité des établissements en cas d’infection nosocomiale
Ce sont chaque année plusieurs milliers de patients qui s’estiment victimes d’une infection nosocomiale (infection urinaire, respiratoire, etc.). Une infection est dite nosocomiale lorsqu’elle est provoquée par un agent pathogène contracté à l’occasion de la prise en charge médicale du patient (article R. 6111‑6 du Code de la santé publique). Elle ne doit être, ni présente, ni en incubation, au début de la prise en charge du patient25.
Du point de vue de la réparation, ces infections présentent certaines spécificités. Les établissements de santé sont présumés responsables des dommages qui en résultent « sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère26 ». En conséquence, ni le caractère endogène du germe27, ni l’état antérieur28, ni le comportement de la victime29 ne permettent d’exclure cette qualification. Cette position vient d’ailleurs d’être confirmée par le Conseil d’État dans un arrêt du 1er février 202230 et consacrée – de manière inédite – dans un arrêt du 6 avril 2022 par la première chambre civile de la Cour de cassation31. Afin de s’exonérer, l’établissement peut alors :
- soit prouver que la prise en charge médicale n’est pas à l’origine de l’infection (critère temporel) ;
- soit soulever que l’infection présente une « autre origine que la prise en charge » (critère substantiel).
Cependant, cette origine doit être exclusive pour pouvoir être exonératoire. La Haute juridiction admet que l’origine de l’infection puisse être multiple :
Après avoir admis, en se fondant sur le rapport d'expertise, l'existence d'un lien causal entre l'infection et l'aggravation de l'état de santé de [la victime], la cour d'appel a retenu que la dégradation ayant conduit à l'amputation était multifactorielle et favorisée par l'excès pondéral du patient, ainsi que par une arthrose majeure du genou droit entraînant un surcroît de sollicitation mécanique à gauche et qu'il devait être tenu compte du rôle important et déterminant de ces facteurs étrangers à l'infection nosocomiale. Elle a pu en déduire, sans méconnaître le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, que l'infection avait seulement contribué à l'aggravation du dommage dont [les victimes] sollicitaient la réparation, dans une proportion qu'elle a souverainement évaluée32.
Les magistrats du fond sont donc libres de pouvoir évaluer la proportion dans laquelle l’infection nosocomiale a réellement contribué à l’aggravation du dommage dont la réparation est sollicitée33.
La responsabilité des professionnels de santé exerçant à titre libéral ne peut, quant à elle, être recherchée que pour faute. La charge de la preuve revient alors au patient. Le Conseil Constitutionnel ayant considéré, en 2016, que cette différence de traitement n’est pas contraire au principe d’égalité entre les victimes :
Il résulte de ces dispositions une différence de traitement dans les conditions d'engagement de la responsabilité pour obtenir la réparation des dommages liés à une infection nosocomiale n'ouvrant pas droit à réparation, au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Un régime de responsabilité sans faute s'applique si cette infection a été contractée dans un établissement, service ou organisme de santé. En revanche, si une telle infection est contractée auprès d'un professionnel de santé exerçant en ville, la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée qu'en cas de faute. Le Conseil constitutionnel a jugé, contrairement à l'argumentation du requérant, que cette différence de traitement ne méconnaît pas le principe d'égalité [...]34.
Enfin, pour la victime d’une infection nosocomiale qui entraîne un taux d’AIPP de plus de 25 %, l’indemnisation sera supportée par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. C’est donc elle qui prend en charge la réparation des conséquences des infections nosocomiales les plus graves (article L. 1142‑1‑1 du Code de la santé publique). Ainsi que l’indiquent les juridictions :
L’ONIAM est tenu d’assurer la réparation […] des dommages résultant des infections nosocomiales, à la seule condition qu’elles aient entraîné un taux d’incapacité supérieur à 25 % ou le décès du patient ; qu’il ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant […] la responsabilité de l’établissement de santé […] ; que l’office peut uniquement demander à cet établissement de l’indemniser de tout ou partie des sommes ainsi à sa charge en exerçant à l’encontre de ce dernier l’action subrogeante […] ou l’action récursoire […] ; que la responsabilité de l’établissement n’est engagée […] qu’en cas de faute établie à l’origine du dommage35.
Indiquons que la victime conserve toutefois la possibilité d’agir à l’encontre de l’établissement dès lors qu’elle apporte la preuve d’une faute36.
c. Réparation de l’accident médical sans faute – Aléa thérapeutique
L’aléa thérapeutique a été défini, dans un premier temps, par le Conseil d’État dans un arrêt « Bianchi », le 9 avril 1993 :
Lorsqu’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l’existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l’exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l’état initial du patient comme avec l’évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d’une extrême gravité37.
Il a ensuite été défini par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 novembre 2000 comme « la survenance en dehors de toute faute du praticien d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé […] la réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l’égard de son patient38 ».
La loi « Kouchner » du 4 mars 2002 a fait le choix de ne pas utiliser l’expression « d’aléa thérapeutique ». Elle lui préfère celle « d’accident médical sans faute ». Celui‑ci est alors définit comme un événement imprévu causant un dommage anormal (au regard de l’état du patient de l’évolution prévisible de celui‑ci), ayant un lien de causalité certain avec un acte médical (de soin, de diagnostic ou de prévention), mais dont la réalisation est indépendante de toute faute établie39. La réparation de ces accidents est fondée sur la solidarité nationale. Pour cette mission d’indemnisation, l’ONIAM dispose de la subvention annuelle de l’Assurance maladie, qui représentait 135 millions d’euros en 202240.
L’article L. 1142‑1 II du Code de la santé publique indique que trois conditions doivent être remplies pour que l’aléa puisse être réparé par le biais de la solidarité nationale.
D’abord, l’imputabilité directe à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins (exigence de causalité). Cela conduit, de facto, à exclure de l’indemnisation les conséquences qui découlent en réalité de l’état antérieur de la victime ou d’actes dépourvus de finalité contraceptive, abortive, préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice (article L. 1143‑3‑1 du Code de la santé publique), tels que les actes médicaux à visée purement esthétique (sauf chirurgie reconstructrice) ou rituelle (comme la circoncision).
Ensuite, l’anormalité des conséquences pour le patient, au regard de son état de santé et de l’évaluation prévisible de celui‑ci :
[La] condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement ; que, lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu’ainsi elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage41.
Enfin, la gravité de l’atteinte42.
L’indemnisation de l’aléa thérapeutique est donc fondée sur le risque de la médecine, c’est pourquoi elle échappe, en principe, aux juridictions ordinaires, au bénéfice des Commissions de conciliation et d'indemnisation (CCI) des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui seront en charge de diligenter les expertises.
Lorsque la CCI émet un avis favorable, concluant à l’existence d’un aléa thérapeutique remplissant les conditions pour être indemnisé par la solidarité nationale, l’ONIAM (pour les victimes postérieures au 5 septembre 2001) dispose alors de quatre mois pour adresser à la victime ou à ses ayants‑droit une offre d’indemnisation visant à réparer les préjudice subis (poste par poste), conformément au principe de réparation intégrale43. Toutefois, en pratique, les offres de l’ONIAM sont systématiquement calculées – sans possibilité de discussion – à partir d’un référentiel qui lui est propre. Or, les sommes indiquées sont notablement inférieures à ce qui peut être obtenu par la victime devant les juridictions. L’acceptation de l’offre émise par l’ONIAM vaut transaction, et ne peut plus être contestée en justice. La Cour de cassation étant venue préciser en octobre 2021 que l’acception d’une offre provisionnelle interdit de contester ensuite le droit à réparation, nonobstant le refus d’une offre définitive44. Son refus, en revanche, la rend caduque. Il faut rappeler que l’ONIAM n’est tenu à aucune obligation. Elle peut refuser de suivre l’avis positif de la CCI (soit en demeurant silencieuse pendant le délai des quatre mois, soit en notifiant à la victime une décision de rejet sans obligation de motivation45).
On notera qu'après la loi du 4 mars 2002, la mission d'indemnisation de l'ONIAM a été progressivement élargie à d'autres victimes :
- accidents médicaux résultant de mesures sanitaires d'urgence ;
- vaccinations obligatoires ;
- dommages transfusionnels résultant de contaminations par le virus de l'immunodéficience (VIH), le virus de l'hépatite C (VHC), le virus de l'hépatite B (VHB), le virus T‑Lymphotropique humain (HTLV), causées par une transfusion de produits sanguins ou par une injection de médicaments dérivés du sang : le benfluorex commercialisé sous le nom de « Médiator », et plus récemment le valproate de sodium commercialisé sous le nom de « Dépakine ».
Bien que cette loi soit à l’origine de nombreuses avancées favorables pour garantir une meilleure indemnisation aux victimes d’accidents médicaux, plusieurs insatisfactions ressortent de l’actualité, et laissent supposer des évolutions souhaitables (B).
B. Des évolutions inévitables
La célébration des 20 ans de la loi « Kouchner » a été l’occasion de faire un bilan sur ce régime. Personne ne conteste le fait que cette loi constitue un progrès. Les innovations de ce texte le rendent avant tout « révolutionnaire46 ». Tout en s’inscrivant dans la continuité jurisprudentielle, cette loi a également innové sur certains points fondamentaux, qui ont profondément bouleversé notre manière de concevoir l’indemnisation des dommages liés à l’activité médicale : en introduisant, notamment, l’instauration de « l’accident médical non fautif » et un mode durable d’indemnisation amiable des accidents médicaux.
La création d’un dispositif amiable a constitué une avancée importante pour la démocratie sanitaire et les droits des patients47.
La majorité des intervenants se sont rejoints pour noter l’effectivité de cette loi qui a bien fonctionné sur le terrain.
Malgré cela, un certain désenchantement s’est également exprimé. Beaucoup de praticiens s’accordent pour affirmer que le régime proposé demeure imparfait48. Il ressort des nombreuses manifestations qui ont marqué cet événement que certaines évolutions apparaissent aujourd’hui nécessaires. Trois points d’amélioration essentiels ont pu être soulevés.
Premièrement, on attendait de cette loi une véritable harmonie entre les régimes de responsabilité administrative et civile. Force est de constater que le maintien d’une double compétence favorise malheureusement la persistance d’une inégalité de traitement entre les justiciables. En effet, rappelons que si les dommages subis dans un établissement public relèvent des juridictions administratives, ceux subis dans un établissement privé ou causés par un praticien libéral relèvent des juridictions judiciaires. Or, cette dualité conduit parfois à des divergences regrettables dans l’application des règles indemnitaires : aussi, par exemple, si les juridictions administratives retiennent une responsabilité sans faute des établissements publics lorsque le matériel utilisé par le professionnel apparaît défectueux (matelas chauffant, instruments médicaux, prothèses, etc.), les juridictions judiciaires s’y refusent toujours. Les avocats de victimes dénoncent régulièrement ce manque d’égalité entre les victimes. Il n’est pas rare que pour des accidents médicaux identiques, on assiste à une disparité des indemnités allouées selon que les soins ont été prodigués dans un hôpital public ou une clinique privée. Pourtant, le principe de réparation intégrale, qui domine aujourd’hui le régime indemnitaire, s’applique à tous identiquement. Même si selon certains auteurs, cette ambivalence peut se révéler « source de richesse et d’innovation49 », ce manque de convergence et de dialogue entre les juridictions est très souvent dénoncé comme une « réalité honteuse50 » de notre système indemnitaire, sur laquelle une réforme apparaît nécessaire.
Deuxièmement, on peut constater que le seuil de gravité imposé par la loi réserve automatiquement la procédure devant les CCI aux accidents les plus graves. Or, on peut s’interroger : pourquoi restreindre ce mode alternatif des conflits aux cas extrêmes ? Les CCI peuvent offrir certains avantages (facilité de la saisine, gratuité de l’expertise, etc.) qui pourraient aisément convaincre les victimes de litiges moins graves qui se retrouvent, aujourd’hui, le plus souvent découragées devant une procédure contentieuse (coût du procès, difficulté du contentieux, longueur, etc.). Là encore, une réflexion peut sembler concevable.
Troisièmement, les silences de la loi sur certains sujets deviennent problématiques. On ne saurait en faire le reproche au législateur de 2002, puisque ces questions ne se posaient pas réellement à son époque. C’est le cas, par exemple des préoccupations déontologiques (et notamment de la lutte contre les conflits d’intérêts) qui ont pris une réelle ampleur avec l’affaire du « Médiator ». C’est également le cas de la sécurité sanitaire. L’expérience de la pandémie est venue démontrer que les grands principes de la loi peuvent, légitimement, au moins temporairement, être malmenés. Enfin, c’est aussi le cas pour l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle (IA) dans le domaine médical (télémédecine, télésanté, etc.). Les apports de cette loi sont indéniables, et personne n’entend contester cette affirmation. Néanmoins certains de ses défauts sont aujourd’hui à la source d’une insécurité juridique qui oblige à s’interroger sur sa pérennité. Il ne s’agit pas de remettre en cause les acquis de la loi, mais de venir la compléter afin de tenir compte des nouvelles réalités de notre système. Une évolution apparaît, à plus ou moins long terme, inévitable, afin de garantir une plus juste réparation aux victimes.