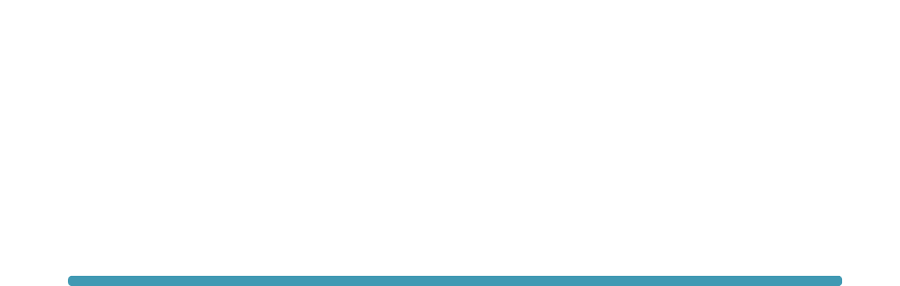Dans sa qualité d’institution, la justice n’est pas un idéal mais une réalité sociologique constituée d’hommes et de femmes qui exercent, avec plus ou moins d’indépendance selon les cultures et les systèmes juridiques dans lesquels elle évolue, un office de régulation des comportements humains au sein d’une communauté donnée. C’est d’un point de vue axiologique et substantiel qu’elle mérite d’être érigée au rang d’idéal. Or, depuis les origines de la pensée juridique, deux thèses s’affrontent sur la définition de cet idéal de justice. Le mythe de l’Euthyphron, tiré des dialogues de Platon, permet de bien comprendre ce qui oppose ces deux approches. Dans ce dialogue, Socrate demande à Euthyphron ceci :
Le saint est-il aimé des dieux parce qu’il est saint ou est-il saint parce qu’il est aimé des dieux1 ?
En fondant l’attrait des dieux pour le saint sur sa sainteté intrinsèque, la première alternative est de type objectiviste, car elle repose sur le présupposé de l’existence d’une sainteté en soi. En fondant au contraire la sainteté du saint sur l’amour qu’il suscite chez les dieux, la seconde alternative est de type relativiste, car en faisant de leur opinion subjective la source de la sainteté, elle fait de celle-ci, qui n’existe pas en soi, une question d’autorité et non de vérité. Ce célèbre dilemme, dont on peut utiliser les termes à dessein de s’interroger sur l’idéal de justice, est une illustration de la querelle entre l’objectivisme et le subjectivisme juridiques et oppose à une métaéthique cognitiviste, une métaéthique émotiviste : l’idéal de justice est-il connaissable en soi (métaéthique cognitiviste) ou n’est-t-il que relatif et inhérent à la subjectivité de chacun (métaéthique émotiviste) ou à une culture particulière ? En un mot, comme l’a posé Kelsen en des termes analogues dans son opuscule « Qu’est-ce que la justice ? »2, la justice est-elle un idéal absolu ou une exigence relative ? Question à laquelle Kelsen lui-même, comme chacun sait, répond qu’il n’y a de justice que relative.
L’idéal objectiviste de la justice, qui repose sur une approche cognitiviste du juste aux termes duquel il serait possible de connaître le juste en soi, trouve ses plus remarquables représentations au sein d’une vaste littérature sur la philosophie de la justice depuis Aristote jusqu’à Ronald Dworkin qui considèrent, l’un comme l’autre, que le juge est capable de connaître « la réponse juste3 ». Dworkin ira même jusqu’à assimiler le juge, en raison de cette aptitude à trouver le juste en soi, à Hercule, ce demi-dieu et personnage puissant de la mythologie antique. De l’idéal aristotélicien de la justice au juge herculéen, il y a tout lieu de repérer dans cette littérature juridique, une culture qui mythifie, magnifie et angélise le rôle du juge. Cette culture, qui se répandra beaucoup en terre anglo-saxonne, plonge ses racines dans la philosophie ancienne et gréco-romaine de la justice. Une philosophie qu’incarne à merveille l’œuvre d’Aristote et dont la théorie du common law sera la digne héritière en bénéficiant, contre le positivisme légaliste, d’un prestigieux représentant dans l’œuvre de John Rawls4 et, surtout, de Ronald Dworkin5. Un examen comparé de ces deux moments de l’idéal objectiviste de la justice, antique (I) puis anglo‑saxonne (II), permettra de découvrir dans quelle mesure ils constituent, aux yeux de la philosophie sceptique et continentale de la justice dont se nourrit le positivisme légaliste, un anti-modèle voire une illusion (III).
I. L’idéal aristotélicien de la justice
Une divergence fondamentale sépare l’idéalisme de Platon du réalisme d’Aristote. Tandis que le premier avait le regard tourné vers le ciel des idées, le Stagirite voyait le droit naturel dans le cosmos et dans la contingence des choses. Le réalisme de la conception aristotélicienne du droit trouve sa plus belle illustration dans le tableau de Raphaël exposé au Vatican, L’École d’Athènes, au centre duquel on aperçoit Aristote et Platon qui s’avancent en dialoguant au milieu d’un attroupement composé des plus grands noms de la philosophie grecque. Tandis que l’idéaliste Platon lève le doigt comme pour exprimer sa conviction que nul ne saurait comprendre le monde sans le jauger à l’aune des principes inscrits dans le ciel des idées, Aristote dirige son index vers la terre pour signifier, de façon réaliste, qu’il est préférable de prendre les faits au sérieux sans chercher à les juger mais en se contentant de les comprendre. Aristote davantage que Platon : tel est, chez les Anciens, le paradigme sur le modèle duquel le droit sera représenté et défini.
Qu’on ne se méprenne pas, néanmoins, sur la signification de ce réalisme juridique. Il est en effet radicalement étranger au réalisme dont se réclameront, à partir du XXe siècle, les théories modernes et volontaristes de l’interprétation. Si ces dernières se fondent sur une conception émotiviste du droit et des valeurs, la philosophie du droit d’Aristote est au contraire une métaéthique cognitiviste consistant à réputer réelles ce que le nominalisme occamien tiendra, à l’aube de la modernité, pour des constructions langagières. Le réalisme aristotélicien est une métaphysique dont les promoteurs se servent pour prêter aux universaux une réalité que le nominalisme remettra en cause. Un tel substantialisme aura pour effet, sur le plan de la philosophie judiciaire, d’idéaliser la fonction du juge auquel Aristote prêtera l’aptitude à découvrir, dans la réalité naturelle des choses, la réponse juste.
Cette représentation aristotélicienne, relayée au moyen âge par l’enseignement de saint Thomas d’Aquin, dessinera les contours d’une ontologie juridique de type objectiviste. Le droit est regardé comme le produit objectif et naturel des relations humaines au sein de la cité et plonge l’homme dans une hétéronomie spontanément sécrétée. Certes, toute la pensée gréco-romaine ne se réduit pas au seul réalisme aristotélicien. Sous l’influence des sophistes à l’instar de Protagoras, ou des sceptiques emmenés par Pyrhon, une dissidence s’est organisée, au demeurant fort minoritaire mais néanmoins réelle. Dans leur univers intellectuel, nul ne saurait prétendre saisir dans le cosmos une quelconque vérité axiologique et objective (scepticisme), de sorte que l’idée du juste et de l’injuste ne peut être qu’arrêtée par la main arbitraire du législateur (conventionnalisme). Il y a même, chez des philosophes antiques comme Démocrite et Épicure à Athènes, puis Lucrèce à Rome une tendance matérialiste et atomiste, dont on retrouvera l’esprit au XVIIe siècle dans les thèses modernes du mécanicisme, et qui réduit l’univers à un agrégat aveugle et contingent de particules momentanément agencées les unes aux autres et susceptibles, dès lors, de se désagréger. Par ailleurs, tandis que le réalisme d’Aristote, qui était un précurseur en matière de sociologie politique, le conduisait à manifester un grand intérêt porté aux affaires concrètes de la cité, les stoïciens marquaient à l’égard de ces questions une notable indifférence. C’est que le stoïcisme est une doctrine qui invite l’homme à rechercher ce qui constitue en lui-même la droite raison et la vertu, indépendamment de son attachement à telle ou telle cité. C’est ainsi que le droit naturel qu’invoquera Cicéron, l’un des plus grands représentants à Rome de cette philosophie stoïcienne d’origine grecque, n’est pas le droit naturel classique dont Aristote avait dessiné les contours. Il ne s’agit pas d’un droit tiré d’une observation de la nature cosmique et du monde extérieur, mais d’un droit qui trouve sa source dans la « nature de l’homme », plus précisément dans sa raison. Dans le De legibus, par exemple, Cicéron affirme que « l’origine et la nature du droit doivent être tirées de la nature de l’homme » et dans le fameux extrait de La République, il évoque une « loi véritable et immuable qui est la droite raison (…) qui n’est pas autre à Rome, et autre à Athènes, autre aujourd’hui, autre demain ». Bien des éléments tirés de ces célèbres extraits préfigurent l’universalisme du droit naturel moderne dans lequel les droits fondamentaux plongeront plus tard leurs racines. Mais toutes ces doctrines alternatives restent minoritaires devant l’orthodoxie des idées d’Aristote dont la métaphysique réaliste et objectiviste a influencé toute la pensée juridique de l’Antiquité au moyen âge.
Aux yeux d’Aristote, la loi apparaît comme flexible et doit être semblable à la règle de Lesbos, cette règle qui épouse les contours des objets à mesurer pour s’adapter à la diversité des cités et des régimes politiques dont elles sont assorties. Le droit naturel aristotélicien épouse les formes diversifiées de l’environnement politique et culturel dans lequel il se trouve enraciné. Cette préoccupation pour la contingence et la diversité du réel fera d’Aristote un contre-modèle exemplaire du positivisme légaliste. Le cœur de la pensée d’Aristote sur le droit est de considérer que l’office du juge n’est pas simplement d’appliquer la loi. Celle-ci n’est qu’une source du droit parmi d’autres dont se sert le juge pour « découvrir » le juste sachant que celui-ci varie avec la structure et la dimension du cas qui lui est soumis. D’où la nature juridictionnelle du droit, selon Aristote, qui est inséparable de l’expérience du procès : le droit est « dit » à l’occasion d’un litige.
C’est que le juge ne peut pas toujours s’en tenir au juste légal parce que celui-ci est inférieur à l’équité qui est la norme ultime à laquelle le juge obéira lorsque la loi sera silencieuse ou imparfaite : « L’équitable semble être le juste, mais c’est le juste qui dépasse la loi écrite »6. L’équité aristotélicienne est simplement destinée à suppléer les insuffisances de la loi en se guidant sur elle et en cherchant à retrouver « ce qu’eût dit le législateur lui-même s’il avait été présent » et « ce qu’il aurait porté dans la loi s’il avait connu le cas en question »7. Aristote invite ainsi le juge à occuper fictivement et anachroniquement le trône du souverain. Par où l’on voit cette angélisation du juge à qui une confiance est accordée pour occuper, au nom de l’équité, la fonction du législateur. Cette surestimation du rôle du juge est très familière de la conception ancienne du droit naturel. Dépourvu d’universalité, le droit naturel classique n’est pas dogmatiquement fixé par ses doctrinaires. Aux antipodes de la méthode kantienne et transcendantale de la connaissance, ces derniers refusent d’en déterminer le contenu de façon a priori et catégorique. L’idéal de justice aristotélicien repose alors sur un droit naturel pourvu d’une certaine relativité et d’une certaine souplesse qui offrent au juge un pouvoir discrétionnaire dont celui-ci, en mobilisant son intelligence et sa prudence, découvre la source dans le cas soumis à son prétoire.
Pour autant, cette dimension casuistique du droit naturel classique ne conduit pas à livrer le juge à lui‑même ni à sa totale et arbitraire subjectivité. Relatif, le droit naturel est connaissable, notamment grâce aux vertus de la dialectique du procès selon une approche cognitiviste qui n’est pas sans rappeler la Nouvelle rhétorique de Chaïm Perelman8 ou l’éthique communicationnelle de Jürgen Habermas9. Cette croyance en un droit naturel casuistique qui, malgré sa relativité, est susceptible de connaissance, définit tout l’idéal de justice aristotélicien : il appartient au juge de trouver une voie étroite et subtile entre l’observance littérale de la loi et la recherche d’une solution objective et juste qui l’éloigne de la tentation d’abuser de sa liberté d’interprétation. Une voie médiane entre légalisme et arbitraire judiciaire qu’on retrouvera chez le fondateur de l’École de la libre recherche scientifique, le doyen François Gény10. En mettant dos à dos le légalisme et la liberté absolue du juge, l’idéal aristotélicien de la justice est une forme d’objectivisme judiciaire qui se présente comme un désaveu des conceptions subjectivistes du droit.
II. L’idéal dworkinien de la justice
Cet anti-formalisme teinté de cognitivisme qui magnifie le rôle du juge, repérable dans l’œuvre d’Aristote, trouve sa réplique contemporaine au sein d’une mouvance importante de la philosophie judiciaire anglo‑saxonne dont les travaux de Ronald Dworkin11 me semblent particulièrement représentatifs. Ronald Dworkin s’est éteint le 14 février 2013 des suites d’une leucémie, à Londres, à l’âge de 81 ans. Cet immense juriste et philosophe du droit américain, qui fut l’élève de Herbert L. A. Hart, prit le contrepied de son maître en construisant une critique du positivisme juridique. Fondée sur la thèse que le droit n’est pas réductible aux seules règles formelles édictées par le législateur mais se loge aussi – et surtout – dans les principes moraux opposables à l’État, la critique du positivisme dressée par celui que d’aucuns surnommaient « l’élève ingrat » du maître d’Oxford s’avère assez proche des théories du droit naturel. Mais contrairement à la plupart des défenseurs du droit naturel, Dworkin cultive son jusnaturalisme avec un point de vue « de gauche » qui, tout en le maintenant dans une posture hostile au relativisme éthique, le conduit à soutenir des thèses libérales, garantes des valeurs de liberté et d’égalité. En un mot, Dworkin fut le philosophe du droit qui a incarné, outre-Atlantique, le courant le plus puissant en faveur de la démocratie constitutionnelle alimentée par l’activité judiciaire de la Cour suprême au service des droits individuels.
Cet enthousiasme pour l’activité prétorienne du juge a conduit le juriste et philosophe américain à accorder à celui-ci l’aptitude extraordinaire à combler, sans pour autant gouverner, les lacunes des règles formelles posées par le législateur. Il a fait naître une légende qui constitue peut-être un obstacle à une juste et lucide connaissance de la réalité judiciaire et qui entretient le mythe de l’objectivité des juges : celle du juge herculéen. Issu du vocabulaire de Ronald Dworkin, cet idéal de justice désigne ce juge qui, selon le philosophe du droit américain, serait capable d’effacer, au-delà des décisions particulières qu’il rend dans chaque espèce, tous les malheurs du monde et les difficultés de la société que le législateur défaillant ne parvient pas, lui seul, à prévenir. À l’image d’Hercule, héros mythologique et travailleur acharné, le juge serait un personnage extrêmement puissant qui aurait toujours l’aptitude à découvrir dans chaque cas litigieux, au-delà d’une stricte application des règles du législateur, les principes lui permettant de livrer la réponse juste que la société attend.
En se plongeant dans la culture juridique de Dworkin, on s’aperçoit que cette idéalisation du juge renvoie en réalité à une tradition anglo-saxonne qui remonte aux origines et à la philosophie du common law dont l’un des théoriciens les plus classiques est Sir Edward Coke (1552-1634) qui fut lui-même un juge et un parlementaire. Contemporain et rival de Thomas Hobbes au XVIIe siècle, Coke défendait, face à son contradicteur, un idéal de justice selon lequel il existerait, par-delà la volonté subjective du législateur, un ordre juste et naturel que le juge, doté d’une lumière et d’une raison artificielles issues de sa formation spécialisée et inaccessible au profane, serait en mesure de découvrir de façon casuistique. Cette approche cognitiviste du raisonnement judiciaire aux termes de laquelle le juge peut connaître objectivement le juste sans que cette cognition ne soit la manifestation d’un quelconque pouvoir normatif est aux antipodes de la conception sceptique et subjectiviste de Hobbes pour qui, à l’instar de celle du souverain, la décision du juge est l’expression de l’autorité et non de la vérité. Elle fait du common law britannique une famille de pensée juridique plus proche du droit romain et de ses fondements aristotéliciens que ne l’est la famille du droit continental et romano-germanique12. C’est également à cette conception, contrairement à ce que diffuse depuis la Révolution française la vulgate légaliste, que se ralliait Montesquieu, grand admirateur de la culture anglaise lorsqu’il évoquait, dans L’esprit des lois, le juge‑bouche de la loi. Magistrat lui-même, Montesquieu n’avait aucun intérêt sociologique à revendiquer la réduction de la fonction de juger à une simple tâche d’exécution de la loi du souverain mais s’efforçait plutôt de conjurer les craintes qu’inspirait le pouvoir judiciaire en le magnifiant au moyen d’une formule consistant à laisser entendre que si la décision du juge est inoffensive, c’est parce qu’elle reflète et fait parler la loi naturelle incarnée notamment par la coutume ou les lois fondamentales du royaume. En cela, le Président à mortier du Parlement d’Aquitaine qu’était Montesquieu, baron de la Brède et attaché à son appartenance à la noblesse de robe, qui regardait avec beaucoup de suspicion la montée en puissance, au royaume de France, de la monarchie absolue, n’était pas un authentique Moderne mais s’affichait plutôt comme un prélibéral aristocratique nostalgique d’une époque où le monarque était bridé par une puissante aristocratie jalouse, à l’image de ce qui se passait outre-Manche, de ses libertés particulières et locales. Entretenu par la culture anglo-saxonne, cet idéal de justice selon lequel le juge, par enchantement, serait doté d’une raison objective plus performante que celle du commun des mortels suggère implicitement qu’il existerait des solutions justes à l’aune desquelles il serait possible de repérer les verdicts erronés. À l’époque d’Edward Coke, la critique de cet angélisme judiciaire dont Ronald Dworkin semble l’héritier était donc portée par Thomas Hobbes13, ce philosophe de la peur qui n’aimait pas les controverses, car elles constituaient, à ses yeux, un redoutable germe de menaces pour le salut de l’État. Or, l’auteur du Léviathan sera l’un des modèles philosophiques de toute une théorie « décisionniste » de l’interprétation qui contribuera au désenchantement moderne, dans l’Europe continentale, de l’idéal de justice.
III. Le désenchantement moderne et continental de l’idéal de justice
Comme l’a bien montré Philippe Raynaud, le subjectivisme de Thomas Hobbes dont se nourriront les positions décisionnistes de Michel Troper en matière d’interprétation s’inscrit en opposition radicale par rapport à l’objectivisme de son rival contemporain Sir Edward Coke dans lequel l’idéal de justice défendu par Ronald Dworkin puisera au contraire ses racines14. Reposant sur la fiction du néant normatif des textes applicables, ce qu’on propose d’appeler le « décisionnisme judiciaire » est la réplique contemporaine du légalisme hobbésien15. Devant l’a-normativité du texte, le juge se trouverait dans la même situation que le Léviathan face au défaut de normativité de l’état de nature. Il doit décider : auctoritas sed non veritas facit legem. Tel est au demeurant ce que lui impose l’article 4 du Code civil français sous peine de déni de justice. L’insignifiance normative d’un texte ne saurait servir de prétexte au juge pour se dérober à cette obligation d’être libre et d’assumer souverainement son office. Tout se passe comme si cette disposition législative, caractéristique de la tradition continentale de la justice, reposait sur une certaine forme d’existentialisme juridique : la relativité des valeurs plonge l’autorité dans un néant qu’il lui appartient de combler librement. L’autorité judiciaire n’a pas le droit de dire « je ne sais pas », car le néant n’offrant rien qui puisse être objectivement connaissable, l’autorité judiciaire ne saurait invoquer une quelconque obscurité de la loi pour éluder son devoir de juger. De même que l’acte de souveraineté du Léviathan doit sa liberté au néant normatif de l’état de nature, l’acte de juger tient sa dimension purement décisionniste du néant normatif du texte qu’il convient d’interpréter.
En ce sens, comme l’a souligné fort justement Philippe Raynaud, en tant qu’héritier de Hobbes, Michel Troper produirait une théorie réaliste de l’interprétation, aux termes de laquelle le juge crée réellement le droit en appliquant les textes, frontalement opposée à la tradition de Sir Edward Coke perpétuée par l’idéalisme de Dworkin. Pétri en effet d’une philosophie anti-relativiste et d’une métaéthique cognitiviste, celui-ci considère au contraire que le juge, en interprétant les textes, découvre, mais ne crée pas le droit. Ce faisant, il incarne une forme d’idéalisme qui consiste à magnifier le juge et à dénier son pouvoir. Si Coke et Dworkin ont irrigué une large part de la culture judiciaire anglo-saxonne de cet idéal enchanté de la justice, le relativisme hobbésien a été mieux accueilli en France et en terre continentale qu’en Angleterre. Sur le continent, et notamment en France, le volontarisme de Hobbes s’incarnera étrangement dans la culture légicentriste et la tradition du légalisme qui ont prospéré tout au long du XIXe siècle. La réflexion de Philippe Raynaud nous invite alors à nous demander s’il ne survit pas, au XXe siècle, dans le succès d’une théorie réaliste de l’interprétation qui se présenterait, d’une certaine manière, comme la figure inversée du légalisme. C’est que la représentation du juge que se fait le réalisme juridique contemporain, en soulignant son activisme herméneutique et en mettant en relief sa volonté, semblerait singulièrement réactiver le mythe moderne de la souveraineté, en le déplaçant du trône du Léviathan hobbésien vers le prétoire.
Entre Thomas Hobbes et le réalisme juridique contemporain, se dessine alors un idéal de justice éminemment positiviste. Selon Thomas Hobbes, sceptique à l’égard du juge dont il niait toute aptitude à l’objectivité, l’équité n’est que la noble dénomination dont se sert le magistrat pour dissimuler habilement son pouvoir normatif. Ce subjectivisme de Hobbes alimentera toute la critique de la culture du common law qu’on retrouvera en Angleterre chez Bentham et, au-delà, chez Hart. Les positions relativistes de Michel Troper constituent une forme d’illustration de ce scepticisme à l’égard de l’angélisme judiciaire aristotélico-dworkinien. Un scepticisme, bien évidemment, qui alimente le spectre du gouvernement des juges en contribuant à détruire les illusions qu’entretient la notion d’équité sur la complétude du droit. Pour justifier l’objectivité de la démarche du juge lorsque celui-ci décide de prendre quelque liberté avec l’application littérale de la loi, Ronald Dworkin opposait en effet, aux termes d’une désormais célèbre distinction, les « règles » aux « principes ». À la source des « règles » qui, au grand désarroi légitime de l’auteur américain, sont les seules normes que les positivistes estiment susceptibles de lier le juge, il existerait des principes ou des standards. Bien que ne figurant pas toujours dans les bulletins officiels et relevant plutôt de l’indétermination inhérente au vocabulaire éthique et philosophique, ces principes « doivent être observés, non parce qu’ils permettraient de réaliser ou d’atteindre une situation économique, politique ou sociale, jugée désirable, mais parce qu’ils constituent une exigence de la justice ou de l’équité ou bien d’une autre dimension de la morale »16. En cela, Dworkin écarte le climat nihiliste dans lequel les néopositivistes jettent le juge et selon lequel en l’absence de règle applicable ou même de règle précise, celui-ci trancherait les litiges en usant de son seul pouvoir discrétionnaire. Comme le dit pertinemment Pierre Bouretz, Dworkin résout « le dilemme d’un positivisme oscillant entre l’image d’un juge automate oracle de la loi et celle d’un juge législateur doué d’un pouvoir discrétionnaire »17. La conjuration de cette cruelle alternative ne peut s’obtenir qu’en brisant le monopole de la juridicité confié aux règles pour le partager entre celles-ci et les principes. Or, le néopositivisme de Michel Troper rejette catégoriquement l’idée selon laquelle il existerait des méthodes d’interprétation objectives, destinées à corseter l’activité interprétative des juges. À l’inverse de Ronald Dworkin, le théoricien français estime que le juge n’appuie pas sa décision sur des principes, mais masque sa volonté politique derrière des principes. Ceux-ci sont des leurres artificiellement créés pour justifier la décision judiciaire et dissimuler sa dimension arbitraire18.
Cette théorie décisionniste cultive une vision pessimiste et sceptique de la justice qui plonge ses racines dans le farouche désaccord qu’opposa Hobbes à Coke au sujet de la raison que mobilise le juge pour exercer son office. J’ai souligné plus haut qu’Edward Coke avait établi une distinction, que Hobbes reprendra en se positionnant contre lui, entre la raison artificielle du juge et la raison naturelle du profane. Pour le cognitiviste qu’était Coke, le juge est doté d’une raison artificielle qu’il aurait acquise en faisant des études de droit ou dans le cadre de son expérience d’ancien barrister. Parce qu’il a une connaissance savante du droit, le juge serait un expert dont les décisions peuvent être appréciées en termes de vérité ou de fausseté. Il est un être différent du commun des mortels et cet idéal de justice, cultivé par Coke, trouverait sa réplique dans celui que Dworkin développe en magnifiant le juge et en le comparant à Hercule. Une vision angélique à laquelle Hobbes opposait l’image désenchantée d’un juge qui est simplement doté d’une raison naturelle et traversé, comme chacun, par ses propres préjugés et ses émotions. L’émotivisme de Hobbes justifie alors son scepticisme à l’égard des juges auxquels il serait dangereux de confier le pouvoir du dernier mot. On peut faire observer que dans le prolongement de cette conception émotiviste et hobbésienne du juge, s’inscrit la « théorie du lit de justice »19 que Vedel défendait dans les années quatre-vingt-dix pour justifier la légitimité du contrôle de constitutionnalité des lois. Selon cette doctrine, les décisions du Conseil constitutionnel, dont les membres ne sauraient être magnifiés, sont le reflet d’émotions qui ne permettraient pas, sans qu’il en résulte une grave atteinte à l’équilibre démocratique des institutions, qu’elles échappent à la possibilité d’être infirmées par une révision de la Constitution que le doyen Vedel assimilait au lit de justice prononcé par le roi pour casser les arrêts des Parlements d’Ancien Régime.
Il semble également permis de penser que les institutions françaises mises en place en 1790, à l’instar du référé législatif, s’inscrivent dans cette tradition sceptique et émotiviste de la raison judiciaire. On aurait tendance à considérer que les Français, au XIXe siècle, qui défendaient une définition très formaliste de l’interprétation, étaient naïfs. En réalité, la posture de ces derniers n’avait rien d’ingénu. Ils savaient fort bien que la simple lecture du Code civil ne conduit pas en soi à la découverte de la solution juridique. Leur attitude était empreinte de ce relativisme et de ce scepticisme que j’évoquais. Je crois qu’inspirés, dans une certaine mesure, par la tradition hobbésienne du droit qui fait de toute question d’ordre axiologique une question d’autorité et non de vérité, ils réalisaient bien que seule la volonté pouvait permettre d’offrir au litige une solution juridique et que le juge, traversé par des préjugés comme l’est tout citoyen ordinaire, n’était pas l’autorité la plus légitime pour mobiliser cette volonté. De là vient en partie l’institution du référé législatif. De sorte que la conviction selon laquelle le juge est la bouche qui prononce les paroles de la loi, tirée sous la Révolution de la réflexion de Montesquieu, n’était pas de l’ordre du constat empirique. Elle avait un caractère idéologique consistant à prescrire : « le juge doit être la bouche qui prononce les paroles de la loi ». Un discours normatif détourné du sens qu’avait prêté Montesquieu à son énoncé et analogue à celui de Robespierre qui voulait bannir du vocabulaire le mot « jurisprudence ». À l’idéologie cognitiviste et aristocratique du baron de la Brède aux termes de laquelle semblable énoncé signifiait que le juge, qui ne saurait être redouté, doit être perçu comme dépourvu du moindre pouvoir normatif et tenu pour l’oracle des lois fondamentales du royaume, répondait celle de la bourgeoisie, sceptique et de type émotiviste, selon laquelle le juge, qui doit au contraire être craint, est invité à contenir son pouvoir normatif illégitime pour le placer sous la tutelle de la volonté du corps législatif. À l’euphémisation aristocratique du juge, teintée d’angélisme, succédait un ostracisme révolutionnaire dont le monde judiciaire demeurera longtemps – et demeure peut-être encore – l’objet. On nous dira que le référé législatif a été supprimé sous la restauration et que l’article 4 du Code civil, lâchant la bride au juge en lui interdisant d’invoquer l’obscurité de l’énoncé législatif pour refuser de statuer, le livrait à lui-même et lui accordait, chemin faisant, une confiance analogue à celle que la tradition anglo-saxonne lui accorde. Certains ont même redouté, à la faveur de ce devoir de juger en l’absence ou malgré l’obscurité de la loi, le retour de « l’équité des parlements » en entonnant le célèbre adage : « Dieu nous garde de l’équité des parlements ! »20.
Conclusion
Quelles que soient ces interprétations, quand bien même l’article 4 a pu décomplexer le juge et susciter le recours à l’équité, ce signe de relâchement généreux à son endroit ne fut pas, pour autant, le signe d’un quelconque angélisme judiciaire en terre continentale. Les rédacteurs du Code civil n’adhéraient pas, subitement, aux thèses de Coke. Il s’agissait d’une traduction, dans le droit positif, d’une forme d’existentialisme juridique : parce que le juge ne sait rien, il doit décider. Du néant, il en tire une force, le pouvoir. D’inspiration hobbésienne, l’article 4 du Code civil fut le reflet d’un pessimisme axiologique dont se nourriront les théories subjectivistes et décisionnistes de l’interprétation qui fleuriront au XXe siècle à l’instar de la théorie réaliste de l’interprétation. Il ne manifesta pas la traduction, dans le droit positif révolutionnaire, de cet idéal aristotélicien et anglo-saxon de la justice, de type cognitiviste, qui invite à croire, en magnifiant le juge, que celui-ci est apte à connaître objectivement, pour chaque litige, la solution juste et équitable. C’est pourquoi, à l’encontre de la tradition émotiviste et hobbésienne de la justice, le cognitivisme aristotélico-dworkinien est paradoxalement un légalisme qui s’ignore pour deux types de raison.
La première tient au fait que Dworkin est un théoricien du droit de la complétude : l’existence d’une juste réponse à laquelle le juge est réputé pouvoir accéder est chez lui une conviction qui lui permet de considérer que le droit est capable de se reproduire de façon autonome. À côté des règles, se logent selon lui les principes dont la présence objective, non formelle, fait qu’il n’y a jamais de lacunes dans le droit. En présence d’une règle lacunaire ou ambigüe, le juge aurait recours à un principe qui n’existe peut-être pas formellement dans le droit positif mais qui n’en demeure pas moins du droit. De sorte que, avec Dworkin, il n’y a jamais de vide juridique. Ce qu’il reprochait à Herbert Hart et aux positivistes orthodoxes, c’était qu’en réduisant le droit aux lois formelles, ils reconnaissaient au profit du juge un pouvoir discrétionnaire qui laisse béante la question sensible du gouvernement des juges. Dworkin pensait l’avoir refermée en estimant que le juge était supposé « découvrir » les principes. Cette approche du raisonnement judiciaire, qui serait assis sur des principes objectivement connaissables, conduisait l’auteur américain, finalement, à parvenir à des conclusions proches, en matière de complétude du droit, de celles des légalistes français du XIXe siècle selon lesquels le Code civil était complet et pourvoyait à tout.
Mais surtout, cet idéal de justice, qui recommande au juge, en lui accordant une inébranlable confiance, de corriger la logique formelle de la loi pour atteindre la justice repose en effet, aux yeux des tenants du scepticisme, sur une double illusion : la croyance en la possibilité d’atteindre objectivement la justice et la foi en l’objectivité sémantique de la loi dont il s’agit de contourner ce qu’elle énonce. Il est souvent soutenu, en effet, que la doctrine de l’équité dont cet idéal dworkinien de la justice est très proche traduit une certaine souplesse vis-à-vis du texte dont elle s’émancipe. Mais cette souplesse, plus que paradoxalement, ne doit pas occulter l’immense part de cognitivisme légaliste dont elle fait preuve puisque l’invitation à s’écarter de la loi signe l’aveu implicite qu’il y a un sens de la loi. Cette souplesse est une autre théorie de l’acte clair qui consiste à regarder la loi comme suffisamment claire pour qu’on puisse s’en départir. Or, tout juriste pétri d’une philosophie sceptique de la justice, qui ne croit pas à l’objectivité de l’équité, ne croit pas non plus à l’objectivité du sens des lois. Hobbes n’accordait aucun crédit à l’objectivité sémantique des lois puisqu’il les regardait, dans la plus stricte logique de la doctrine moderne du droit naturel, comme des conventions destinées à combler le vide éthique du jus naturale dont la définition est livrée à la raison subjective de chaque individu. De sorte qu’en dernière analyse, si la doctrine de l’équité est une manifestation d’angélisme judiciaire, une idéalisation exacerbée de la justice, elle est aussi, malgré elle, une forme rampante de mythologie légaliste.