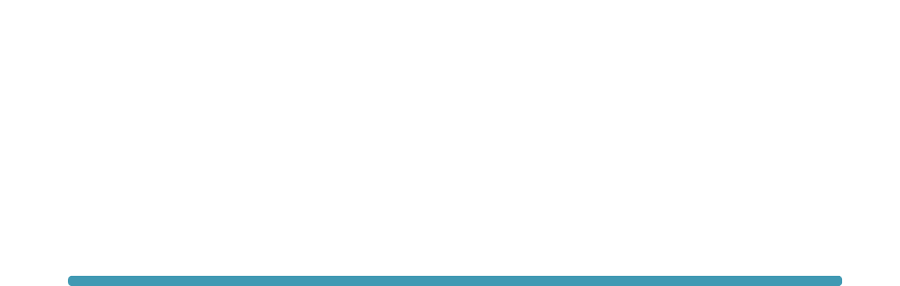Lors de la conférence organisée le 28 janvier 2021, les organisateurs ont confié à l’auteur de ces brefs propos le soin de conclure, ou, sans doute du fait de la pleine conscience que le sujet ne pouvait être épuisé par une conférence – si complète et dense fût-elle –, d’« ouvrir ». Il était, concrètement, question d’envisager, à la lumière des communications prononcées par les différents intervenants, les pistes juridiques qui s’ouvraient pour lutter contre le « septième continent de plastique ». La conférence incluait une réflexion sur la notion de « continent », prenant pour hypothèse que la qualification, en tant que telle, de l’amas voire des amas de déchets plastiques dans les océans pourrait permettre l’identification d’un régime juridique protecteur.
La première conclusion ressortant de cette journée est toutefois sans appel : l’existence du septième continent de plastique n’est ni juridique, ni géographique, ni physique ; elle est, tout au plus, discursive. Le « continent » n’a d’abord pas d’existence juridique propre, ni en droit international, ni en droit interne. L’appellation est, par ailleurs, discutée : l’on parle volontiers de « mer de plastique »1, d’« océan plastique »2 ou de « plastic soup »3, de sorte que l’expression « continent de plastique »4 ou « septième continent de plastique »5 est donc concurrencée par d’autres images, tout aussi parlantes, dans les médias et la littérature scientifique. S’il est peu commun de désigner indifféremment une étendue comme un « continent » – impliquant une évidente dimension terrestre – et comme un « océan » – impliquant précisément l’inverse, toutes ces terminologies servent le même objectif rhétorique : convaincre de l’immensité, à l’échelle globale, des amas de plastiques échoués dans nos océans.
Dans ces conditions, l’exercice de recherche du régime juridique idéal a tourné court : en l’absence de qualification juridique exceptionnelle, le droit classiquement appliqué à la mer s’applique. Celui-ci n’est pas parfaitement silencieux quant à ces phénomènes : l’on pense à la Convention MARPOL, parmi les nombreux instruments juridiques pertinents en droit international6. Mais il n’existe aucun instrument universel appréhendant le phénomène dans toute sa complexité, c’est-à-dire régulant la pollution plastique des océans depuis ses origines : la construction, la consommation de masse, la transformation vers le déchet, le rejet souvent dans les rivières et fleuves, avant l’arrivée en mer et la fraction en microplastiques destructeurs de vie océanique, voire. Autrement dit, il manque un instrument international – car la réponse globale ne peut être qu’internationale – applicable à l’ensemble du cycle de vie du plastique et impliquant le cas échéant des mesures de dépollution. Un rapide aperçu des négociations en cours7 montre, à l’instar des communications prononcées le 28 janvier 2021, qu’une telle initiative n’est pas en cours. Dès lors, et l’on admet que le droit peut être mobilisé pour aider à réguler le fait scientifique indéniable que constituent les – et non pas « le », comme l’a montré la conférence – amas de plastique se mouvant dans les océans, les pistes d’encadrement juridique doivent être recherchées de manière large, afin de répondre à la question posée en sous-titre aux intervenants : quelle appréhension juridique pour quelle réalité écologique ?
L’on se propose, de manière aussi libre que le permet la commande d’une « ouverture » sur ce thème, d’envisager deux questions liées qui ont sous-tendu une partie des échanges du 28 janvier dernier. D’une part, le « droit », en tant qu’objet ou de science, peut-il être d’une manière ou d’une autre proactif, comme le suggérait le titre exact de la contribution confiée à l’auteur de ces lignes8, sur ce sujet (I) ? D’autre part et à la lumière des réponses apportées à cette première question, le recours à la notion d’éthique environnementale permet-il d’entrevoir des solutions juridiques (II) ?
I. Le droit peut-il se « saisir » du problème du « septième continent de plastique » ?
Le titre de l’intervention initialement prononcée le 28 janvier 2021 soulevait une interrogation invitant le juriste à la réflexion théorique : le droit « doit-il » se « saisir » des enjeux liés à la pollution plastique des océans (A) ? Une fois la question reformulée sous l’angle juridique, l’on ne peut que constater les lacunes des régimes juridiques existants (B).
A. La capacité du droit à se saisir du problème ou les limites de la personnification
Se demander si le droit « doit » se saisir d’un enjeu implique d’abord, sur le plan logique, de déterminer si le droit « peut » se saisir d’un enjeu, ou de quoi que ce soit d’ailleurs. L’idée renvoie en effet à une conception anthropomorphique du droit selon laquelle celui-ci disposerait d’une autonomie intrinsèque, et serait en mesure de « décider » de « faire » quelque chose. L’on ne niera pas qu’il existe à peu près autant de théories quant à la formation de la règle de droit que de théoriciens du droit. Néanmoins, aucun, à notre connaissance, ne soutient que le droit émergerait du vide et serait habilité, par une force motrice autonome inconnue, à venir réguler tel ou tel phénomène. Renvoyant à l’idée de droit naturel, l’expression ici critiquée, qui s’apparente souvent à une commodité de langage, nous semble pourtant la dépasser de beaucoup et peut même être vue comme contreproductive, sur le plan scientifique.
Le droit nous semble, pour notre part, constituer un phénomène avant tout social utilisé par ses créateurs pour réguler d’autres phénomènes, à concurrence parfois d’autres modèles normatifs – la morale, l’éthique, l’équité, pour ne prendre que quelques domaines les plus évidents. Plus encore, dans la lignée de l’objectivisme sociologique de George Scelle – hérité notamment de Léon Duguit –, l’on peut considérer que le droit naît d’un besoin social exprimé par un groupe social donné9, lequel est « traduit » en langage juridique par le législateur ou l’autorité habilitée à le faire. D’autres penseurs considèrent volontiers que le droit ne peut naître autrement que du fait de la seule volonté d’une ou de plusieurs personnes habilitées à le dire ou à le créer. Dans les deux cas, le droit ne naît pas du néant et ne peut en aucun cas s’autosaisir d’un phénomène.
Si le droit ne peut donc se saisir d’un enjeu, il n’est pas envisageable d’estimer qu’il le « doit ». Se poser la question du « devoir » susceptible d’incomber au droit revient donc à se tromper de cible : le droit n’est qu’un outil de régulation des rapports sociaux. Il peut être mobilisé ou peut ne pas l’être ; il peut être sollicité à bon escient ou l’être pour satisfaire des besoins sociaux contraires à l’intérêt général ; il peut être préféré à la régulation par la morale – ou à l’autorégulation – ou s’y substituer. Dès lors, la question n’est plus de savoir si le droit doit se saisir de l’enjeu de la pollution plastique des océans, mais celle de savoir s’il est mobilisé à cet effet, par qui, de quelle manière, et dans quel but et pour quels effets ; dans la négative, pour quelles raisons et du fait de quelles forces sociales contraires.
Cette difficulté théorique surmontée, les réponses apparaissent avec évidence : les acteurs pertinents ne mobilisent pas suffisamment les outils juridiques pour limiter cette pollution.
B. Un manque de volontarisme public pour faire face au problème global
Pour se convaincre des limites des discours publics, il suffit de parcourir rapidement – et nécessairement schématiquement – les trois principaux niveaux de décision publique. Le premier ordre juridique « public » qui vient à l’esprit est l’État. Par sa législation, l’État peut agir significativement sur le problème mondial posé par la pollution plastique des océans, quand bien même ses conséquences sont assez éloignées de lui – l’on pense par exemple à l’État enclavé, que la présence de plastiques à des milliers de kilomètres de ses frontières pourrait ne pas intéresser. Pourtant, le problème est bien global : la pollution plastique anéantit peu à peu la vie dans les océans, et a des répercussions dans l’ensemble de la chaîne alimentaire. Il est donc logique que les États s’en saisissent.
En la matière, l’on peut, grossièrement, constater l’existence de trois grandes « catégories » de positions juridiques dans le monde. D’une part, certains États sont proactifs, par leurs législations et par les positions qu’ils défendent au sein des enceintes internationales pour parvenir à une réduction effective de ce « continent plastique ». C’est le cas des États nordiques comme la Norvège ou le Danemark, et de quelques autres États isolés. L’on pense par exemple au Kenya, qui a été le premier à interdire les sacs plastiques à poignées sur le sol national en 2017 et à prévoir des peines dissuasives – par exemple une peine prison d’un à quatre ans10. D’autre part, certains États peuvent être considérés comme des « suiveurs », s’abstenant d’initiatives, mais épousant le cours des évolutions mondiales sur la question. Tel est notamment le cas de la France, qui, par la loi du 10 février relative à la lutte contre 2020 le gaspillage et à l’économie circulaire, s’aligne sur les standards européens en matière de vente en vrac et de substitution du plastique d’emballage11. Malgré ces engagements et évolutions récentes, avec 2,2 millions de tonnes d’emballages plastiques circulant sur le marché chaque année et un taux de recyclage d’à peine 27 %, il reste encore beaucoup à faire pour hisser la France aux standards minimaux permettant d’espérer une réduction significative du rejet de matières plastiques dans les océans12. Enfin, un troisième groupe d’États brille par son silence sur la question, comme les États-Unis et la Russie13.
Ces dispositifs nationaux, parfois ambitieux, ne suffisent en tout cas pas, en l’absence de duplication mondiale, à endiguer le flot de plastique déversé chaque année dans les océans du fait des activités de pêche (20 % du total) et surtout des activités terrestres, dont les déchets sont charriés vers la mer par les plages ou les fleuves. Ainsi, un rapport récent de l’Union internationale pour la conservation de la nature constate que près de 230 000 tonnes de plastique sont encore déversées annuellement dans la Méditerranée, malgré des législations de plus en plus protectrices14. Même si la tendance va vers le positionnement dans le premier ou le deuxième groupe d’États – par exemple, la Chine, qui cherche aujourd’hui à affirmer son leadership sur le problème, mais peine à convaincre avec les 300 000 tonnes de plastique déversées en mer chaque année rien que par son fleuve principal, le Yang-Tsê15 – les efforts restent trop dispersés pour que de véritables solutions émergent au niveau local.
Les initiatives régionales sont, pour leur part, peu significatives. La plupart des organisations internationales régionales sont soit centrées sur le développement économique de la région et n’ont donc pas la compétence ou pas la volonté de statuer en la matière, soit dédiées aux droits humains qui incluent rarement des dispositions permettant une protection de l’environnement aussi étendue. Certaines organisations régionales sont néanmoins proactives ; l’on pense au Conseil des ministres de l’Environnement et du Climat du Conseil nordique qui appelle depuis 2019 à un accord mondial sur le problème16, à la Communauté des Caraïbes17, ou encore à l’Union européenne dont la fameuse « directive plastique »18 a d’ores et déjà amené la France à faire évoluer sa législation. Si ces avancées sont porteuses d’espoir, l’on sait néanmoins que l’océan est vaste : c’est un accord international dont la société internationale a besoin.
Or, dans l’ordre juridique international, les dispositifs normatifs sont timides ou ne concernent pas directement la pollution plastique. Plusieurs instruments mentionnent l’enjeu et le régulent en partie : la Convention de Stockholm de 2001 sur les polluants organiques persistants, la Convention de Bâle de 1989 sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination sont les principaux. La doctrine relève néanmoins leur insuffisance19, alors même que le fameux Ban Amendment pourrait venir transformer le paysage mondial en la matière. Durement acquis puisqu’il aura fallu vint-cinq ans pour qu’il entre en vigueur, ce texte interdit à un pays développé d’exporter des déchets dangereux – y compris plastiques – vers un pays en développement, ce qui pourrait limiter les envois massifs de déchets plastiques vers les pays asiatiques ou africains de la part des États européens et américains. Toutefois, l’absence de volontarisme des États est particulièrement visible en a matière, puisque des pollueurs majeurs comme le Brésil, le Canada, les États-Unis, l’Inde, le Japon ou la Russie ne l’ont pas ratifié. Cette situation fait craindre que l’éventuel futur accord global sur la pollution plastique des océans, réclamé par la Norvège et quelques États, connaisse un sort similaire ou soit, sur le modèle de l’Accord de Paris, vidé de toute obligation contraignante pour les États et donc possiblement ineffectif20.
Au terme de ce survol – certes elliptique – des initiatives juridiques actuelles ou en projet, l’on peut dégager au moins deux conclusions. La première est que le droit ne « doit » pas se saisir de cet enjeu : sous l’angle politique, et non juridique, l’on peut penser que c’est la société internationale qui « devrait » se saisir de l’enjeu environnemental par l’intermédiaire des outils juridiques. La seconde est que par-delà les discours des États, l’état du droit ne répond pas au besoin social exprimé par la société civile ni à l’indéniable urgence écologique, de sorte qu’une forme de dissonance cognitive mondiale s’est peu à peu installée – et continue à prévaloir, au regard des débats en cours21 – sur le sujet. Comme on l’a vu, le droit n’est toutefois pas le seul outil de régulation des phénomènes sociaux ; dans cette mesure, ne faut-il pas renoncer, face aux obstacles politiques minant les avancées juridiques possibles, à mobiliser d’abord, et seulement, le droit ? Telle est la seconde question que l’on se propose ici de traiter.
II. Peut-on s’appuyer sur l’articulation entre droit et éthique pour lutter contre le phénomène ?
En partant du principe qu’il ne faut pas attendre du droit qu’il émerge tout seul et se saisisse de quoi que ce soit, l’on peut convenir que la – nécessaire, d’un point de vue tout à fait subjectif – lutte pour la réduction de la pollution plastique des océans ne constitue par un combat juridique, mais un combat politique à propos duquel il peut être intéressant de se placer dans le champ de l’éthique (A). Sur cette base, l’on peut alors envisager un retour, par des voies peut-être détournées ou à tout le moins originales, au droit (B).
A. L’intérêt d’envisager le sujet sous l’angle de l’éthique environnementale
La notion d’éthique environnementale n’est pas nouvelle22 ; elle demeure, cependant, peu exploitée dans les travaux juridiques, malgré l’existence d’une revue lui étant consacrée23. Elle a, toutefois, fait l’objet de discussions avant la Conférence de Rio, par exemple à l’Organisation internationale du Travail où un projet de Code international d’éthique écologique a été discuté – mais jamais adopté24. Il est pourtant possible de penser qu’elle pourrait être utilement mobilisée ici.
Penser un phénomène concret comme la pollution plastique de l’océan en termes d’éthique environnementale permettrait en effet de ne pas l’envisager comme un problème à traiter par la mobilisation immédiate de l’État par le droit dit « dur », mais comme un objet de « questionnement éthique »25 – ou de « doute éthique »26. Une partie de la doctrine en philosophie et en science de l’éthique considère aujourd’hui, avec Paul Ricœur, que l’éthique est ainsi, et avant tout, un processus de questionnement sur le juste et le bon. Autrement dit, la décision d’agir ou de ne pas agir pour lutter contre la pollution des océans et pour leur dépollution serait une décision fondée sur un équilibre entre ce qui est bon et ce qui ne l’est pas, à un moment donné et pour une société donnée – le caractère relatif et contingent de l’éthique constituant d’ailleurs un élément de distinction possible avec la morale27. Dans cette perspective, la société civile aurait alors un rôle tout à fait majeur à jouer pour faire connaître aux États ce qui lui semble bon ou pas, sur la base de données scientifiques dont chacun dispose. Poser la question en termes d’éthique environnementale et faire reconnaître universellement son existence en tant que « problème » objet de doute dans le champ de l’éthique aurait donc pour effet possible de placer le débat sur le terrain du « bon » et du « juste », dont le retentissement médiatique comme politique est indubitablement plus favorable que celui des questions de responsabilités juridiques. Par ailleurs, ce positionnement permettrait d’inscrire la question de la dépollution et de la limitation de la pollution plastique dans un marché, l’éthique étant potentiellement un produit commercial et marchandisable28.
Le droit, certes, est censé être hermétique aux questions éthiques et morales. Tel est, à tout le moins, l’héritage des premiers positivistes, lesquels, pour défendre l’autonomie de la science juridique, ont, semble-t-il, cherché à démontrer la séparation du droit et de l’éthique29. Pourtant, il n’est plus niable que l’éthique infiltre en permanence le droit, de manière plus ou moins dynamique selon les époques et les domaines. En matière d’éthique animale, Anne-Blandine Caire identifie ainsi « une éthicisation du droit, ce dernier prenant petit à petit en compte de plus en plus de considérations relatives à l’éthique animale »30, mais également « une juridicisation de l’éthique par le biais du développement de normes privées »31 destinées à mettre en accord les modes de production des entreprises avec les enjeux éthiques mis en avant par une communication adaptée. Autrement dit et de manière plus large, il apparaît que l’éthique est fortement présente dans le champ juridique, et ce particulièrement dans son processus de formation. L’éthique – animale ou non – constitue à notre sens une force créatrice du droit, fondatrice d’une exigence sociale génératrice de normes juridiques : « [d] ans la réalité la règle juridique n’a été édictée que parce qu’une force sociale en a exigé l’existence, en étant victorieuse de celles qui s’y opposaient ou en profitant de leur indifférence »32. C’est donc au stade des sources matérielles du droit33 que l’éthique peut être prioritairement identifiée. En inversant le raisonnement dans une perspective objectiviste sociologique, il est alors théoriquement possible de déclencher un processus de formation d’une norme juridique en faisant connaître à un groupe social donné un enjeu éthique spécifique qu’il serait en mesure de porter. Or, la préservation des océans et de la biodiversité marine constitue ou peut constituer – au regard de la mise en danger de l’ensemble des biosystèmes planétaires – un enjeu d’éthique environnementale de premier plan. Dès lors, la possibilité de recourir au droit non comme outil volontariste – dont on voit les insuffisances – mais comme la conséquence d’un questionnement éthique partagé par un groupe social majoritaire.
B. La mobilisation possible d’outils juridiques au support de l’enjeu éthique
Si l’ensemble des acteurs et notamment la société civile voire le législateur mettent en avant le caractère éthique de la lutte contre la pollution des océans, des effets économiques se feront à notre sens ressentir et n’auront plus, dès lors, qu’à être accompagnés par le droit. C’est d’ailleurs là l’un des fonctionnements initiaux, en termes de ressors méthodologiques, de l’éthique des affaires. Autrement dit, si les opérateurs économiques polluants sont convaincus que l’éthique environnementale constitue un argument de vente et peut leur rapporter des parts de marchés, l’efficacité de la lutte peut se trouver décuplée. En exploitant le champ de l’éthique des affaires pour inciter les entreprises à innover pour dépolluer et cesser de polluer, un nouveau champ des possibles, s’ouvre en effet – et les logiques de RSE peuvent aisément, lorsqu’elles ne le font pas déjà, se saisir de la question.
Dans la perspective où les marchés se seraient positionnés plus massivement sur l’enjeu éthique identifié – par les outils de la compliance notamment, les États pourraient à leur tour tirer collectivement les conséquences de l’émergence d’un besoin éthique en coordonnant les initiatives éparses. Le principal problème de l’action interétatique en matière de pollution plastique des océans est, en effet, qu’elle s’avère à la fois fragmentée et parcellaire – les États les plus pollueurs en mer n’y étant pas toujours favorables. Plutôt qu’un accord multilatéral longuement négocié, au contenu de faible densité normative et possiblement peu effectif, l’on peut alors envisager un système de partenariat multilatéral, soutenu par les Nations Unies, en vue de la lutte contre la pollution plastique des océans.
Autrement dit, il est loisible de penser qu’une approche fondée sur l’éthique environnementale pourrait faire émerger plus rapidement, et potentiellement plus efficacement, de grands partenariats globaux visant à lutter contre la pollution plastique des océans. L’on pense à des collaborations public-privé d’ampleur mondiale, inspirés par les initiatives ayant fait leurs preuves en matière minière – comme l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives34. Ce type de structure pourrait réunir la société civile, les États et les industriels concernés à tous les niveaux par la pollution plastique : producteurs de matières plastiques, producteurs d’emballages, revendeurs, transporteurs, etc. Une « norme » commune pourrait ouvrir droit à des avantages commerciaux ou a minima constituer un enjeu réputationnel sur lequel les États pourraient s’appuyer pour faire évoluer leurs législations respectives ; l’on peut même imaginer la mobilisation de financements privés comme publique en vue d’une dépollution ou, à ce stade, de la recherche de technologies innovantes permettant de l’envisager. Une telle organisation tripartite, dont le fonctionnement en matière minière est globalement reconnu comme une réussite, permettrait ainsi de dépasser au moins temporairement les apories des débats internationaux focalisés sur la densité normative des futures obligations et sur le champ d’application d’un éventuel traité contraignant.
Plusieurs initiatives semblent aller actuellement dans un sens proche du modèle proposé, à l’instar du Partenariat de la Convention de Bâle sur les déchets plastiques lancé en 201935. Il est loisible de s’en réjouir, sous réserve de deux observations finales. D’une part, l’on ne peut que déplorer les causes réelles du lancement du Partenariat – l’urgence face à l’inaction interétatique. D’autre part, il faut constater que ce Partenariat manque pour l’instant d’ambition et de visibilité mondiale. Aussi est-il permis de suggérer que la mobilisation du discours de l’éthique environnementale, en la matière, soit plus activement mobilisée par la société civile et la société internationale.
Ce n’est donc certainement pas le droit qui doit se saisir des enjeux écosystémiques soulevés par le « septième continent de plastique », mais sans doute les juristes qui devraient se saisir du discours de l’éthique environnementale pour imaginer, et proposer à une société civile globalement demandeuse, des solutions juridiques alternatives à la recherche du « hard law » à tout prix, dont l’efficacité n’est – pour l’instant, avons-nous la faiblesse de penser – pas probante en la matière.