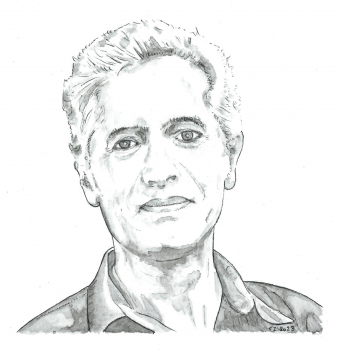
Afficher l’image
© Félix Zirgel, 2023
Arnaud Diemer : Bonjour Yves-Marie, quand on regarde le champ de tes publications, on s’aperçoit très vite qu’un grand nombre de sujets t’interpellent (le capitalisme, l’entreprise, la question de la marchandisation du travail, la mondialisation…), je me suis demandé à quel moment la décroissance est-elle devenue ton objet de recherche ?
Yves-Marie Abraham : Qu'est ce qui m'a amené à la décroissance ? Il y a d’abord le moment où j'entends parler de la décroissance pour la première fois. Je ne l'entends pas en fait, je le lis dans le journal étudiant de HEC Montréal. C'est quand même assez étonnant ! C'est par un étudiant de HEC qui revenait de l'une des premières conférences sur la décroissance à Lyon (2005). Et là je me dis, tiens, là il y a quelque chose d'intéressant. À l'époque, je travaillais en sociologie de l'économie. En tout cas, c'est ainsi que je définissais mon champ de recherche. Ce qui m'intéressait, c'était de formuler une critique de l'économie dans une perspective rigoureusement sociologique. J'étais insatisfait de ce que j'avais fait pendant mon doctorat, j’estimais que la sociologie économique donnait trop de place à l'économie.
Ensuite, j’ai été approché en 2007 par un groupe qui était en train de rédiger un manifeste pour une décroissance conviviale. Ce groupe a lancé le manifeste lors d’un colloque organisé au printemps 2007, j’ai été invité à faire une intervention. Dans la foulée de cet événement, on a créé le Mouvement québécois pour une décroissance conviviale. Nous avons fait beaucoup d’auto-formation, organisé de nombreuses conférences et pris part à d’innombrables discussions autour de textes divers, pour nous former.
Enfin, j’étais professeur à HEC depuis 2002 et en Amérique du Nord, on a droit à des années sabbatiques. J’ai pris ma première année sabbatique en 2010-2011. C’est une bonne période pour réfléchir sereinement à ce que tu as envie de faire. C’est à ce moment-là que j’ai décidé d’investir mon temps dans la décroissance. HEC m’a donné l’occasion de créer un cours de deuxième cycle sur la décroissance en 2013 (dont je fête aujourd’hui les 10 ans !).
Voilà le récit le plus simple de ce qui m’a amené à la décroissance. Mais en y réfléchissant bien, je pense que cela remonte plus loin, à mon enfance. J’ai eu un mode de vie qui, à certains égards, était très proche d’une forme de simplicité volontaire. Mes parents étaient dans cette logique là depuis longtemps et je me souviens avoir vu sur la table du salon, dans la ferme de mes parents, des bouquins de Illich, Gorz… Il y a donc des influences anciennes qui étaient déjà là et avec lesquelles je renoue aujourd’hui. Il y a peut-être aussi un lien à faire avec mon premier « objet » de recherche, quand j’ai étudié en sociologie des religions. Pendant plusieurs années, je me suis intéressé aux ermites religieux, donc des humains en rupture avec ce monde.
Par la suite, j’ai rompu avec la sociologie des religions pour diverses raisons, et j’’ai travaillé dans un institut de sondage (la SOFRES) où j’ai découvert le monde des affaires. À ce moment-là, je ne connaissais pas ce milieu – je viens d’un milieu plutôt artiste. Je découvre donc ce monde avec une certaine fascination et je me dis alors : « Ce n’est pas la sociologie des religions qu’il faut que j’étudie si je veux comprendre notre monde, c’est le monde des affaires. » Et j’ai décidé de reprendre un doctorat.
A. D : Ça se situe à quel moment de ta vie ?
YM. A : J’étais un jeune cadre dynamique à Paris, avec le titre d’ingénieur d’études, mais j’allais devenir directeur d’études, une espèce de technico-commercial, ce qui m’emmerdait beaucoup. Par ailleurs, j’avais interrompu ma thèse sur les ermites, et donc je restais un peu sur le sentiment que je n’avais pas été au bout du doctorat. Je me suis alors inscrit au doctorat à HEC Paris, à la fois parce qu’on m’y offrait des bourses et parce que je pensais que cela me donnerait plus facilement accès au monde des affaires. J’y ai fait une thèse sur les marchés financiers, intitulé « De la main invisible au travail des petites mains visibles » sous la direction de Georges Trépo et Andreu Solé à HEC (Jouy-en-Josas).
Ce n’est que plus tard que j’ai fait le lien entre le monde économique et mes premières amours intellectuelles. Je suis reparti des travaux de Durkheim (c’est lui qui m’avait fait aimer la sociologie) pour tenter de lui donner tort ! Durkheim dit que nous sommes dans un monde sans sacré, or selon moi, l’économie fait office de sacré dans notre monde. De ce fait, la décroissance est une espèce de geste de désacralisation, un questionnement de ce sacré.
A. D : Tu évoquais précédemment les livres d’Illich et de Gorz, quels sont les auteurs qui t’ont sensibilisé à la décroissance ?
YM. A : Plus que des auteurs, c’est l’anthropologie qui a été un réel déclic. J’ai été formé à l’Université de Rennes, puis à l’EHESS. À Rennes, de nombreux enseignants pratiquaient une forme d’ethnosociologie. C’est vraiment ce détour par l’anthropologie, par les sociétés dites traditionnelles qui m’a permis de questionner les fondements de l’économie et de notre civilisation. Les lectures de Pierre Clastres et Marshall Sahlins ont joué un rôle décisif. Au final, ce qui m’a amené à la décroissance, ce n’est pas l’écologie, mais la critique de l’économie, la critique du capitalisme. C’est une critique fondamentale et civilisationnelle, quelque peu éloignée d’une critique marxiste classique. Bien entendu, il y a la critique de la société de classes, de la lutte et de l’exploitation des classes. Mais ma critique était beaucoup plus profonde, elle faisait référence à l’anthropologie de l’économie, aux travaux de Polanyi et Dumont. Voilà des auteurs qui m’ont profondément marqué.
Par la suite, comme je l’ai dit, nous sommes formés entre nous à la décroissance. C’est un collègue qui m’a fait lire le petit ouvrage de Serge Latouche, Survivre au développement (paru en 2004). Cet excellent livre m’a beaucoup marqué. Par ailleurs, je me suis beaucoup intéressé à la critique de la technique. C’est un aspect majeur des réflexions que l’on a développées à Montréal, grâce à Louis Marion, collègue et ami philosophe, et l’un des rédacteurs du Manifeste pour une décroissance conviviale au Québec. C’est lui qui a fait connaître Günther Anders au Québec. Il m’a fait lire les travaux d’Ellul, Charbonneau, Illich, Mumford…
A. D : Je profite de ta référence au Québec pour ouvrir une parenthèse et te questionner à propos d’une certaine vision de la décroissance, celle qui voudrait qu’il existe une décroissance francophone teintée de radicalisme et de valeurs fortes, et une décroissance anglo-saxonne portée par la question des limites environnementales et planétaires. Quel est ton sentiment ?
YM. A : Ta question me ramène à mon parcours. Je m’explique. Si j’en suis venu à la décroissance et si j’ai pris des positions aussi radicales, c’est aussi parce que je suis venu en Amérique du Nord. Je ne suis pas sûr que si j’étais resté en France, tout ceci se serait passé de la même façon. Même si le Québec n’est pas les États-Unis, ça a été un choc d’arriver dans cette province du Canada. Le Québec, c’est l’Amérique du Nord, il y a quand même une adhésion au capitalisme et au progrès beaucoup plus forte qu’en France. Quand tu arrives de France, où il y a une sensibilité à la question de la justice sociale ou de l’écologie assez présente dans l’espace public, et que tu te retrouves dans une école de commerce à Montréal (même très ouverte sur le plan intellectuel), c’est un choc. J’ai embarqué sur la décroissance aussi par une espèce de réflexe de refus de la vision du monde qui dominait autour de moi, celle de l’Amérique du Nord toute puissante et sûre d’elle-même, mais qui fonce droit dans le mur. Ça, c’est un point majeur.
Maintenant, et pour en revenir à ta question, il est intéressant d’évoquer le fait que nous avons organisé en 2012, l’une des grandes conférences sur la décroissance, dans le prolongement de celles de Paris et Barcelone. La suite a un peu mal tourné, notamment parce qu’il y avait dans le groupe, des chercheurs francophones (très français !) et des professeurs de Mc Gill et Concordia, deux universités anglophones. Et clairement, nous n’avions pas la même lecture de la décroissance. Les francophones avaient une position plus radicale, plus fondamentale et existentielle. Cette position était à la fois anticapitaliste et technocritique. Mes collègues anglophones avaient quant à eux une position relativement proche du développement durable et plus libérable, proche de celle de Herman Daly, il me semble. D’ailleurs, ils ont invité à l’époque Peter Victor (York Université), qui était l’un des rares canadiens travaillant sur la décroissance et qui avait une approche sensiblement voisine de celle d’Herman Daly. Une vision assez éloignée de la nôtre. Pour nous, la décroissance signifiait forcément une transformation sociale, une transformation des institutions fondamentales de nos sociétés. En fait, cela supposait une révolution au sens sociologique du terme, là où Herman Daly et Peter Victor essayaient de trouver un compromis, pour des raisons essentiellement écologiques, mais avec les mêmes institutions en place. Il s’agissait de penser un ralentissement qui nous éviterait d’exploser les limites planétaires. On n’était donc pas sur la même longueur d’ondes.
A. D : Au vu de ton historique de la décroissance au Québec, quel regard portes-tu aujourd’hui sur les travaux sur la décroissance, ou tout du moins ceux qui s’en revendiquent ?
YM. A : Ce n’est pas facile de répondre à cette question. D’une part, il y a désormais beaucoup de travaux sur la décroissance. D’autre part, je n’ai qu’une vue partielle de ce qui se fait. Un de mes gros handicaps dans la vie et l’une des raisons pour lesquelles je suis venu au Québec, c’est que je voulais travailler en français, et donc je ne travaille pratiquement pas en anglais. Je n’écris pas en anglais et je ne le lis que quand vraiment, on m’a convaincu que c’était intéressant. Il y a donc une très grande part de la littérature qui m’échappe.
Mais je serais tenté de répondre à ta question par l’intermédiaire de l’excellent texte d’André Gorz, l’écologie politique entre expertocratie et autolimitation, paru en 1992 dans la revue Actuel Marx. Il y a dans les travaux sur la décroissance, une approche de plus en plus expertocratique. La manière de poser le problème et les solutions envisagées restent entre les mains des experts. On construit des usines à gaz intellectuelles, dans le mépris le plus total de ce qu’est pour moi la décroissance. C’est ici que je rejoins les thèses de Gorz et notamment ce qu’il nomme la reconquête d’un monde vécu. La décroissance est pour moi d’abord un mouvement de refus de la domination de l’économie et de la technoscience sur nos vies. L’enjeu n’est pas seulement de sauver la nature, en calculant savamment combien de CO2 ont doit enlever de notre atmosphère, mais aussi de sauver la justice et la liberté. Et je ne crois pas qu’on tende dans cette direction quand on se lance dans de gros débats, à coups de modèles toujours plus sophistiqués, sur l’ampleur de la baisse du PIB qu’il faudrait viser pour arrêter le désastre écologique. La solution est beaucoup plus simple dans son principe : il faut en finir le plus vite possible avec la civilisation industrielle, c’est-à-dire lutter contre le capitalisme, les technosciences et l’État bureaucratique. Une bonne partie de ce qui s’écrit au nom de la décroissance aujourd’hui dans des revues scientifiques ne s’attaque pas du tout à la civilisation industrielle, mais réfléchit aux moyens de sa survie. Les auteurs de ces textes font partie du problème qu’ils prétendent résoudre.
Je vois également une autre tension au sein des travaux sur la décroissance, c’est cette distinction entre décroissance et post-croissance. C’est une intuition, mais j’ai l’impression que se revendiquer de l’une ou de l’autre, ce n’est pas la même chose. En fait, les positions les plus radicales se retrouvent du côté de ceux qui se revendiquent de la décroissance. Ceux qui évoquent la post-croissance, semblent vouloir éviter ce moment désagréable que serait la rupture éventuelle avec notre modèle de société. C’est comme si on se projetait déjà dans l’avenir, que l’on avait déjà réglé tous nos problèmes, sans avoir eu besoin d’accomplir une révolution, ni même d’y penser. Je comprends qu’on le fasse pour des raisons tactiques, pour ne pas effrayer le bourgeois (qui finance nos recherches…). Mais, je pense que pas mal de chercheurs qui se revendiquent de la post-croissance ne veulent pas effrayer le bourgeois qui est en eux !
A. D : Es-tu surpris par cet engouement médiatique, et presque populaire autour des idées véhiculées par la décroissance ?
YM. A : J’aurais une réponse presque naïve, je dirais « non » parce que les signaux sont aujourd’hui évidents, la poursuite de la croissance ne donne pas grand-chose de positif. La croissance ne tient plus ses promesses, elle ne livre plus la marchandise, comme le dit ironiquement l’une de mes collègues de Polémos, notre petit groupe de recherche sur la décroissance. Cette lecture matérialiste repose donc sur un constat : la croissance, ça ne marche plus pour une grande partie de l’humanité. L’adhésion grandissante à la décroissance n’est jamais que l’expression de cette réalité.
Après il convient de différencier ce qui se passe au Québec de ce qui se passe en France. Au Québec, on se sert beaucoup de l’exemple de la France, pour dire, « regardez en France, c’est une idée largement discutée ! ». Au Québec, la décroissance est beaucoup moins débattue, même si on constate une certaine progression ces dernières années.
A. D : La décroissance s’est emparée d’un certain nombre de défis, la baisse du temps de travail, le décolonialisme, le respect des limites planétaires, la question du genre et de l’éco-féminisme…, vois-tu des domaines ou des champs encore inexplorés.
YM. A : Je vois certains décalages à ce sujet entre la France et le Québec. Il y a par exemple un champ sur lequel je me suis ouvert, parce que ce sont des questions auxquelles plus de gens sont sensibles ici, c’est celui de la justice animale. J’ai l’impression qu’en France, cette question est moins présente. Paul Ariès a eu des paroles très dures envers la communauté végan. Je partage un certain nombre de ses points de vue, je reste cependant beaucoup plus sensible que lui à ces questions. C’est un terrain qui pourrait être développé en France ou en Europe.
À part cela, au Québec ou en tout cas au sein de notre groupe de recherche, on insiste énormément sur la critique de la technique et des technosciences. Ces questions occupent une place centrale dans la décroissance et nous amènent à prendre des positions peut être plus radicales que certains. Si tu prends par exemple l’ouvrage d’Alisa, Demaria et Kallis, Décroissance, vocabulaire pour une nouvelle ère (Écosociété, 2015), il est intéressant de noter qu’il ne contenait pas d’article sur la critique de la technique dans sa version initiale. C’est l’éditeur québécois, qui fait partie du mouvement décroissanciste, qui a soulevé le problème. C’est finalement Philippe Bihouix qui a rédigé cet article, je crois. Cet exemple est selon moi assez révélateur de différences d’approches significatives au sein du mouvement.
Cela dit, je dois avouer que je me sens très en phase avec la décroissance à la française pour reprendre une expression présente dans un ancien texte de Joan Martinez-Alier.
A. D : Quand tu parles de technoscience, tu fais également référence au débat entre Low-tech et High-tech ?
YM. A : J’entends par « technoscience » le produit du mariage entre la science occidentale moderne et la technique. C’est la science qui cesse de se contenter de connaître, comprendre, contempler le monde, mais qui se met à vouloir le transformer. Cela débouche notamment sur des procédés industriels et bien souvent des procédés qui eux-mêmes reposent sur l’utilisation de machines, donc de dispositifs équipés de moteurs, qui ont leur propre autonomie, leur propre rythme… C’est cela que nous critiquons. Évidemment, nous ne critiquons pas la technique en général. Cela n’aurait aucun sens. La technique est un phénomène humain, et même plus généralement animal. Le type de Low-tech que nous défendons se démarque et s’oppose à ces technosciences. Mais, il faut sans doute abandonner la notion de Low-tech qui fait l’objet de beaucoup de récupérations par ceux et celles qui tiennent à la civilisation industrielle. C’est que la notion de Low-tech est sans doute trop vague. Mais, je n’ai pas trouvé de terme plus adéquat. Alors je parle de « techniques décroissancistes », qui doivent satisfaire trois exigences, prises ensemble : la soutenabilité, l’accessibilité et la contrôlabilité. Il convient avant tout – et c’est le travail que je fais avec mes étudiants – de penser les techniques qui seraient cohérentes avec un monde de post-croissance.
A. D : A t’entendre, tu sembles être un décroissant convaincu, as-tu cependant des critiques à faire à la décroissance, et pour aller plus loin, te considères-tu comme un décroissant militant ?
YM. A : Je passe mon temps à défendre la décroissance, une certaine conception de la décroissance au moins, si bien que j’ai sans doute un peu de mal à en souligner les limites. Dans mes cours, je suis amené à poser les termes du débat, mais pour au bout du compte, tenter de convaincre les étudiants et de montrer que c’est la position de la décroissance qui l’emporte.
En fait, je procède en classe en distinguant mes intentions pédagogiques et mes objectifs pédagogiques. Mes intentions, c’est de convaincre mes étudiants qu’il y a péril en la demeure, sur le plan écologique, social et politique. Mes objectifs pédagogiques, c’est qu’ils comprennent l’idée de décroissance et qu’ils soient capables de la situer par rapport à d’autres idées, d’en comprendre les origines, d’en souligner les apports et les limites. C’est ensuite à eux de choisir quelles idées ils veulent défendre. Je ne donne pas des bonnes notes à ceux qui pensent comme moi !
Mais, en ce qui me concerne, j’assume très clairement la position décroissanciste. En classe, je leur dis que je vais faire l’avocat du diable, mais un peu seulement. Parce que le diable a déjà ses avocats dans la plupart des autres cours qu’ils suivent. Donc, je profite de mes trois heures par semaine pour défendre au mieux et à fond cette idée de décroissance ! Et en dehors de la classe, je milite sans cesse en faveur de la décroissance. Cela dit, je refuse d’endosser le terme de chercheur-militant ou engagé. Tous les chercheurs sont engagés. Certains travaillent plutôt à maintenir en place ce monde-ci. D’autres travaillent à essayer de le transformer en profondeur.
A. D : Tu as écrit un texte relativement court sur la collapsologie, as-tu intégré cette question de l’effondrement dans tes approches de la décroissance ?
YM. A : Pas trop en fait, et le moins possible pour être honnête. J’ai lu certains travaux « collapsologiques ». Les diagnostics qui y sont présentés, sont relativement bien faits. Mais, les pronostics sont très discutables. Cette certitude que l’on se dirige vers l’effondrement, qu’en plus on ne définit pas vraiment, est indéfendable d’un point de vue scientifique. J’ai plutôt l’impression que le désastre actuel peut durer très longtemps. Ensuite, l’idée de l’effondrement peut très vite devenir paradoxalement une sorte de fuite, puisque tout va s’effondrer, à quoi bon chercher des solutions alternatives. Il y a tout ce côté dépolitisant qui pose problème et qui a souvent été dénoncé. En gros, « c’est foutu, sauvez votre peau », avec une version française où on crée des collectifs et des communs, et un survivalisme américain dans lequel chacun a son fusil et son abri. Enfin, et surtout, il y a une forme de naturalisme chez les effondristes qui me paraît très dangereux. La cause ultime de l’effondrement serait une espèce de penchant écocidaire chez l’humain. Selon moi, il manque une analyse sociologique du désastre actuel. Au moins dans son premier livre, Servigne ne met guère en cause le capitalisme et la technoscience. Ne parlons pas de Jared Diamond et de son livre Effondrement, comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie ? (2009). Là-dessus, les critiques de Daniel Tanuro, dans son livre Trop tard pour être pessimistes ! Eco-socialisme ou effondrement (2020), ou encore celles de Patricia McAnany (Questioning Collapse : Human Resilience, Ecological Vulnerability and the Aftermath of Empire (2009)) sont incontournables. Elles sociologisent, historicisent et politisent l’analyse des effondrement passés. Ce type d’analyse débouche sur tout autre chose du point de vue politique !
A. D : Je souhaiterais terminer cet entretien par les deux questions suivantes. Quel est ton premier souvenir se rapportant à la décroissance ? Quelque chose qui t’a marqué. Ensuite, si tu devais écrire un prochain article sur la décroissance, quelles seraient tes envies ?
YM. A : Pour répondre à ta première question, cela me ramène au début de ma vie. J’ai vécu les premières années de mon existence dans des endroits sans électricité, sans eau courante, peu de chauffage, loin de tout. Donc, sans ce que l’on appelle le confort moderne. Et j’en ai des souvenirs merveilleux. Ce sont des souvenirs d’enfant bien-sûr, mais ma mère aussi parle de ces périodes comme étant très heureuses. C’est pourtant elle qui assumait le travail de reproduction… Je sais donc que ce monde « sans confort moderne » est non seulement vivable, mais très désirable à certains égards. Cela fait partie des raisons pour lesquelles j’envisage avec joie une sortie de la civilisation industrielle.
Pour répondre à ta deuxième question, je suis en train d’écrire un texte sur la décroissance en tant que reconquête d’un monde vécu, au sens de Gorz. Cela me conduit à prendre des distances vis-à-vis d’approches de la décroissance qui me semblent trop « expertocratiques ». Je pense par exemple aux travaux sur le métabolisme social. Dans une école comme HEC Montréal, la perspective du métabolisme social est redoutable car elle ramène sur terre les gens d’affaire, sur le terrain très concret des flux de matière et d’énergie, de déchets aussi. J’ai fini par réaliser, grâce à ma compagne qui travaille sur la question des déchets, que le monde des affaires est un monde qui vit dans le royaume des idées, celui des dollars. Il n’y a pas de limites à l’accumulation de dollars. Penser notre monde à partir de l’idée de métabolisme social permet de faire taire un peu ceux qui se prétendent pragmatiques et veulent nous faire la leçon sur ce terrain. Cependant, cette approche de la question écologique est très expertocratique. Elle suppose de produire de la donnée quantitative, beaucoup de données, mais surtout consiste à se représenter notre monde comme une sorte de vaste usine. Le parallèle est frappant entre les schémas d’une usine quelconque et les schémas que produisent mes collègues développant ce type d’approches. Il me semble que cette démarche d’analyse emprunte beaucoup trop aux principes du monde industriel qui est en train de nous détruire. Je me demande donc si elle ne participe pas du problème qu’elle prétend essayer de résoudre.
Cette approche, comme bien d’autres aujourd’hui, pourrait bien tomber sous le coup de la critique que formulent Riesel et Semprun dans leur excellent Catastrophisme, administration du désastre et soumission durable (2008). C’est aussi l’approche expertocratique de l’écologie qu’ils attaquent. Ils critiquent d’ailleurs la décroissance, en la soupçonnant de servir à préparer les esprits à se serrer la ceinture et à accepter des approches autoritaires de la « sobriété ». C’est contre cette idée d’un futur rationnement qu’il faut se battre. On revient ici sur la question des limites planétaires et environnementales, qui nous imposeraient de nous limiter. C’est là que des gens comme André Gorz, Ivan Illich, ou Bernard Charboneau sont essentiels. En gros, ils disent, oui il faut sauver la nature, mais il faut aussi sauver la justice et la liberté. Et ça, cela suppose de sortir du monde industriel et des modes de pensée qui l’ont rendu possible. Cela résume assez bien la triple proposition par laquelle je résume la décroissance : produire moins, partager plus et décider ensemble. Il faut tenir ces trois éléments ensemble. S’il s’agit juste de sauver notre peau sur le plan écologique, je ne suis pas sûr que cela en vaille la peine !
