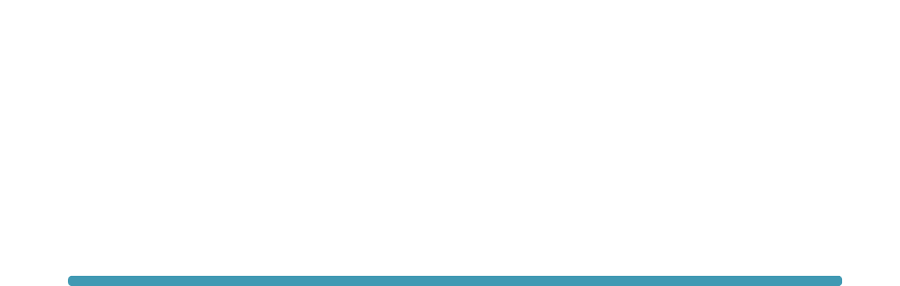Introduction
Si, après l’ouverture d’une information judiciaire, la police ne peut qu’exécuter les commissions rogatoires délivrées au cours de cette phase, en revanche, en toutes circonstances, elle n’a nul besoin d’être saisie par une quelconque autorité judiciaire, qu’il s’agisse du juge d’instruction ou même du procureur de la République, sous la direction duquel, pourtant, l’article 12 du Code de procédure pénale la place. Elle procède, dès lors, à tous actes de constatation des infractions et à la recherche de leurs auteurs, de manière totalement autonome, en transmettant ensuite les procès‑verbaux établis à cette occasion et en déférant les personnes appréhendées au procureur de la République, sur instructions de ce magistrat, lequel appréciera librement les suites à donner à la procédure. À vrai dire, cette phase particulière du procès pénal, que le Code d’instruction criminelle avait oubliée et qui est certainement fondamentale, recouvre deux sortes d’enquêtes de police.
Sous le régime du Code d’instruction criminelle, la première de ces enquêtes était personnellement confiée au procureur de la République. En particulier, celui‑ci devait, en cas de flagrant délit, se transporter sur les lieux sans aucun retard, pour y dresser les procès‑verbaux nécessaires à l’effet de constater le corps du délit, son état, l’état des lieux et pour recevoir les déclarations des personnes qui auraient été présentes ou qui auraient pu fournir des renseignements, conformément à l’article 32 du Code d’instruction criminelle.
Néanmoins, dans la pratique, tous ces actes, rentrant dans la compétence du magistrat du parquet, pouvaient être accomplis par les officiers de police judiciaire, qui, ayant la qualité « d’auxiliaire du procureur de la République », disposaient, « en l’absence de leur chef et sans délégation spéciale », de larges pouvoirs de recherche, justifiés par l’état de flagrance1. Aussi, le Code de procédure pénale est‑il venu consacrer cette pratique, en accordant expressément aux fonctionnaires de police le pouvoir de procéder à ces enquêtes.
En outre, dès le début du xixe siècle, la police judiciaire a commencé à se livrer à la recherche systématique de toute infraction, même non flagrante, et à dresser des procédures appelées « de renseignements », soit à la demande du ministère public, soit de sa propre initiative, au cours des enquêtes officieuses. Ces enquêtes, non réglementées par la loi, ont été vivement critiquées par une partie de la doctrine, qui contestait leur légalité. Malgré ces critiques, la police y avait fréquemment recours, car, comme le remarquait le professeur René Garraud, les enquêtes officieuses avaient surtout pour objet d’éclairer le ministère public et de le mettre à même « d’exercer en connaissance de cause, sa fonction de poursuite2 ». C’est pour cette raison que, dès 1817, le procureur du Roi près le tribunal de la Seine, Jacquinot‑Pampelune, recommandait aux officiers de police judiciaire de son ressort de dresser des procès‑verbaux, même hors le cas de flagrant délit3. Reconnaissant les effets utiles de cette enquête, la jurisprudence a très rapidement admis sa validité, sous certaines conditions. Ainsi, les enquêtes officieuses, acceptées d’abord dans la pratique et admises ensuite par la jurisprudence, ont été finalement accueillies par le Code de procédure pénale sous la qualification d’« enquêtes préliminaires ».
Les enquêtes de flagrance et préliminaire constituent donc la phase préalable du procès pénal, qui se révèle primordiale pour le déroulement de ce procès, puisque, comme les juges européens l’ont clairement affirmé, les preuves obtenues pendant cette phase déterminent le cadre dans lequel l’infraction imputée à une personne déterminée sera examinée au procès4. Il en est d’autant plus vrai qu’on constate, depuis vingt ans, la baisse importante du nombre d’affaires orientées vers l’instruction sur l’ensemble des dossiers poursuivis (environ 3 %), ce qui démontre l’importance de cette phase.
Ces précisions données, il convient, dès lors, d’étudier d’une part, les règles qui président à l’ouverture de chacune de ces enquêtes (I) et d’autre part, leurs traits distinctifs (II), ce qui permet de s’interroger sur l’utilité de maintenir les deux types d’enquêtes.
I. Les conditions d’ouverture des enquêtes policières permettant une action autonome
Si c’est « la proximité de l’infraction dans le temps5 » qui autorise l’ouverture d’une enquête de flagrance, tel n’est pas le cas de l’enquête préliminaire, dont la mise en œuvre n’est soumise à aucune condition particulière, si bien que son champ d’application est plus large que celui de l’enquête de flagrance.
A. Les conditions de mise en œuvre de l’enquête de flagrance
Le cadre légal de cette enquête est fixé par l’article 53 du Code de procédure pénale. En particulier, ce texte définit la flagrance en tenant compte d’un critère temporel. Il s’agit de l’hypothèse où un crime ou un délit « se commet actuellement » ou « vient de se commettre » ou de celle où :
Dans un temps très voisin de l’action, la personne est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.
C’est donc « l’actualité de l’action6 », qui justifie le déclenchement de l’enquête de flagrance, « dont le fondement essentiel demeure l’espoir de découvrir la personne soupçonnée par l’exploitation des premiers éléments recueillis7 ».
Il est vrai que le législateur a évité de fournir une indication précise quant au temps au‑delà duquel il ne saurait y avoir flagrance. Dans le silence des textes, la jurisprudence s’est montrée, dans un premier temps, assez rigoureuse, en réduisant parfois le délai de flagrance à quelques heures dès la commission de l’infraction. Ainsi, a‑t‑il été jugé que le silence de la victime pendant un délai de treize heures exclut toute possibilité de déclencher une enquête de flagrance8.
Mais, par la suite, la Cour de cassation a progressivement amorcé un virage vers une conception large du flagrant délit. Elle n’a donc pas hésité à admettre que le temps très voisin de l’action peut avoir une durée de vingt‑quatre heures9. Dans l’affaire « Trignol », la Haute juridiction a estimé qu’il y avait flagrance quatre jours après la commission de l’infraction, au motif que le crime de séquestration est une infraction continue10. Cette solution extensive a d’ailleurs été confirmée par une jurisprudence plus récente, ayant déclaré régulière une perquisition, suivant la procédure de flagrance, au domicile d’une personne, dès la réception de la plainte de la victime qui, impressionnée par des risques de représailles, n’a porté les faits à la connaissance des services de police que deux jours plus tard, à l’incitation d’un membre de sa famille11. En revanche, la flagrance ne se trouve pas caractérisée lorsqu’un crime a été révélé six jours après sa commission12.
Il faut bien reconnaître que le législateur aurait pu mettre fin à toute incertitude, en précisant le temps pendant lequel la police peut légitimement se saisir en flagrance, d’autant plus que certaines propositions ont été formulées en ce sens. Parmi celles‑ci, on pourra, notamment, retenir la préconisation de la « mission de réflexion sur les possibles évolutions de la procédure pénale », instituée par le garde des Sceaux en janvier 2014 et présidée par M. le Procureur général Jacques Beaume, qui s’est demandé si le législateur ne devrait pas retenir un « délai limite » de quarante‑huit heures.
À notre avis, l’état de flagrance ne devrait en aucune façon être admis au‑delà de vingt‑quatre heures à compter de la commission de l’infraction13.
Mais, en dehors du critère temporel, auquel la loi se réfère expressément pour définir la flagrance, la jurisprudence en a dégagé un autre, celui tiré de l’apparence de l’infraction14. Ce critère a été expressément consacré par la Chambre criminelle, dans le célèbre arrêt « Isnard15 ». En l’espèce, une personne ayant simplement la réputation de se livrer au trafic des paris sur les courses, a été arrêtée par des commissaires de police qui, après avoir pratiqué sur elle une fouille, l’ont trouvée porteuse de fiches. La Haute juridiction a considéré que la cour d’appel d’Aix‑en‑Provence avait déclaré, à bon droit, irrégulières l’arrestation et la fouille, dont cet individu avait été l’objet, au motif que le simple fait qu’il « avait la réputation de se livrer au trafic des paris aux courses n’autorisait pas un commissaire de police, sans mandat du juge, à le fouiller dans la rue, alors que la possession des fiches ne lui était révélée par aucun indice apparent ».
Puis, la nécessité d’une apparence a été réaffirmée avec force dans le fameux arrêt « Gomez‑Garzon16 ». En l’espèce, la Chambre criminelle a jugé qu’en l’absence d’indices apparents d’un comportement délictueux pouvant révéler l’existence d’une infraction flagrante, la perquisition pratiquée dans la chambre d’hôtel occupée par l’intéressé aurait dû, pour être régulière, être accomplie après que celui‑ci a donné son assentiment à l’opération. La solution adoptée nous paraît parfaitement justifiée. La police, étant à la recherche d’un délit précis (détention de stupéfiants), découvre d’autres infractions qu’elle ne soupçonnait même pas ; or, avant son intervention, aucun indice apparent ne venait établir l’existence de ces infractions. Par conséquent, les policiers ne pouvaient se saisir en flagrance.
Depuis, la Haute juridiction a, à plusieurs reprises, déclaré que l’état de flagrance est établi, dès lors que les officiers de police judiciaire relèvent des indices apparents d’un comportement délictueux. Ces indices doivent révéler l’existence d’une infraction qui répond à la définition de l’article 53, al. 1er du Code de procédure pénale17. Ainsi, la présence d’une arme, visible dans la boîte à gants disloquée d’un véhicule accidenté, peut constituer un indice apparent d’un délit imputable au conducteur dudit véhicule18. De même, les constatations visuelles régulièrement opérées par les policiers lors de leurs surveillances, ayant corroboré une dénonciation non anonyme des faits susceptibles de constituer des infractions de travail dissimulé et d’emploi illégal d’étrangers en cours de commission, ont constitué les « indices apparents » d’un comportement délictueux caractérisant une situation de flagrance19. Il a, en outre, été jugé que le seul marquage d’un chien spécialement dressé pour la recherche des produits stupéfiants, devant la porte d’un appartement, constaté par les fonctionnaires de police présents sur les lieux, constituait « un indice objectif apparent rendant probable la commission d’infractions leur permettant d’agir en enquête flagrante20 ».
En revanche, en l’absence de tels indices, la flagrance n’est pas établie21.
De manière constante, la tendance jurisprudentielle est d’exclure du domaine de la flagrance, ce qui est simple soupçon, renseignement ou dénonciation anonyme22. En revanche, un renseignement anonyme, corroboré par des indices extérieurs faisant apparaître un comportement délictueux, permet au policier de se saisir en flagrance23.
De même, l’avis donné par la victime d’une infraction qui vient d’être commise, peut, avant l’enregistrement d’une plainte régulière, constituer les indices apparents d’un comportement délictueux24. Il nous semble cependant que, dans cette hypothèse, la Cour de cassation commet une confusion entre « apparence » et « connaissance ». L’apparence, c’est ce que tout citoyen pourrait constater, tandis que la connaissance, c’est l’information du service de police. Si la victime vient faire une déclaration à la police, le service récepteur a connaissance d’une infraction inconnue de tous et qui ne peut être considérée comme apparente. En revanche, dans le cas d’une personne qui quitte rapidement un restaurant sans payer, il y a ici flagrance, même si la plainte de la victime n’a pas encore donné lieu à la rédaction d’un procès‑verbal régulier. Car, pour nous, ce n’est pas la déclaration de la victime ou d’un tiers qui est l’indice apparent, mais la possibilité pour tous de constater la situation délictueuse.
Ces réserves formulées, les éléments susceptibles de caractériser l’état de flagrance peuvent aussi être obtenus par la mise en œuvre d’une autre procédure, administrative ou judiciaire. Plus précisément, la Cour de cassation admet la flagrance, dans l’hypothèse où un contrôle d’identité est l’occasion de mettre en évidence une infraction qui se commet actuellement, mais qui jusque‑là était occulte25. Tel peut être le cas des infractions d’usage de faux documents administratifs et de faux passeports ou d’irrégularité au regard des lois sur le séjour des étrangers26 qui, susceptibles d’être révélées par la présentation de ces documents, peuvent donner lieu à des enquêtes de flagrance27. De même, une perquisition administrative peut faire apparaître un délit flagrant28.
Pour notre part, nous sommes favorables à la saisine de la police en flagrance, dès qu’est révélée une infraction au cours d’une opération administrative régulière. C’est qu’en effet, la constatation d’une telle infraction se situe dans les finalités de la procédure administrative. Ainsi, puisque la loi autorise, à certaines conditions, des contrôles d’identité, les infractions d’usage de faux documents administratifs, de faux passeports ou d’irrégularité au regard des lois sur le séjour des étrangers, révélées par la présentation de ces documents, peuvent donner lieu à des enquêtes de flagrance, car ces infractions sont devenues apparentes, sans qu’il y ait besoin de pratiquer une perquisition ou une fouille corporelle. Il faut cependant que l’opération administrative soit régulière pour que cette apparence légitime la procédure judiciaire subséquente.
En revanche, nous exprimons certaines réserves quant à l’adoption de la même solution, dans l’hypothèse où la révélation se situe dans le cadre d’une opération de police judiciaire. Une jurisprudence constante affirme que les indices apparents d’un comportement délictueux peuvent être découverts à l’occasion d’une opération de police judiciaire, fût‑elle effectuée dans le cadre d’une enquête préliminaire. C’est qu’en effet, la police judiciaire, agissant en enquête préliminaire, peut se saisir en flagrance, dès l’instant où elle relève des indices faisant apparaître une infraction qui répond à la définition de l’article 53 du Code de procédure pénale29. Il en est de même lorsque les indices sont relevés à la suite d’une surveillance policière30.
À vrai dire, le passage d’une enquête préliminaire à une enquête de flagrance a pour conséquence de rendre peu étanche la frontière entre les deux enquêtes, qui poursuivent cependant des finalités autonomes, et de favoriser les éventuels détournements de procédure. De même, est loin d’être à l’abri des critiques, la jurisprudence qui valide les saisies incidentes, en adoptant ainsi une conception large de la notion de flagrance. Il s’agit de l’hypothèse où l’officier de police judiciaire, agissant dans le cadre d’une enquête de flagrance ou sur commission rogatoire du juge d’instruction, découvre incidemment une nouvelle infraction, auquel cas il estime être en droit de se saisir en flagrance31. Ainsi, une perquisition justifiée par une infraction déterminée peut permettre la découverte d’autres infractions.
À notre avis, cette manière de procéder ne doit pas être admise. Pour que l’on puisse considérer que l’officier de police judiciaire est en droit de mettre en œuvre les pouvoirs de la flagrance, il faudrait que celle‑ci existe antérieurement à la perquisition ; à défaut, il est clair que c’est la perquisition et rien d’autre qui a permis la saisie. C’est qu’en effet, la flagrance doit être préexistante à la perquisition et non postérieure à celle‑ci. Dans une telle hypothèse, il appartient au fonctionnaire de police d’ouvrir une enquête préliminaire et de solliciter du chef de maison l’autorisation d’opérer la saisie incidente32. Si la personne perquisitionnée refuse, l’enquêteur a l’obligation d’aviser rapidement le procureur de la République du lieu de l’opération. Si ce magistrat l’estime opportun, il saisira le juge d’instruction, lequel pourra à son tour délivrer une commission rogatoire, permettant alors à l’officier de police judiciaire de pratiquer coercitivement la saisie des objets relatifs à la nouvelle infraction. Mais, en attendant qu’une information judiciaire soit ouverte, l’enquêteur doit prendre « toutes mesures conservatoires de garde et de surveillance33 ».
Telles étant les conditions d’ouverture de l’enquête de flagrance, il est permis d’étudier celles de l’enquête préliminaire.
B. Les conditions de mise en œuvre de l’enquête préliminaire
Selon les termes de l’article 75 du Code de procédure pénale :
Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux‑ci, les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d’office.
L’existence du contrôle exercé par les officiers de police judiciaire, dans le cadre de cette enquête, est établie par une mention au procès‑verbal dressé et peut résulter, à défaut, d’une mention spécifique dans les pièces de la procédure34.
Les autorités ayant donc compétence en la matière sont au nombre de deux : les magistrats du parquet et la police judiciaire. En ce qui concerne le procureur de la République, il peut arriver qu’il ait constaté personnellement la commission d’une infraction ou en ait été avisé directement par une plainte simple ou dénonciation. Dans cette hypothèse, il demande à la police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire. Le plus souvent, cette demande fait l’objet d’un écrit dit « soit transmis », document par lequel le magistrat du parquet communique copie de la plainte ou dénonciation au chef du service de police ou de gendarmerie. Dans la plupart des cas, ce document est le premier acte par lequel est déclenchée l’enquête préliminaire et auquel la jurisprudence attache un caractère interruptif de prescription.
Quant à la police judiciaire, elle a la possibilité de s’autosaisir. Dans ce cas, les officiers de police judiciaire ne sont pas tenus d’informer le procureur de la République ; par conséquent, le défaut d’une telle information ne produit aucun effet sur la validité des actes accomplis35.
L’enquête préliminaire présente incontestablement de multiples avantages.
Elle permet d’abord au ministère public de classer rapidement les innombrables plaintes ou dénonciations injustifiées qui parviennent chaque jour et qui, après une considérable perte de temps, aboutiraient à des décisions de non‑lieu ou de relaxe. En d’autres termes, seule l’utilisation de cette enquête lui donne la possibilité de se renseigner en faisant recueillir tous les éléments nécessaires à la vérification du caractère sérieux de ces plaintes et dénonciations et de l’éclairer, par conséquent, en vue de mettre en mouvement ou non l’action publique. Les enquêtes préliminaires permettent donc aux magistrats instructeurs de n’être saisis que d’affaires délicates, complexes ou importantes, de s’y consacrer pleinement et d’accélérer leur règlement.
On peut aussi remarquer que l’enquête préliminaire est rapide ; elle répond ainsi aux nécessités de la pratique, en écartant le danger de laisser dépérir les preuves qui peuvent faciliter la découverte de la vérité.
Enfin, cette enquête est simple. On n’a pas besoin de réquisitoire introductif et tant le procureur de la République que les autorités policières, proprio motu, ont le droit de décider de son déclenchement, sans que l’objet de l’enquête soit limité.
La loi et la jurisprudence ayant donc fixé le cadre des deux enquêtes, il est permis de se demander quelles sont leurs principales divergences.
II. Les traits distinctifs des enquêtes de police autonomes
Alors que le législateur réserve une place à l’« élément consensualiste » dans l’hypothèse de l’enquête préliminaire, l’élément coercitif caractérise celle de flagrance. En outre, contrairement à celle‑ci, les dernières réformes législatives ont ouvert des « fenêtres de contradictoire » pour les enquêtes préliminaires d’une longue durée.
A. L’élément consensualiste s’opposant à l’élément coercitif
Contrairement à l’enquête de flagrance dont les différents actes prévus par la loi sont exécutés de manière coercitive, les rédacteurs du Code de procédure pénale, prenant en considération les exigences jurisprudentielles en matière d’enquête « officieuse », ont posé dans l’article 76, alinéa 1er, de ce Code, la règle selon laquelle :
[Les] perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu.
Depuis l’entrée en vigueur de ce texte, la jurisprudence s’est prononcée, à plusieurs reprises, sur sa portée. Il faut rappeler, en effet, que dans de nombreuses affaires où les enquêteurs avaient estimé devoir agir en flagrance alors que l’infraction n’était pas apparente, la Cour de cassation n’a pas hésité à annuler les perquisitions accomplies sans que l’assentiment du maître de maison soit recueilli36. Ainsi, a‑t‑il été jugé que :
L’omission de cette formalité substantielle a […] pour effet de porter gravement atteinte aux droits du prévenu en mettant en cause, […], l’intérêt de l’ordre public37.
Pour garantir un consentement libre et éclairé, le législateur a prescrit un certain formalisme, en indiquant que ce consentement « doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui‑ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès‑verbal38 […] ». Il ne suffit donc pas que le consentement soit constaté au procès‑verbal par une simple énonciation de l’officier de police judiciaire, même dûment signée du maître de maison ; il est nécessaire qu’une telle déclaration soit entièrement manuscrite par la personne chez laquelle l’opération doit avoir lieu. Ainsi, le simple fait d’avoir signé un « lu et approuvé » n’est pas suffisant39. Cependant, par un arrêt du 28 janvier 1987, la Chambre criminelle a relativisé la portée de l’élément consensualiste, en déclarant que :
Si le texte constatant l’assentiment [de l’intéressé] n’est que partiellement écrit de la main de celui‑ci, la nature des passages manuscrits, et la mention, également manuscrite “lu et approuvé”, qui précède sa signature, mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer qu’il a été satisfait, en l’espèce, aux exigences de l’article 7640 C. pr. pén.
À supposer qu’un consentement éclairé ait été fourni par le chef de maison, la question se pose de savoir si ce dernier a la possibilité de revenir sur sa décision. À cet égard, la doctrine a fait valoir que, dans l’hypothèse envisagée, il s’agit d’« un contrat passé entre l’intéressé et l’enquêteur41 ». Or, ce contrat « écrit et signé est le symbole d’un engagement inviolable et irrévocable42 » ; il ne peut être détruit unilatéralement. Les citoyens peuvent autoriser ou non une perquisition. Mais, dès lors qu’ils ont consenti au début de l’enquête, ils ne devraient plus avoir le droit de revenir en arrière. Du reste, les rédacteurs du Code de procédure pénale, ayant choisi le terme « assentiment », semblent bien avoir voulu que l’accord initialement donné ne puisse en aucune façon être rétracté en cours de l’opération. Par ailleurs, cet accord du maître de maison servira de support à toutes opérations devant être accomplies dans son domicile.
Il reste toutefois qu’un doute peut apparaître relativement à la régularité des saisies ou des fouilles corporelles opérées postérieurement à une perquisition domiciliaire dûment autorisée. La question qui se pose, dans une telle hypothèse, est celle de savoir si le simple consentement à perquisitionner est suffisant pour couvrir toute saisie jugée utile. Il nous semble qu’une telle possibilité ne doit pas être admise. En réalité, il s’agit des deux opérations bien distinctes ; l’une (perquisition) porte atteinte à l’inviolabilité du domicile, tandis que l’autre (saisie) au droit de propriété. Chacun de ces actes exige donc un consentement exprès et donné en connaissance de cause. Aussi bien, en pratique, les deux consentements sont d’habitude réunis dans la même formule.
Suivant le même raisonnement, nous estimons qu’un consentement accordé par l’intéressé en vue d’une perquisition domiciliaire ne permet pas aux fonctionnaires de police de procéder à une fouille corporelle sur sa propre personne, une telle opération exigeant également un « assentiment » éclairé. Il faut bien reconnaître que la perquisition se différencie de la fouille à corps, qui constitue une mesure portant atteinte à la personnalité humaine et, en particulier, à l’intimité de l’individu. Au vu de la gravité de cette mesure, il est nécessaire qu’une nouvelle autorisation soit donnée dans le respect des formalités prévues par la loi. Ainsi, avant de procéder à la fouille à corps d’une personne détentrice d’un bijou volé, d’une arme prohibée ou de stupéfiants, l’officier de police judiciaire doit explicitement solliciter son consentement. En tout cas, le consentement du chef de maison ne peut valoir que pour lui‑même et ne saurait, en aucun cas, autoriser le fonctionnaire de police à procéder à la fouille corporelle de toutes les autres personnes présentes à son domicile. C’est qu’en effet, l’étendue du consentement doit être limitée aux seules opérations qui peuvent être pratiquées sur la personne même du chef de maison ou sur ses biens mobiliers ou immobiliers.
Ces précisions données, il est permis de constater qu’alors que le législateur avait initialement réservé une place importante à l’« élément consensualiste », des restrictions importantes y ont été par la suite apportées, en limitant considérablement sa portée.
En particulier, il est prévu que si les nécessités de l’enquête relative à un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à trois ans (la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 a abaissé le seuil de la peine d’emprisonnement de cinq à trois ans) l’exigent (ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue par l’article 131‑21 du Code pénal le justifie), le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations de perquisition et de saisie seront effectuées sans l’assentiment de la personne chez qui elles doivent avoir lieu (art. 76, al. 4, C. pr. pén.43). Il en résulte donc que l’autorisation judiciaire peut suppléer, dans la majorité des cas, le consentement de la personne perquisitionnée.
Dans ces conditions, l’« élément consensualiste » n’occupe plus qu’une place modérée, l’enquête préliminaire étant de plus en plus contraignante comme celle de flagrance. Toutefois, contrairement à celle‑ci, le législateur a introduit, dans l’enquête préliminaire, le principe du contradictoire, si certaines conditions sont réunies.
B. L’ouverture de l’enquête préliminaire au contradictoire, à la différence de l’enquête de flagrance
Dans la continuité des lois n° 2016‑731 du 3 juin 2016 ayant autorisé « l’ouverture d’une fenêtre de contradictoire pour les enquêtes préliminaires les plus longues » et n° 2019‑222 du 23 mars 2019 ayant reconnu, au profit de la personne perquisitionnée, « le droit à un recours juridictionnel effectif » (art. 802‑2 C. proc. pén.), la loi n° 2021‑1729 du 22 décembre 2021 a entièrement réécrit l’article 77‑2 du Code de procédure pénale, afin d’élargir la possibilité pour la personne mise en cause d’avoir accès au dossier de la procédure. En particulier, le nouveau texte rappelle que le procureur de la République peut, à tout moment de l’enquête, dès lors qu’il estime que cette décision ne risque pas de porter atteinte à l’efficacité des investigations, indiquer à la personne mise en cause, à la victime ou à leurs avocats, qu’une copie de tout ou partie du dossier de la procédure est mise à leur disposition et que les intéressés ont la possibilité de formuler des observations. Ces dernières peuvent notamment porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification des faits, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites.
En dehors de cette possibilité, toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction sanctionnée d’une peine privative de liberté, peut demander au procureur de la République, selon les modalités prévues par la loi, de prendre connaissance du dossier de la procédure (art. 77‑2, C. proc. pén.). Cette demande ne pourra toutefois aboutir que si l’une des conditions suivantes est remplie : la personne mise en cause a été interrogée dans le cadre d’une audition libre ou d’une garde à vue qui s’est tenue il y a plus d’un an ; lorsqu’il a été procédé à une perquisition chez la personne en cause il y a plus d’un an ; lorsqu’il a été porté atteinte à la présomption d’innocence de la personne par un moyen de communication au public. Cette condition n’est cependant pas applicable si les révélations émanent de l’intéressé ou de son avocat ou si l’enquête porte sur une infraction relevant de la criminalité organisée ou de la compétence du procureur de la République antiterroriste, domaines dans lesquels le « droit à l’information » du public revêt une importance particulière.
Saisi d’une telle demande, le magistrat du parquet peut refuser d’y faire droit, pour une durée maximale de six mois (portée à un an lorsque l’enquête porte sur une infraction relevant de la criminalité organisée ou de la compétence du procureur de la République antiterroriste) à compter de sa réception, lorsqu’il estime que cette communication risque de porter atteinte à l’efficacité des investigations. Ce magistrat statue dans un délai d’un mois, par une décision motivée versée au dossier, qui peut être contestée devant le procureur général. Pendant la période d’un mois qui suit la réception de la demande, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision sur l’action publique, hors l’ouverture d’une information judiciaire, l’application de l’article 393 du Code de procédure pénale (lorsqu’il envisage de poursuivre selon la procédure de convocation par procès‑verbal ou de comparution immédiate, le procureur de la République ordonne que la personne soit déférée devant lui) ou le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (art. 495‑7 à 495‑13 C. pr. pén.). De même, le procureur de la République peut refuser de mettre à la disposition de la personne mise en cause certaines pièces de la procédure, en raison des risques de pression sur les parties ou les personnes concourant à ladite procédure.
Quoi qu’il en soit, lorsqu’une période de deux ans s’est écoulée après une audition libre, une garde à vue ou une perquisition, l’enquête préliminaire ne pourra se poursuivre, à l’égard des personnes ayant fait l’objet de ces actes et à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, sans que le procureur de la République mette le dossier de la procédure à leur disposition ainsi qu’à celle du plaignant.
Ce nouveau dispositif n’a cependant pas pour conséquence de rendre l’enquête préliminaire contradictoire. La personne faisant l’objet d’une garde à vue ou d’une audition libre continue, comme auparavant, de ne pas avoir accès à l’intégralité du dossier de la procédure. Au surplus, les jurisprudences constitutionnelle44 et européenne45 n’imposent pas un tel accès.
Si les nouvelles dispositions de l’article 77‑2 du Code de procédure pénale constituent indiscutablement un progrès par rapport à la législation ancienne, on peut toutefois s’interroger sur la portée réelle de cette réforme. C’est qu’en effet, la mise en œuvre du principe du contradictoire est laissée à l’appréciation souveraine du procureur de la République, qui évalue les raisons de nature à justifier le report de l’accès au dossier ou le refus de communication de certaines pièces. Bien que l’intéressé ait la possibilité de contester cette décision, ce recours, examiné par le Procureur général, supérieur hiérarchique du procureur de la République, aurait, à notre avis, peu de chance d’aboutir. On soulignera ici que les magistrats du ministère public « sont considérés juridiquement comme ne formant qu’une seule et même personne ; la fonction, on l’a dit, absorbe la personnalité de chacun des membres46 ».
En réalité, l’ouverture de plein droit de l’enquête préliminaire au contradictoire ne s’impose qu’à l’expiration d’un délai de deux ans après une audition libre, une garde à vue ou une perquisition. Ce dispositif est donc destiné à s’appliquer aux enquêtes préliminaires d’une longue durée, qui ne représentent en pratique qu’un nombre très faible, puisque, selon les données communiquées par les services de police et de gendarmerie, entre 82 % et 87 % des enquêtes sont clôturées dans l’année de leur ouverture47.
Mais, en dehors des dispositions précédentes, celles de l’article 706‑105 du Code de procédure pénale, applicables en matière de criminalité organisée, introduisent également une certaine contradiction dans le cadre de l’enquête préliminaire. En particulier, ce texte permet à « la personne ayant été placée en garde à vue six mois auparavant et qui n’a pas fait l’objet de poursuites », d’« interroger (sic) le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s’est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d’être donnée à l’enquête ». Lorsque le magistrat du parquet décide de poursuivre l’enquête préliminaire et qu’il envisage de procéder à une nouvelle audition ou à un nouvel interrogatoire de la personne au cours de cette enquête, l’intéressé est informé, dans les deux mois suivant la réception de sa demande, qu’il peut demander qu’un avocat, désigné par lui ou commis d’office à sa demande par le bâtonnier, puisse consulter le dossier de la procédure. Ce dernier est alors mis à la disposition de l’avocat au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la demande et avant, le cas échéant, toute nouvelle audition ou tout nouvel interrogatoire de la personne. Certes, ces dispositions laissent une place au principe du contradictoire au sein de l’enquête préliminaire.
Conclusion
La phase des enquêtes policières est la cible de toutes les interventions législatives, qui tendent, d’une part, à renforcer de plus en plus les droits de la défense au cours de cette phase, en introduisant par là‑même quelques éléments du principe du contradictoire. D’autre part, ces réformes ont eu pour effet d’étendre progressivement l’application des régimes dérogatoires, justifiant la mise en œuvre des mesures intrusives d’investigation, à la phase des enquêtes policières, si bien que la frontière entre cette phase et celle de l’instruction préparatoire est aujourd’hui peu étanche. Parmi les différentes propositions, mérite une attention particulière celle relative à l’unification des deux régimes d’enquêtes.
Il est vrai que les dernières réformes législatives nous conduisent à penser que l’« élément consensualiste », qui permettait surtout de distinguer l’enquête préliminaire de l’enquête de flagrance, n’occupe désormais qu’une place secondaire. L’enquête préliminaire devient, comme l’enquête de flagrance, de plus en plus contraignante, de sorte qu’il est permis de penser qu’on va progressivement vers une unification des deux enquêtes.
Faudrait‑il pour autant mettre un terme à une telle distinction et opter pour un cadre procédural unique ? Nous ne le pensons pas. C’est qu’en effet, les deux enquêtes répondent à des critères différents, ont leur propre champ d’application et les conditions de leur déclenchement ne sont pas les mêmes.
Avant d’envisager toute réforme, il conviendra, par ailleurs, de connaître l’historique des textes régissant les deux cadres d’enquête. Le flagrant délit a justifié, à toutes les époques et dans toutes les législations, l’application de dispositions particulières, dérogeant à la procédure de droit commun. Le législateur français, influencé par le droit romain, a adopté des dispositions comparables dans l’ordonnance de 1670, la loi des 16 et 29 septembre 1791, puis dans le Code du 3 Brumaire an IV et le Code d’instruction criminelle. Quant à l’enquête préliminaire, elle a été consacrée par le Code de procédure pénale, dont les rédacteurs ont tenu compte, d’une part, des acquis de la pratique, qui y avait largement recours en l’absence de tout texte (« enquête officieuse »). D’autre part, ils ont pris en considération un mouvement jurisprudentiel audacieux, qui avait reconnu l’incontestable utilité de cette enquête « extra‑légale », en admettant que les différents actes dressés par les membres de la police judiciaire, au cours de celle‑ci, puissent interrompre le délai de prescription de l’action publique.
Il faudra donc réfléchir sérieusement si l’institution d’un cadre unique d’enquête, tendant à satisfaire l’objectif de simplification de la procédure pénale, pourrait réellement répondre aux spécificités des situations envisagées par chacune des deux enquêtes existantes, et si cette réforme ne serait finalement pas opérée au détriment de l’efficacité des investigations.