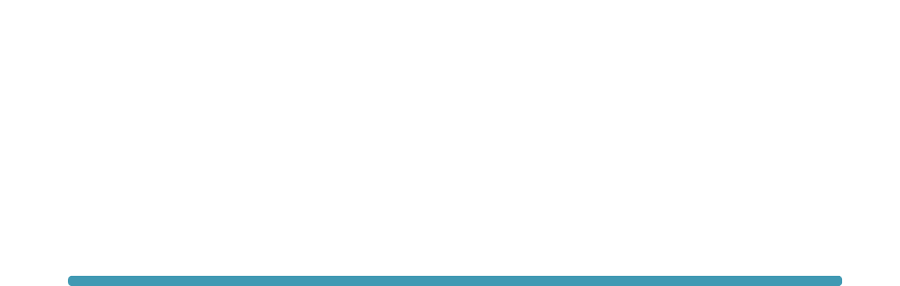Le professeur Molfessis a écrit :
L’acte de naissance n’est plus la référence, c’est l’individu qui fait foi de lui‑même1.
Il ajoute :
Le droit à l’autodétermination devient la norme fondamentale de cet ordre juridique de l’individu2.
L’État se plie à la volonté de ce dernier. Plus qu’un ressenti individuel, ces mots témoignent‑ils d’un présage appuyé de ce que sera à l’avenir l’état des personnes en droit français, voire, plus vraisemblablement, dessinent‑ils le portrait de ce qu’est déjà, au moins partiellement, cet état ?
Pourtant, si l’on se souvient, notamment3, du décret du 3 août 19624 relatif à l’inscription des actes de l’état civil sur des feuilles mobiles, l’état civil des personnes poursuit un objectif d’individualisation, de recensement et d’identification5. Alors indispensable à la sécurité juridique, cet état, que le droit prend en considération pour y attacher des effets6, ne devrait‑il pas être protégé des assauts d’une volonté individuelle, par hypothèse imprévisible et fluctuante ? N’est‑ce pas là justement la fonction traditionnellement assignée au principe d’indisponibilité de l’état des personnes ?
Naguère cardinal en jurisprudence et consacré par cette dernière7, le principe d’indisponibilité de l’état des personnes tend à dire que les droits et les éléments qui composent l’état des personnes ne relèvent point de la libre disposition des individus, mais échappent au contraire à leurs volontés individuelles8. Certes, mais ce rempart contre les volontés individuelles paraît bien aujourd’hui ébranlé par la montée d’un individualisme qui, précisément, fait une place de premier ordre aux volontés individuelles9. Portée par le droit au respect de la vie privée, que garantit la Convention européenne des droits de l’homme10, la volonté prospère, tandis que, corrélativement, la perception du rôle assigné à l’identité se mue. L’identité juridique n’est plus seulement appréhendée comme un exercice d’identification stable à travers l’état des personnes à des fins d’intérêt général. Perçue également comme la résultante de choix individuel commandé par l’épanouissement personnel de l’individu, l’identité imposée, progressivement se choisit11. Les propos du professeur Molfessis font ainsi écho.
Disponibilité contrôlée12 pour les uns, mutabilité contrôlée de l’état civil13 pour les autres, devenant l’exception, l’indisponibilité aurait laissé place à un principe opposé de disponibilité14. Apparaît alors l’association, voire l’assimilation, parfois opérée entre indisponibilité de l’état des personnes et immutabilité de l’état des personnes15. À supposer que l’immutabilité requière la permanence de l’état de l’individu et sa traçabilité dans son évolution16, elle n’est pas sans rapport avec l’indisponibilité puisqu’abandonné aux jeux des volontés, l’état de l’individu ne saurait prétendre à une permanence de principe. Indisponibilité et immutabilité, disponibilité et mutabilité sont, souvent, les deux facettes d’une même médaille.
Reste que mesurer l’étendue de l’atteinte ainsi portée au principe d’indisponibilité de l’état des personnes implique préalablement de déterminer ce que recouvre cet état des personnes. Indissociable de chaque sujet de droit en ce qu’il constitue son identité17, l’état des personnes se caractérise par diverses composantes que constitueraient, le domicile, la date et le lieu de naissance, la nationalité, la filiation, le mariage, le nom et ses attributs ainsi que le sexe. L’emploi du conditionnel s’impose dès lors que la doctrine ne s’accorde pas toujours sur les composantes de l’état des personnes.
Le domicile et la nationalité sont sujets à débat. Une partie de la doctrine estime en effet que la notion de domicile serait désormais obsolète au regard de la caractérisation de l’état civil d’un individu, estimant, pour l’essentiel, que ne devraient être retenues que des qualités relativement permanentes18, ce que n’est assurément pas le domicile. Dans le même ordre d’idées, la nationalité n’assurerait plus une identification formelle de la personne, comme cela a pu être historiquement le cas19, étant précisé qu’outre les possibilités de changement de nationalité, selon des règles énumérées par le droit interne et le droit international privé, il n’est pas rare aujourd’hui qu’un individu possède plusieurs nationalités20. La comparaison n’est toutefois pas assimilation. La très grande instabilité possible du domicile, n’est évidemment pas comparable aux évolutions que peut connaître la nationalité.
Cela étant, sous l’angle spécifique du principe d’indisponibilité de l’état des personnes, le domicile et la nationalité ne constituent pas des points d’étude tout à fait opportune, le premier étant presque exclusivement abandonné aux volontés, au mépris dudit principe, tandis que le second, sans ignorer les volontés, est objet d’une réglementation impérative complexe, qui requiert une analyse spécifique. Au demeurant, là ne sont pas les critères à propos desquels l’évolution législative et jurisprudentielle de ces dernières années conduit à interroger la réalité du principe d’indisponibilité de l’état des personnes. Aussi l’accumulation de ces considérations conduit à exclure le domicile et la nationalité de la présente étude.
L’exclusion du champ d’études a aussi été retenue s’agissant de la date et du lieu de naissance de l’individu, perçus par la doctrine majoritaire comme les composantes les plus fidèles au principe d’indisponibilité de l’état des personnes21. Il est vrai que les possibilités de modifier ces éléments, même en cas d’erreur manifeste, sont, pour l’heure, particulièrement restreintes22. Partant, il convient davantage de voir dans ces éléments, un révélateur de l’essence même du principe d’indisponibilité, que l’illustration d’une quelconque remise en cause de ce principe. Il en résulte une considération déterminante quant à la réalité du principe dans son existence. En effet, il ne peut être affirmé, d’un côté, que certains éléments témoignent avec force du principe d’indisponibilité, et, d’un autre côté, soutenir qu’un tel principe n’est plus. C’est pourquoi, et sans présager des développements qui vont suivre, la multiplication des atteintes au principe d’indisponibilité de l’état des personnes, ces dernières années notamment, semble offrir à l’observation un principe sans doute moins éradiqué, que réduit à l’état de simples « fragment de corps23 », de « reste24 », d’« ossement25 », telles des reliques.
C’est alors tant le statut personnel (I) que familial (II) de la personne qui doit être passé au filtre de cette approche métaphorique, pour que se révèle l’ampleur exacte des atteintes au principe d’indisponibilité de l’état des personnes, leurs justifications ou réprobations, leurs conséquences directes ou indirectes sur l’application du droit, et, peut‑être même, leurs incidences sur ce qui fait les fondements du droit des personnes et de la famille.