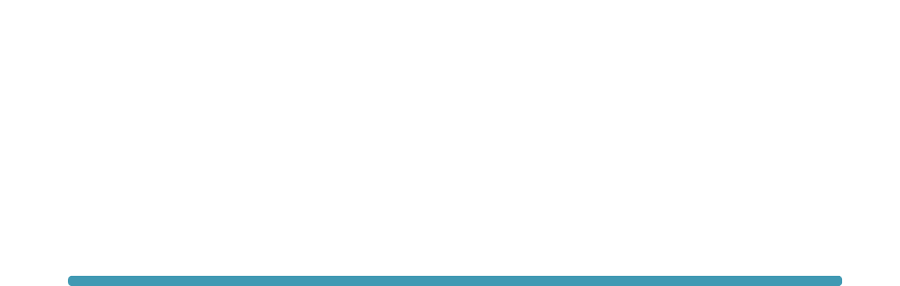Thématique complexe que celle du partage d’informations, y compris dans des domaines non explicitement assujettis au secret professionnel. Il en est ainsi parce que de multiples dimensions sont en jeu, légales et professionnelles, subjectives et institutionnelles, théoriques et idéologiques. De cet ensemble surdéterminé puisque ces dimensions hétérogènes interviennent les unes sur/sous les autres, deux points centraux nécessitent une mise au clair. D’une part, la question « déontologie-éthique », dont nous montrerons qu’il ne s’agit pas de synonymes interchangeables ; d’autre part, la caractérisation du « partage d’informations », opération bien plus complexe qu’elle n’y paraît. Autant d’éléments susceptibles de relancer le débat en le posant sur des bases critiques.
Bien entendu, les remarques ci-dessus ne visent pas à démontrer l’inconsistance, voire la pure et simple inexistence du secret professionnel, ni non plus celle du partage d’informations confidentielles. Secret et partage ne relèvent aucunement du bluff. Le propos est avant tout et surtout de les désidéaliser, d’éclairer leur fonctionnement effectif – que nous prenons soin de ne pas confondre avec leur fonctionnement supposé.
I. La déontologie n’est pas l’éthique et réciproquement
Il est courant que les termes « déontologie » et « éthique » soient utilisés comme des synonymes relativement ou complètement interchangeables – le sous-entendu étant qu’ils désignent à peu près le même objet et obéissent à des principes comparables. Il est également courant que le terme d’éthique ait un sens automatiquement et/ou implicitement positif : toute éthique est supposée s’orienter vers le bien et chercher des règles de vie saine et équilibrée. Présupposé plausible, si toutefois on ne s’attarde pas trop ni sur la nature de ce bien ni sur les contenus de ces règles… Et si, occurrence habituelle, morale et éthique sont supposées relever de la même problématique.
Bref, d’importants malentendus et des apories cliniques résultent de ces usages. C’est pourquoi nous proposons ici de séparer déontologie et éthique comme elles le sont, de fait, dans les pratiques et dans les institutions.
La déontologie désigne la morale d’un corps professionnel dans l’exercice de ses droits et de ses devoirs, le seuil et le plafond de ses attributions, les paramètres de ce qu’on peut en espérer. Sont incluses les relations entre professionnels et vis-à-vis des pouvoirs publics. Il s’agit des ordres professionnels des médecins, avocats, travailleurs sociaux ; des codes déontologiques des notaires, policiers, psychologues. Les cotisations annuelles étant couramment obligatoires, ces structures consacrent des budgets significatifs à la formation, à la défense et au conseil professionnels, à garantir les compétences de leurs adhérents. Elles jouent un rôle de groupe de pression, voire d’alliés ou d’opposants politiques.
Ordres et codes professionnels disposent de pouvoirs effectifs, variables selon les domaines, les rapports de force et les alliances. Un corpus déontologique est donc à la fois une manière de penser et d’agir en relation avec le possible, le souhaitable et l’interdit dans une profession autant qu’une infrastructure matérielle, un appareillage délibératif et décisionnel, à la fois bouclier défensif et force de frappe. Ce corpus revêt un caractère institutionnel et symbolique, tantôt formel et statutaire, tantôt informel, mais non moins structuré.
Abordons maintenant la question de l’éthique. Dans nombre d’écrits nous défendons l’idée que l’éthique ne constitue aucunement une compétence institutionnelle ni même professionnelle, mais un certain genre de relation qu’un ou plusieurs sujets, professionnels ou pas, entretiennent avec ces trois repères que sont la morale ambiante, la légalité sociohistorique, c’est-à-dire l’ordre politique en cours et enfin la déontologie professionnelle. Autant dire : vis-à-vis des idéologies hégémoniques (opinion publique, modélisations éducatives, relations de genre), vis-à-vis des lois et règlementations qui organisent les rapports sociaux publics et privés et enfin vis-à-vis des intérêts prévalant dans une ou plusieurs corporations de métier.
L’éthique est avant tout et surtout une affaire de positionnement de la part d’un ou plusieurs sujets humains, positionnement fait de consentement, de contestation ou de recherche d’alternatives, à caractère partiel ou radical, vis-à-vis des trois repères qu’on vient d’évoquer.
Une formule comme « l’éthique de l’institution » semble au mieux équivoque dans la mesure où elle identifie l’éthique à la morale, soit à un corpus de valeurs positives/négatives voué par nature à la prospection d’un bien supposé univoque et d’une sagesse tenue pour universelle. Bien et sagesse que ladite morale serait à même de repérer et de rappeler en toute circonstance. Ce faisant, elle répond à la question non posée, voire esquivée, de la spécificité de l’éthique comparativement à celle de la morale et de la déontologie. On peut en effet parler de « morale institutionnelle », ou formules apparentées, en tant que corps de doctrine qui stipule ce qu’il s’agit d’accomplir, ce qu’il faut éviter si possible, enfin ce qui – indépendamment des circonstances – est et reste à jamais inadmissible. Cette doctrine se lit dans le préambule et/ou les conclusions du projet institutionnel, dans la justification des autorisations et interdictions figurant dans le règlement intérieur, les notes de service, les canons comportementaux à observer entre salariés et avec les publics, les « éléments de langage » des discours faits au nom de l’institution, autrement dit « la com’ ». Dans tous les cas, la morale est une affaire de devoir-être et de devoir faire. Elle prescrit, puisqu’elle fixe une fois pour toutes le bien et le mal, en même temps qu’elle proscrit, car les doutes, soit n’y ont pas droit de cité, soit témoignent d’une défaillance, non de la morale, mais de celui-celle censé s’y tenir. Elle annonce les idéaux des fonctionnements institutionnels, voire l’estime, généralement la haute estime que ladite institution se porte et les tâches à jamais incontournables qui sont les siennes. Elle dit l’honneur des salariés d’en être. Par là même, surveillance, contrôle et sanction – entre les deux points extrêmes de l’accomplissement-obéissance et du déviationnisme-subversion vis-à-vis des normes hégémoniques – font partie à part entière du fonctionnement de toute morale, telle son ombre portée.
Cependant, même excessive la formule « éthique de l’institution » présente deux déclinaisons intéressantes – à moins qu’elle ne s’érige en euphémisme pseudosavant pour « morale ». D’une part, cette éthique désigne la lecture, soit l’interprétation, l’engagement, la mise en paroles et la mise en actes qu’un ou plusieurs sujets travaillant dans une organisation font de la morale institutionnelle, leur manière de l’intégrer ou de chercher à la modifier. Cette formule peut donc constituer un raccourci plausible. En faisant attention, néanmoins, à ne pas perdre de vue le rôle sine qua non du sujet humain qui porte cette éthique, soit sa responsabilité conformiste ou dissidente vis-à-vis de l’ordre existant, sa participation consciente et inconsciente à la perpétuation ou à la modification de l’ordre des choses. Rien de plus incongru que de le réduire à sa seule condition de victime impuissante1. C’est dans cette perspective qu’on peut déchiffrer les accords et les désaccords entre personnels et directions…
D’autre part, « l’éthique institutionnelle » inspire des dispositifs tels les comités d’éthique, fort usités aujourd’hui dans maintes institutions publiques et privées. Des recherches, notamment comparatives, restent à faire quant aux contenus et fonctions spécifiques de ces dispositifs, dont il n’est pas assuré qu’ils répondent à un modèle unique ni non plus qu’ils disposent de pouvoirs décisionnels identiques. Pour s’y orienter, le professeur Jean-François Delfraissy, actuel président du Comité consultatif national d’éthique, fournit une ponctuation précise : « Si des recommandations sont parfois nécessaires, il appartient plutôt au CCNE d’éclairer les enjeux, d’informer, non de prescrire de haut en bas ce qu’il convient de faire ». On ne saurait mieux évoquer la différence éthique/morale, la réflexion sur les enjeux objectifs auxquels les sujets se trouvent subjectivement confrontés et par ailleurs le diktat quant à ce que ces sujets doivent ou ne doivent pas accomplir. Même les recommandations sont des avis, pas des commandements. Dans son principe un comité d’éthique, entité de réflexion collective, ne dispose pas d’attributions de police.
Cela dit, notre insistance à lier éthique et sujets humains pourrait faire croire à un rattachement strictement psychique de la première aux seconds. Pire encore, nous ferions de l’éthique une affaire fondamentalement et strictement individuelle. Loin s’en faut ! Tout d’abord parce que des multiples définitions du terme sujet, celle de la psychanalyse nous semble la plus à même de rendre compte des responsabilités et choix des sujets, du fait que chacun est pour quelque chose dans ce qui lui arrive et dans ce qui ne lui arrive pas, à tout âge et en toute situation, même si les raisons, mécanismes et logiques des choix même mûrement réfléchis ne sont pas entièrement maîtrisés ni maîtrisables par les sujets concernés – c’est là l’hypothèse de l’inconscient. S’il peut se connaître de mieux en mieux, et même s’il le doit, comme Socrate l’enseignait déjà, le sujet reste le premier des étrangers – pour lui.
Par ailleurs, le sujet est loin d’être l’auteur souverain des situations dans lesquelles il se trouve pris. Elles ne découlent pas de son bon vouloir. Des variables économiques et politiques obéissant à leurs propres logiques sont toujours à l’œuvre, qui le dépassent de toutes parts. Il en va de même pour les décisions qu’il prend ou qu’il évite – toutes indissociables du capital culturel, des appartenances et positions sociales, des solidarités et des communautarismes de classe… On comprend alors que ces décisions entraînent des effets pas forcément voulus par celui qui, agent exécuteur, n’en est certainement pas le factotum tout-puissant. L’éthique n’est pas logée chez chacun tout en transitant inexorablement par lui.
En découle un ultime trait que nous voudrions signaler ici. À savoir, dans le réel des individus et des collectifs, dans les pratiques et dans les institutions il existe, pas du tout l’éthique, voire l’Éthique – mais bien des éthiques partisanes, des positionnements éthiques divers et variés, parfois alliés, parfois opposés les uns aux autres. Il y a des postures, des enjeux, des prises de parti à caractère éthique – non parce que des valeurs sont mobilisées, ce qui à proprement parler caractérise les configurations morales, mais parce que des attitudes, des engagements sont pris vis-à-vis de ce que dans une conjoncture donnée on tient pour le bien et le mal, en référence positive ou critique avec telle ou telle morale ou déontologie, avec ce qu’il faut et ce qu’il ne faut pas, hic et nunc. Les conceptions, démarches et actes que nous rejetons, voire qui nous inspirent une véritable horreur, constituent, eux aussi, des positionnements éthiques singuliers, des manières de penser et d’agir conformes à une certaine éthique – c’est pourquoi, justement, nos adversaires sont intimement convaincus de détenir un positionnement éthique correct et défendable tandis que notre éthique à nous nous amène à tenter de les mettre en échec. À moins de réserver l’appellation « éthique » uniquement aux conceptions, démarches et actes auxquels nous adhérons…
Loin de constituer une bulle isolée et neutre au-dessus des tumultes de l’histoire humaine, l’éthique est un espace de luttes, d’accords et de désaccords, pas forcément aimables au demeurant.
Il y a bien du devoir éthique, mais qui, à la grande différence du devoir moral, est celui que le sujet choisit comme il peut, avec ses ressources et ses limites, avec et grâce à d’autres et aussi contre d’autres. Entendons par devoir éthique la lecture-interprétation qu’un ou plusieurs sujets font du devoir moral. Dans tous les cas, aux risques et périls dudit sujet – et aux risques et périls de ceux et celles qui auront à pâtir ou à bénéficier du devoir que le sujet s’octroie.
C’est pourquoi, enfin, parler de risque éthique constitue une manière de pléonasme, d’accentuation d’un trait intrinsèque à toute posture éthique particulière. Il y a du risque dans la mesure où, dans la décision d’agir ou de s’abstenir prise par un sujet, une orientation – soit une manière de penser, de faire ou de ne pas faire – est proposée à l’ensemble des humains susceptibles d’être pris dans une conjoncture semblable. La décision prise par un sujet devient éthique – c’est là son volet programmatique – quand elle se veut à vocation universelle valable pour tout un chacun, bref une position dont le sujet qui la prend entend ne pas être le porteur exclusif.
II. Partager des informations ?
La question du partage des informations juridiques, sociales, financières, psychologiques pose d’innombrables problèmes. C’est ce que nous tentons de déployer maintenant.
Soit le secret professionnel. Il inclut un individu ou un groupe-cible immédiatement concerné ainsi qu’un professionnel ou, plus précisément, plusieurs professionnels. Plusieurs, en effet, toujours plusieurs : hormis l’indispensable interlocuteur direct et personnel affecté à l’individu ou groupe (éducateur référent, juriste en charge du dossier, médecin traitant), il y a également un ensemble plus ou moins étendu, formel et informel, de confrères et consœurs sollicités à divers titres pour aider directement ou indirectement – par des connaissances spécialisées ou en fournissant un appui moral – le professionnel-interlocuteur dans la conduite de la situation. À leur tour, consœurs et confrères sont tenus à la confidentialité des informations, c’est-à-dire à leur usage privatif et à leur mobilisation plus ou moins massive au sein du cénacle professionnel – en suivant certaines conventions. Tension constitutive qui se retrouve également dans le fait que ces personnages sont également engagés dans le recrutement implicite ou explicite d’autres professionnels dont les compétences sont censées représenter un atout dans le traitement de ces informations.
La conclusion nullement paradoxale s’impose : il y a du secret professionnel quand une information circule uniquement ou préféremment entre des professionnels. Mais ce n’est pas pour autant une affaire interpersonnelle seulement. En effet, le traitement des informations suppose des référentiels théoriques, des corpus de doctrine, des règles déontologiques, des positionnements éthiques. Sans oublier un paramètre déterminant : ce qui dans une société, au sein de ses différentes couches et classes sociales, partant dans les différents corps de métiers, est tenu pour confidentiel, secret, intime ne l’est pas forcément dans la même société à d’autres périodes et à plus forte raison dans d’autres sociétés.
C’est avec ces bagages bigarrés que les professionnels agissent, forgent, décortiquent et hiérarchisent les informations, les comprennent un peu, beaucoup ou pas du tout, réussissent à aiguiser leurs regards ou au contraire à les rendre insensibles à des dimensions pourtant significatives. C’est encore à l’égard de ces bagages que des cercles de professionnels se constituent, fonctionnent ou se défont, innovent par le recours à des analyses rigoureuses ou cultivent des rituels franchement répétitifs. C’est ainsi, dans ce cadre, à l’aune de ce cadrage et en deçà de ces contraintes que le secret est respecté et la confidentialité assurée. Nous voulons dire : pas dans l’absolu ni non plus de manière absolue.
Le secret professionnel se trouve toujours en circulation. Sa privacité est relativement ou grandement souple, selon les situations et les informations en cause, leur intérêt se trouvant indubitablement corrélé aux intérêts des professionnels qui s’en occupent ou voudraient s’en occuper. Le statut de secret requiert que nombre d’individus et de groupes en soient exclus et qu’en parallèle d’autres en détiennent l’usufruit zélé. Les contenus d’une information ne suffisent pas à octroyer à celle-ci un caractère confidentiel – sauf à dénier les conditions sociohistoriques et culturelles sans lesquelles aucune information n’en est une.
Partage des informations confidentielles. On sait que le secret professionnel ne figure pas comme tel dans toute corporation. Pour que ce soit le cas, une condition minimale est requise : un code déontologique ad hoc conforté par une instance de supervision à ce propos. Dans d’autres champs, quelques règles de discrétion, sinon de ce qu’on appelle sens commun, forgées au fil de l’histoire de la profession, suppléent cette absence.
On pourrait alors déduire que là où le secret professionnel est légalement de mise il est, à quelques exceptions près, très généralement respecté. Las, ne généralisons pas trop vite… Si nous privilégions le fonctionnement effectif sur le fonctionnement supposé ou idéal, l’affaire s’avère passablement plus complexe.
Les hiérarchies formelles ou informelles (personnel de base – chefs – directeurs) qui traversent la trame institutionnelle ne cessent de s’exercer aussi sur les modalités, la teneur, les formes et les contenus, la portée du secret professionnel. Tantôt ascendant, tantôt descendant, réservé au seul corps professionnel des travailleurs sociaux ou à celui des chefs de service ou au contraire rendu public à l’occasion de réunions de synthèse et autres dispositifs, transmis à la direction pour avis et autorisation, distillé au compte-gouttes pour en graduer l’usage et guider l’utilisation, plus ou moins prolixe ou au contraire généraliste, sinon éthéré, le secret professionnel est l’objet constant d’enjeux, préséances, méfiances et fraternités de diverses sortes. Eu égard à ces avatars, à ces jeux et enjeux, ni la texture, ni le contenu, ni même la confidentialité d’un secret ne revêtent des caractéristiques analogues pour tous ceux qui y ont accès. Si le secret circule plus ou moins largement, ce n’est pas exactement la même information qui se répand ou qui est tue. De là que des professionnels diversement situés dans la hiérarchie et diversement outillés de par leur formation n’interprètent pas une information de manière identique. Sans oublier leurs architectures psychiques respectives, ce qu’elles ont ou pas intérêt à lire, à déchiffrer, à comprendre, à divulguer ou à escamoter.
Il semble improbable que le secret professionnel, sa circulation et son partage soient indemnes de malentendus et quiproquos. Prenons le cas-prototype du « secret médical » dans les institutions sociales et médico-sociales. Périodiquement réitéré sur le devant de la scène, sa résolution s’avère très généralement malaisée. On sait qu’en hôpital ou en consultation privée ledit secret médical se trouve protégé par des corpus légaux et déontologiques et surprotégé par le statut social (de prestige) et idéologique (de savoir) des médecins, plus encore quand il s’agit de spécialistes. En revanche, dans les institutions sociales et médico-sociales la coexistence avec d’autres corps professionnels suscite quelques remous. Y est en cause, rarement le statut socio-idéologique des médecins et leurs compétences, mais le fait que les diagnostics à propos des patients ne soient pas communiqués à l’ensemble des équipes de psychologues et travailleurs sociaux ou le soient de manière sporadique et pratiquement toujours partiellement. Or, arguent ces équipes, la connaissance des profils médicaux, à la fois physiques et psychiques des usagers leur fournirait des ressources utiles à leurs exercices professionnels respectifs. Nullement pour soigner, ils n’en ont ni les compétences ni le goût, mais pour mieux comprendre des comportements et des possibilités des usagers. À son tour, l’affirmation par les médecins, souvent épaulés par les tutelles administratives, du « secret médical » clôt plus ou moins aimablement un débat qui n’arrive guère à s’instaurer.
Débat avorté, dialogue de sourds, monologues parallèles : des professionnels s’interpellent qui ont, chacun dans son domaine, quelques justifications raisonnées et raisonnables pour leurs demandes et/ou leurs réticences respectives. Mais les blocages continuent, à quelques exceptions près. Situation finalement ordinaire qui met en lumière des zones d’ombre, des limites, voire des impossibilités du partage d’informations confidentielles.
Examinons les choses de près. Il faut fixer, en premier lieu, une position de principe. À savoir, la visée effective du partage et ce que les différents professionnels espèrent obtenir grâce à lui.
La visée peut être panoptique, qui cherche à additionner ad libitum des perspectives particulières afin de parvenir à une perception complète et sans restes : il s’agit ici d’épuiser le réel. Des efforts sans cesse redoublés sont alors requis, toujours passablement décevants : le réel est inépuisable. En effet, si confidentielle soit-elle, il n’y a pas d’information qui viendrait à bout de son objet ou plutôt de son sujet. Les perspectives médicale, psychologique, éducative ou assistancielle constituent des vues précieuses quoiqu’inexorablement partielles – tout savoir prétendument encyclopédique et complet se trouvant finalement aux antipodes du savoir et au voisinage de la toute-puissance du professionnel qui s’en réclame.
En revanche, le partage d’informations peut viser une pluralisation des perspectives singulières, leur ampliation raisonnée, une manière de dé-dogmatisation. À la fois, élaboration intraprofessionnelle et production transprofessionnelle. Une ouverture, tout simplement. Même si cette ouverture n’a rien de simple, nulle part et pour personne. Ce réveil du sommeil dogmatique (Kant) confirme que tout sujet est à peine contenu dans le dossier le concernant – si administrativement exhaustif que celui-ci paraisse.
En deuxième lieu, conséquence de ce qui précède, le partage d’informations s’effectue toujours sur mesure et sous conditions. Ce, avant qu’une quelconque censure n’intervienne et fasse des siennes. Plusieurs raisons à cela. Chaque information, produit culturel par excellence, se construit sur la base d’une sélection de données, ainsi privilégiées les unes par rapport aux autres, mises en forme et reliées par des relations susceptibles de mutations de détail ou de fond. Ce n’est pas tout. Même à son insu et sur fond des habitus de classe (Bourdieu), chaque détenteur d’information décide des modalités de partage éventuel, apprécie les qualités et les défauts de ses correspondants, estime ou ne supporte pas leurs interrogations, se résigne ou s’intéresse à leurs points de vue. Nous ne parlons pas ici d’un état virtuel, mais de l’exercice quotidien. Que le détenteur en question le sache ou le méconnaisse, il participe activement au tri de ses interlocuteurs... Partage sur mesure, aussi, eu égard à la place hiérarchique de l’émetteur, à ses prestiges sociaux, à l’obligation qui lui est faite de partager ou non, avec qui, comment. Cette dernière clause suggère l’incontournable activité de facteurs extrasubjectifs au cœur de la décision subjective. Le positionnement éthique d’un sujet se met en branle en se situant vis-à-vis des postulats déontologiques en vigueur, des puissances et subordinations de sa situation sociale, en se réfugiant derrière l’ordre existant ou en contribuant, avec d’autres, à esquisser un ordre différent. Tout compte fait, il y a des éthiques du courage et de la solidarité comme il y en a de la veulerie et de la trahison.
En troisième et dernier lieu se pose la question du statut de l’information et, partant, de ce qu’il s’agit précisément de partager. D’emblée, l’affaire paraît simple : des professionnels acceptent ou bien refusent de diffuser à d’autres professionnels des informations à caractère confidentiel en leur possession. L’acceptation vaut répartition, le refus implique véto. Cependant, si le refus de diffusion prive autrui du contenu des dites informations, en disposer ne lui sert pas forcément, n’augmente pas toujours son savoir et savoir-faire. En effet, il n’est pas rare que l’information aille de pair avec la désinformation, soit la surabondance d’informations provenant d’une seule source, unilatéralement axée sur les mêmes leitmotive, en vue d’objectifs inchangés et inchangeables.
Faire un pas de côté permet de ne pas solidifier davantage ce genre de situations. Rappelons, en effet, que l’information ne fait pas double emploi avec les données et autres éléments dont elle se nourrit et avec laquelle on entend nourrir autrui. Une information est un récit plausible à propos de données probables. Il s’agit de la mise en sens de ces données, leur mise en récit : l’appellation « information confidentielle » est un de ces scénarios. S’il en est ainsi, on admettra que ces données peuvent s’interpréter tout à fait autrement, s’intégrer dans d’autres informations et induire d’autres lectures. Si le défilé d’une foule plus ou moins tumultueuse est qualifié d’atteinte à l’ordre public ou bien de libre exercice de la citoyenneté, les implications ne sont certainement pas les mêmes, ni pour la foule ni pour les forces de police, ni non plus pour les instances judiciaires. Ce n’est donc pas une affaire de convention éphémère et d’étiquetage journalistique. Le bon – ou le moins bon – vouloir des uns et des autres ne suffit nullement à déclencher des informations ni non plus à les modifier. Nous savons que des traditions sont à chaque fois à l’œuvre ainsi que des options idéologiques et politiques, des analyses théoriques, des intérêts de diverses sortes.
Ainsi donc, quand bien même des informations sont effectivement transmises, assorties en plus d’une mise à disposition pour complément, le chemin n’a été parcouru qu’à moitié. Encore faut-il réélaborer ces informations, les retravailler, les accommoder, déchiffrer quelque chose de leur sens manifeste et de leurs sous-entendus forcément elliptiques. Encore faut-il acclimater les informations médicales dans la terminologie et les démarches psychologiques ou éducatives, leur donner une place sans leur donner toutes les places, les accueillir tout en conservant le tranchant du psychologique, de l’éducatif, du médical. Périls et tentations guettent de toutes parts, capables de ruiner les meilleures intentions. Par exemple, quand des non-médecins se mettent à jouer à ce médecin dont pourtant Molière a définitivement fermé le ban ; quand des non-psychologues copient des logorrhées empruntées à Freud et surtout à Lacan ; quand des travailleurs sociaux, enfin, exhibent courageusement leur diplôme d’État et parcimonieusement leur engagement citoyen.
Une information, récit très probablement pertinent chez le médecin et dans le cadre de sa discipline, ne l’est pas automatiquement, mécaniquement, ailleurs. Il en va de même pour tout champ disciplinaire. D’une part, parce que les patients ne sont pas uniquement des corps malades, ni des psychismes souffrants ni des usagers en difficulté scolaire, sociale ou familiale : ils ne sont réductibles à aucun de leurs dossiers, ni non plus à leur simple addition. D’autre part, qu’on s’en désole ou qu’on l’admette comme un fait d’expérience, personne n’est à même de tout comprendre de manière immédiate et garantie : difficile de traduire un langage dans un autre sans introduire quelques tergiversations, parfois d’envergure – « traduttore tradittore » d’après le dicton italien. Spécialisation et rigueur sont à ce prix. Même si les tergiversations et incompréhensions peuvent éventuellement indiquer des pistes fructueuses à exploiter.
Rien de plus équivoque que de transmettre sans explication ni mode d’emploi aux travailleurs sociaux des informations médicales ou psychologiques ou aux psychologues et médecins des informations sociales. Comme si les uns et les autres avaient une formation et une pratique psychologique, psychanalytique, médicale ou sociale. Comme s’ils disposaient, tel Google, d’algorithmes de traduction automatique capables de transposer des mots tout en faisant l’économie du sens. En réalité, ce partage supposément libre et ouvert cherche avec plus ou moins de bonne conscience à ce que les destinataires ne comprennent surtout pas la nature des informations, leurs modalités de construction, leurs enjeux spécifiques, leur éventuel dépassement. On les convoque au récitatif de mots étrangers en évacuant la logique qui porte ces mots pour en faire des concepts.
Il reste à prétendre que les difficultés viennent, non pas de l’émetteur, mais bien du récepteur. On dira alors qu’indépendamment des explications fournies et des commentaires ajoutés, les destinataires continueront à ne pas comprendre l’insondable profondeur des pensées psychologiques, psychanalytiques ou médicales. Leur inculture les en empêche. Autant avouer que celui qui transmet des informations bute, lui, sur de sérieuses incompétences dans sa manière de partager ou, si on préfère, détient un impeccable savoir-faire en matière de rétention.
Il importe de souligner que cette démarche stratégique dans toutes sortes de pratiques professionnelles qu’est le partage des informations, indispensable à l’ouverture d’esprit de tout praticien et à une compréhension aussi peu étriquée que possible des destinataires, suppose des conditions ad hoc de réalisation, de réception et d’évaluation. C’est pourquoi il s’agit, précisément, d’une thématique à élaborer. L’option « partage/non-partage » simplifie à outrance une affaire autrement complexe – ni compliquée ni embrouillée, mais surdéterminée, car traversée par de multiples registres entremêlés.
Le partage d’informations se déploie sur un sentier escarpé, semé d’embûches, de contresens, seul praticable au prix d’ajustements réciproques de la part de tous ceux qui entendent l’escalader.
D’un point de vue juridique, il s’avère possible et nécessaire d’en règlementer les modalités, l’étendue, les limites ; d’un point de vue déontologique, d’en fixer les usages par les différentes corporations tout en améliorant constamment les performances ; d’un point de vue éthique, d’en laisser à chaque professionnel le choix des formes et des contenus du dit partage, ceci allant de pair avec sa responsabilité pleine et entière quant à la pertinence du choix et l’indispensable introduction de correctifs. Voilà des points de vue spécifiques qui, loin de s’exclure ou de pouvoir être hiérarchisés, se renforcent réciproquement et constamment. Là loge, fort probablement, le nœud de la question.