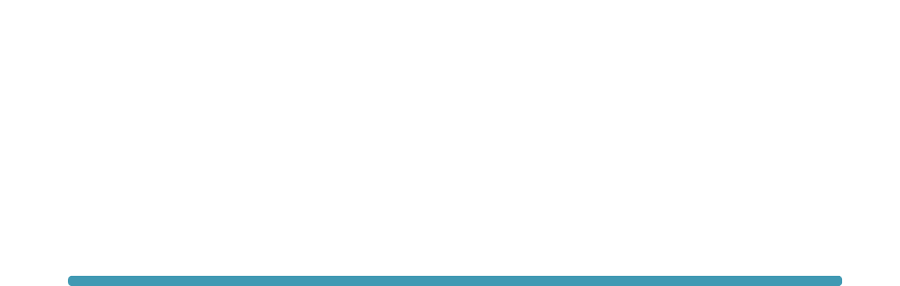Dieu merci, après une période de confinement intellectuel, le Conseil d’État semble accompagner le « déconfinement » sanitaire d’une meilleure prise en compte des libertés fondamentales. Si, dans un premier temps (celui du confinement), il a rejeté les requêtes à lui présentées, estimant la condition d’urgence non remplie et les mesures liberticides justifiées par la théorie des « circonstances exceptionnelles » et « l’intérêt public qui s’attache aux mesures de confinement » (CE réf., 30 mars 2020, n° 439809, cons. 5 : J. Fialaire, Liberté de culte et urgence sanitaire : les leçons de la jurisprudence, JCP A 2020, 2155), il s’est ravisé dans un second temps (celui du « déconfinement »). Le 18 mai peut être qualifié de jour faste puisqu’ont été réaffirmés tant la liberté de culte, qui nous intéresse ici, que le droit au respect de la vie privée, dans l’affaire des drones surveillant la ville de Paris (CE réf., 18 mai 2020, ord. n°s 440442, 440445). Quoique le gouvernement ait laissé l’Ascension dans les limbes, l’article 1er du décret n° 2020-618 du 22 mai 2020, complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, restaure la liberté de culte à temps pour l’Aïd-el-Fitr (fin du ramadan célébrée le 24 mai), Chavouot (don des Tables de la Loi sur le mont Sinaï, commémoré le 29 mai) et la Pentecôte (descente du Saint-Esprit, fêtée le 31 mai). Désormais, le cadre d’exercice de la liberté de culte n’est plus borné que par le respect des dispositions générales (port du masque, distanciation sociale, gestes « barrières ») duquel le « gestionnaire du lieu de culte s’assure à tout moment, et en particulier lors de l’entrée et de la sortie de l’édifice ».
Loin de voir dans cette décision une « audace jurisprudentielle » (J. Fialaire), la lecture de l’ordonnance mène à formuler diverses considérations tant sur la défense prévisible de la liberté de culte (I) que sur quelques aspects plus singuliers (II).
I. Une défense prévisible de la liberté de culte
Disons-le d’emblée, cette ordonnance n’est pas révolutionnaire. En rétablissant la possibilité du culte public, brimée par les dispositions règlementaires du « déconfinement », elle ne fait que réaffirmer ce que le Conseil d’État dit depuis des lustres : la liberté de culte est une liberté fondamentale visée par l’article L. 521-2 du Code de justice administrative (CE, réf., 10 août 2001, Assoc. La Mosquée, n° 237004 : Lebon T. p. 1133 ; CE, 16 févr. 2004, n° 264314, M. Ahmed X. c. Office public municipal d’H.L.M. de Saint‑Dizier : Lebon T. p. 826 ; JCP A 2004, 1357, note E. Tawil ; CE, réf., 7 avr. 2004, n° 266085, Épx K. : JCP A 2004, 1554, note E. Tawil). En ce sens, l’interdiction générale et absolue de rassemblement ou de réunion dans les lieux de culte, prévue par le III de l’article 10 du décret contesté (dans les mêmes termes que le IV de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020), présente « un caractère disproportionné au regard de l’objectif de préservation de la santé publique et constitue ainsi, eu égard au caractère essentiel de cette composante de la liberté de culte, une atteinte grave et manifestement illégale à cette dernière » (cons. 34). Il est vrai qu’une telle cessation complète des offices religieux en France avait quelque chose d’inédit depuis des siècles. Cela n’était pas arrivé depuis la Terreur, comme persécution (arrêté du 3 frimaire an II, 23 novembre 1793), ou depuis l’interdit général lancé par Innocent III en 1200, comme sanction.
Appliquant une jurisprudence constante, le Conseil d’État fonde cette liberté de culte tant sur des textes nationaux (articles 1er et 25 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État) que sur des textes internationaux (article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales), invoquant également l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 (cons. 8), bien que ce dernier fondement, déjà soulevé en 2004, ait suscité un certain doute dans la doctrine (E. Tawil, La liberté de culte, liberté fondamentale de valeur constitutionnelle ?, JCP A 2004, 1145). En revanche, le Conseil se tait sur un hypothétique principe constitutionnel de laïcité impliquant le libre exercice des cultes (Cons. const., n° 2012-297 QPC, 21 février 2013, APPEL, Rec. p. 293).
L’argumentation des différents requérants (des particuliers, un prêtre diocésain, plusieurs associations, un parti politique… mais curieusement aucun représentant de l’épiscopat, cf. C. Chambraud, « Le Conseil d’État lève l’interdiction “disproportionnée” des célébrations religieuses en France », Le Monde, 19 mai 2020) portait sur les « modalités selon lesquelles peuvent être organisées les cérémonies religieuses, notamment dans les établissements de culte, durant la présente période d’état d’urgence sanitaire ». Plusieurs points étaient soulevés, dont l’un a particulièrement retenu l’attention des juges, celui de l’essence du culte rendu à Dieu (A), et l’autre, celui de l’absence de proportion, a été tranché de manière très classique (B).
A. L’essence de la liberté de culte
Le problème fondamental de l’interdiction des rassemblements ou réunions dans les édifices du culte est celui de l’essence même du culte public, à savoir d’être une liturgie (λειτουργία, leitourgía), une chose du peuple. La liberté de culte comporte un aspect collectif inhérent et inamissible qui ne peut être remplacé par la prière individuelle. Ainsi, la liberté de culte est, au for externe, le complément de la liberté religieuse par laquelle l’individu, dans son for interne, adhère ou n’adhère pas à une confession. La liberté de culte n’est donc pas « altérée seulement dans ses dimensions rencontrant les libertés de réunion et de manifestation » (J. Fialaire) par l’interdiction de tout culte public, mais bien altérée dans sa substance même. D’ailleurs, dans d’autres occasions, le juge des référés a reconnu la distinction matérielle des « libertés fondamentales de culte et de réunion » (CE réf., 6 mai 2008, n° 315631 : Rec. p. 759 : JCP A 2008, act. 423).
Le Conseil d’État, au moins depuis 2005 dans l’affaire de la Commune de Massat, reconnaît que la libre disposition des édifices du culte est un préalable à l’exercice effectif de la liberté de culte (CE réf., 25 août 2005, n° 284307 : Rec. p. 386, JCP G 2006, II, 10024 ; AJDA 2006. 91). Cela a été réaffirmé par le juge des référés en formation collégiale : « La liberté du culte a le caractère d’une liberté fondamentale. Telle qu’elle est régie par la loi, cette liberté ne se limite pas au droit de tout individu d’exprimer les convictions religieuses de son choix dans le respect de l’ordre public mais a également pour composante la libre disposition des biens nécessaires à l’exercice d’un culte » (CE réf., 30 juin 2016, Maire de la ville de Nice, n° 400841, cons. 7, AJDA 2016. 2048). C’est pourquoi le juge des référés a ici ajouté cette précision bienvenue selon laquelle cette liberté « comporte également, parmi ses composantes essentielles, le droit de participer collectivement […] à des cérémonies, en particulier dans les lieux de culte », sous réserve du respect de l’ordre public (cons. 11). Ce point avait été longuement invoqué lors de l’audience publique, à l’appui d’études théologiques insistant sur le « caractère vital de l’exercice public du culte pour la religion catholique » (note de Mgr Kruijen).
Cette conception collective de la liberté de culte est tout à fait conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La cour de Strasbourg condamne en effet les États entravant la liberté de religion par la fermeture des lieux de culte pour des raisons disproportionnées (CEDH, 24 mai 2016, n° 36915/10 et 8606/13, Association de solidarité avec les témoins de Jéhovah et autres c. Turquie), exposant que « si une communauté religieuse ne peut disposer d’un lieu pour y pratiquer son culte, ce droit se trouve vidé de toute substance » (§ 90). Ceci mène à questionner la proportionnalité de la mesure restrictive censurée par la Haute juridiction.
B. L’absence de proportionnalité
Sans étonnement, le Conseil d’État rappelle que les mesures restrictives de liberté doivent être « nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique » (cons. 6), objectif de valeur constitutionnelle (cons. 11). Ce n’est pas la première fois qu’il estime devoir effectuer un contrôle de proportionnalité (CE, sect., 30 oct. 2001, min. Int. c. Tliba ; CE, 6 févr. 2015, n° 387726, Cne Cournon-d’Auvergne). Son rôle en tant que juge des référés est alors de vérifier l’accommodement de la liberté de culte aux nécessités de l’ordre public sanitaire. Afin d’expliciter cela, il prend exemple de la distinction opérée entre les lieux publics et les locaux à usage d’habitation, selon la lecture opérée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-80 DC du 11 mai 2020, qui procède à « une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés » (cons. 19).
Le Conseil d’État agit en plusieurs étapes pour discerner si l’interdiction générale du culte public est constitutive d’une violation d’une liberté fondamentale, ou au contraire respectueuse de cette conciliation. D’abord, au regard de « l’amélioration de la situation sanitaire ayant justifié le déconfinement », le juge des référés estime que la condition d’urgence est caractérisée par la privation subie depuis le début du confinement : « les fidèles ne peuvent ainsi participer à des cérémonies […] que par le biais de retransmissions, y compris pour les importantes fêtes qui ont eu lieu au printemps dans les trois religions réunissant le plus grand nombre de fidèles en France » (cons. 24). Puis, au regard du « caractère progressif du plan dit de ‘déconfinement’ », il compare cette interdiction générale « avec les régimes applicables à d’autre activités, tout particulièrement dans les départements les moins touchés par la maladie dite Covid-19 » (cons. 25). Cet aspect d’une indifférenciation territoriale, soulevé à l’audience, passe pour avoir convaincu les juges d’une disproportion injustifiable.
Le Conseil d’État met en balance l’exercice du culte avec le risque particulier de contamination que peuvent faire courir les cérémonies religieuses, « lequel est d’autant plus élevé qu’elles ont lieu dans un espace clos, de taille restreinte, pendant une durée importante, avec un grand nombre de personnes, qu’elles s’accompagnent de prières récitées à haute voix ou de chants, de gestes rituels impliquant des contacts, de déplacements, ou encore d’échanges entre les participants » (cons. 27). Il écarte partiellement la justification avancée par le ministre de l’Intérieur tirée du rassemblement évangélique dans le Haut-Rhin entre le 17 et le 24 février 2020, dont le rôle causal dans l’évolution de l’épidémie semble par ailleurs infirmé (« Coronavirus : Le rassemblement évangélique de Mulhouse accusé à tort. Nos révélations », Paris-Match, 20 mai 2020).
Ensuite, il oppose l’existence de nombreux régimes « moins restrictifs » concernant « les services de transport des voyageurs » ou « les magasins de vente et centres commerciaux, les établissements d’enseignement ainsi que les bibliothèques », qui permettent d’accueillir du public « dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions » sanitaires imposées par l’article 1er du décret du 11 mai (cons. 31), tant il est vrai que le brouhaha des supermarchés, temples de la consommation, jurait avec le silence des églises, temples de la contemplation. Enfin, et c’est tout à son honneur, il rappelle que dans ces divers établissements recevant du public « les activités qui y sont exercées ne sont pas de même nature et les libertés fondamentales qui sont en jeu ne sont pas les mêmes » (cons. 32). Il y a là, à n’en pas douter, une réminiscence de la liberté de conscience, dont l’objet même est plus noble que la liberté du commerce ou de l’industrie, ce que d’aucuns ont souligné comme étant une « hiérarchisation par rapport à d’autres droits et libertés » (G. Gonzalez, « Covid-19 : le Conseil d’État au chevet de la liberté de culte », Semaine Juridique Edition Générale n° 24, 15 juin 2020, 717).
Une fois ces éléments pesés, la Haute juridiction juge que « le maintien de l’interdiction générale et absolue de tout rassemblement ou réunion dans les établissements de culte pour une durée indéterminée n’est pas strictement nécessaire, proportionné et approprié aux circonstances de temps et de lieu dès lors que des mesures d’organisation relativement simples rendraient possible le respect des règles de sécurité sanitaire » (cons. 34). Dès lors, elle enjoint au Premier ministre de prendre, sous huit jours, les « mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu applicables en ce début de ‘déconfinement’, pour encadrer les rassemblements et réunions dans les établissements de culte » (article 3). Cette solution attendue et conforme à sa jurisprudence, qui constitue le cœur des requêtes, est toutefois accompagnée d’éléments inattendus.
II. Les éléments inattendus de la décision
On peut glaner de-ci de-là quelques éléments intéressants et plus singuliers, dont certains suscitent l’étonnement. Ainsi en va-t-il de la longueur inhabituelle du délai à statuer du Conseil d’État. Celui-ci, saisi par des requêtes et des mémoires enregistrés dès le 3 mai 2020, n’a tenu son audience publique que le 15 mai, pour y répondre le 18 mai, soit quinze jours après la première saisine. Le Conseil reconnaît pourtant qu’en « situation d’urgence caractérisée », il est justifié à prononcer des mesures de sauvegarde « à très bref délai » (cons. 7), ce qui ne semble pas tout à fait rempli en l’occurrence. La lettre de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative (« Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante‑huit heures », non modifiée par l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif) est certes indicative (R. Rouquette, Petit traité du procès administratif, Dalloz, 2018, 621.152) mais en l’espèce le délai peut paraître sinon déraisonnable, du moins considérable.
D’autres éléments, plus substantiels, ont trait au mode de production normative de l’État, via la notion de décision verbale (A), ou à l’appréciation de la laïcité « à la française » (B).
A. La notion de décision verbale
Le Conseil d’État a refusé, dans son ordonnance, la qualification de décision verbale au discours du Premier ministre Édouard Philippe, le 28 avril 2020. Ce dernier repoussait la date à laquelle la liberté de culte allait pouvoir reprendre en déclarant : « Quant aux lieux de culte, je sais l’impatience des communautés religieuses. Les lieux de culte pourront continuer à rester ouverts. Mais je crois qu’il est légitime de demander de ne pas organiser de cérémonies avant le 2 juin ». Cette Présentation de la stratégie nationale de déconfinement faite devant l’Assemblée nationale, et dont le site internet officiel du gouvernement nous indique que « seul le prononcé fait foi », a été l’objet d’un vote en application de l’article 50-1 de la Constitution. Le ministre de l’Intérieur, dans un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2020, concluait au rejet de la requête en soutenant « que la déclaration attaquée du Premier ministre du 28 avril 2020 ne constitue qu’un acte préparatoire aux dispositions règlementaires à intervenir et ne saurait, par elle-même, être regardée comme ayant un impact juridique ni, a fortiori, être susceptible de porter atteinte, de façon grave et immédiate, à une liberté fondamentale ». Chose surprenante, les juges du Palais-Royal reprennent explicitement l’argumentation du gouvernement, estimant que les propos du Premier ministre, « qui renvoyaient aux modalités d’application dans le temps de mesures à venir, et qui ont été, au demeurant, nuancés lors de la déclaration faite devant le Sénat le 4 mai 2020 […] ne peuvent être contestés devant le juge administratif, indépendamment des mesures en cause » (cons. 15). Cela peut, à première vue, sembler rassurant pour le respect de l’État de droit qu’un discours politique ne soit pas considéré comme créateur de règles de conduite. Le chef du gouvernement se distingue ainsi d’un législateur-né, tel le Souverain pontife dont un oraculum vivæ vocis (décision de vive-voix) peut suffire à créer du droit, quoique son usage au for externe nécessite la preuve d’une telle concession (can. 74, Code de droit canonique de 1983).
Pour autant, les décisions verbales sont par ailleurs reconnues comme de valables moyens de création du droit dans l’ordre administratif (CE, 3 févr. 1993, Union Synd. des policiers municipaux : Lebon, p. 25 ; CE, 19 nov. 1966, Froment : Lebon, p. 607), même quand il s’agit d’une décision du président de la République (CE, ass., 29 juin 1995, n° 171277, Assoc. Greenpeace : Lebon, p. 347 ; RDP 1996, p. 256, concl. Sanson). Leur dénier cette qualité reviendrait à étendre la catégorie des actes de gouvernement insusceptibles de recours, et donc, finalement, d’étendre les failles de l’État de droit. C’est peut-être une volonté de protéger l’exécutif qui a motivé les juges du Palais-Royal en l’espèce, alors même que la décision fait grief. En effet, considérer le discours du 28 avril comme ne pouvant être contesté devant l’ordre administratif ne laissait aux requérants aucun recours effectif puisque les mesures concernées n’ont été rendues publiques que le jour du « déconfinement », soit le 11 mai, et de surcroît en deux temps : d’abord le décret n° 2020-545, seulement « applicable les 11 et 12 mai 2020 » (article 27), publié au JORF n° 0115 du 11 mai 2020, ensuite le décret n° 2020-548, publié au JORF n° 0116 du 12 mai 2020. C’est d’ailleurs l’objet des ordonnances n°s 440512 et 440519 du 18 mai 2020, déboutant les requérants de ce que les dispositions attaquées « ont été abrogées par le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 » faisant de la sorte que « les conclusions présentées à leur encontre sont privées d’objet » (cons. 3). Au-delà de cette question normative, la question interprétative de la laïcité s’est invitée dans l’urgence.
B. La laïcité « à la française »
Des divers éléments qui composent la laïcité « à la française », la loi de 1905 en est évidemment le pivot, avec son article 1er disposant que la République garantit « le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées » par la loi, et « dans l’intérêt de l’ordre public ». La longue histoire jurisprudentielle du Conseil d’État est là pour attester d’une conception particulière du principe de laïcité, tiraillée entre bienveillance et malveillance. Ces deux aspects se retrouvent dans cette ordonnance du 18 mai, l’un déniant l’exercice du culte en plein air, l’autre dépassant le cadre strict du Concordat pour envisager une liberté de culte mieux protégée.
Un des requérants, la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, demandait, outre la reprise du culte dans les édifices du culte, « qu’il soit enjoint au Premier ministre de prendre des mesures propres à permettre l’organisation de manifestations religieuses dans les espaces publics et privés à l’air libre » (cons. 37), c’est-à-dire essentiellement les pèlerinages et les processions fréquents de la Pentecôte à la Fête-Dieu. Selon une jurisprudence constante, les manifestations cultuelles sur la voie publique, que celles-ci soient nouvelles ou traditionnelles, ne peuvent être interdites que pour un motif tiré du maintien de l’ordre public (CE, 2 juillet 1947, Guillet, Rec. p. 293 ; CE, 21 janvier 1966, Legastelois, Rec. p. 45). Ici, la Haute juridiction semble reprendre un outil herméneutique surprenant, celui de la distinction entre lieux publics. Elle l’avait utilisé à propos des lieux d’installation des crèches de Noël par les personnes publiques, distinguant « l’enceinte des bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public » des « autres emplacements publics » (CE, ass., 9 nov. 2016, n° 395122, Commune de Melun c. Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne ; CE, ass. 9 nov. 2016, n° 395223, Fédération de la libre pensée de Vendée : JCP A 2016, act. 853, note Touzeil-Divina ; JCP A 2016, 2309, comm. N. Chifflot ; AJDA 2016. 2375, chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet ; D. 2016, p. 2341, obs. M.-C. de Montecler). Ici, le Conseil d’État distingue entre les édifices du culte et les « espaces publics à l’air libre ne relevant pas des lieux de culte », pour juger que l’interdiction « de tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes », imposée par le décret du 11 mai ne porte pas atteinte à la liberté de culte (cons. 38).
De deux choses l’une : soit le Conseil d’État s’est fait théologien, estimant que l’obligation dominicale (sub mortali) qui conduit les fidèles à se rendre à l’église accomplir leurs devoirs, ne les oblige pas (sauf pénitence) à participer à un pèlerinage ou une procession ; soit le Conseil d’État a cherché à réduire la liberté de culte à un minimum commun partageable par toutes les obédiences, de l’Église catholique au Temple maçonnique, en passant par la Synagogue ou la Pagode, et rabaissant volontairement et explicitement les prétentions catholiques. La question des manifestations religieuses en plein air sur terrains privés, « dans l’hypothèse où ils constituent des établissements recevant du public de type plein air (PA) ou sont susceptibles d’être requalifiés comme tels » (cons. 39), n’a pas été considérée comme blessant la liberté de culte du fait de son ambivalence. Cela aboutit à un fait paradoxal en temps d’épidémie puisque, comme le souligne J. Fialaire, « la liberté de culte est ainsi mieux protégée quand elle s’épanouit dans les lieux clos des édifices cultuels qu’à l’extérieur ».
Le dernier point saillant de cette décision, tout aussi cohérent avec l’ordre juridique français, est celui de l’inefficience du Concordat au regard de la liberté fondamentale de culte. Le Conseil d’État était saisi, entre autres requérants, par un curé et des paroissiens de Metz, ville sous régime concordataire. Ceux-ci contestaient les dispositions du décret du 23 mars au regard de la convention du 26 messidor an IX (le concordat de 1801) « en ce qu’elles restreignent l’exercice du culte pour un motif qui n’y est pas prévu ». Le texte de l’article 1er du Concordat dispose que « La religion catholique, apostolique et romaine, sera librement exercée en France. Son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique ». Il figure au nombre des visas, mais n’est cependant mobilisé par le juge des référés qu’en passant (cons. 10), après la loi de 1905. En l’espèce, le Conseil d’État dépasse la requête initiale qui faisait valoir une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte (mais aussi à la liberté religieuse, à la liberté d’organisation du culte par l’Église catholique, à la publicité du culte et à la liberté d’exercice de la pratique religieuse), quoique limitée aux « départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ». L’objet d’une liberté fondamentale ne pouvant être restreint à quelques départements, le juge des référés l’apprécie pour toute l’étendue du territoire national.
Ainsi, avec cette ordonnance du 18 mai 2020 enjoignant de faire respecter la liberté de culte, le Conseil d’État répond parfaitement à l’objectif du référé-liberté d’« ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale » à laquelle le gouvernement venait de porter une « atteinte grave et manifestement illégale » en interdisant les offices religieux. Ce faisant, il clarifie aussi, pour les seuls édifices du culte, la conception ouverte de la laïcité « à la française », mettant de côté une lecture absolutiste (ou laïciste) déniant à la liberté de culte, voire à la liberté de conscience, sa raison d’être. Le Conseil d’État permet ainsi aux âmes de respirer, après l’avoir accordé (parcimonieusement) aux corps (Rien ne sert de courir ? À propos de CE, 22 mars 2020, req. n° 439674, Syndicat Jeunes Médecins, RDFL 2020, Chron. n° 11). Comme il est écrit, « l’homme ne se nourrit pas seulement de pain » (Mt. 4, 4).