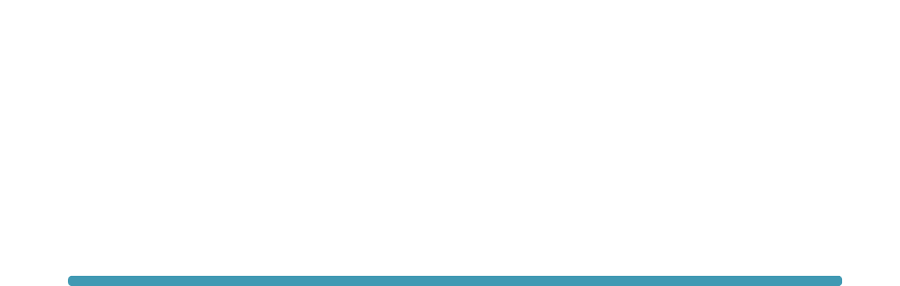Jean-Louis Clément, maître de conférences en histoire contemporaine à l’Institut d’études politiques de Strasbourg, est spécialisé dans l’étude de la France et de ses idées politiques, de 1880 à 1950. Le volume qu’il livre au public reprend cinq études préalablement publiées dans divers volumes, dont le trait commun est de s’intéresser aux juristes catholiques. L’auteur cherche à comprendre les principes métaphysiques qui fondent une partie de la doctrine française, et livre à ce sujet d’intéressantes pistes. Notons-le d’emblée, le positionnement académique de l’auteur est à la fois un atout et un désavantage pour décrire le monde du droit. Un atout en ce qu’il situe, mieux qu’un juriste ne le ferait, les idéologies sous-jacentes des universitaires étudiés, mais un désavantage en ce qu’il se focalise trop sur certains aspects idéologiques, vrais peut-être, mais surestimés dans la construction intellectuelle des systèmes juridiques. Le tropisme historien de l’auteur revient à mieux mettre en relief le système des valeurs et des idées, mais il conduit parfois à supposer des filiations intellectuelles qui ne s’imposent pas. Ces quelques critiques ne doivent pas masquer l’apport bienvenu de ce livre et des éclairages nouveaux qu’il apporte.
Étudiant « le catholicisme comme religion politique en France » (p. 11-21), l’auteur part des travaux d’Éric Voegelin, et notamment de son concept de « gnose intramondaine », par lequel l’homme moderne se sauve grâce à une philosophie ou une organisation sociale nouvelle. Il l’applique aux penseurs contre‑révolutionnaires que sont Louis de Bonald et Joseph de Maistre, dont la posture anti-moderne les pousse à réclamer le retour du religieux comme guérison de la modernité. La postérité intellectuelle de ces penseurs est grande, notamment via la Comédie humaine de Balzac, qui incite à considérer le catholicisme sous l’angle de son utilité sociale (p. 13). Maurras se placera dans une perspective semblable (p. 19). Cependant, l’auteur invite à mesurer la postérité de Bonald au-delà du cercle contre‑révolutionnaire, par son influence sur le socialisme utopique. De Victor Cousin à Prosper Enfantin, ces auteurs louent l’unité entre la religion et l’État, que ne reniera pas un Pierre-Joseph Proudhon, affirmant entre autres que « Religion et Société sont termes synonymes : l’Homme est sacré par lui-même comme s’il était Dieu. Le catholicisme et le socialisme, identiques pour le fond, ne diffèrent que par la forme » (p. 15). Les réseaux saint-simoniens, dans l’étendue de leur diversité de Philippe Buchez à Frédéric Le Play, reprendront certaines de ces idées.
La seconde étude, portant sur « un canoniste mis à l’Index en 1906 : Paul Viollet (1840-1914) » (p. 23-40) est à la fois extrêmement stimulante et très étonnante par endroits. Les juristes, peu habitués à traquer les influences ésotériques des leurs, seront surpris d’apprendre l’importance (surestimée ?) de Nicolas Magon de La Gervaisais, « prophète inconnu » selon son éditeur Jean Damas-Hinard en 1850, sur l’œuvre de Viollet. Pétri de théosophisme, ce pseudo mage breton développe une pensée sur le droit, conçu comme simplement artificiel et soumis aux changements, sa relativité ne devant cesser que lorsque la société sera enfin faite non plus par l’homme mais « pour l’homme ». Toutefois, l’auteur n’apporte pas de preuve directe de l’emploi du théosophe par le chartiste qu’était Paul Viollet, dont le catholicisme libéral peut s’expliquer sans cette médiation énigmatique. La part la plus neuve de cette étude est de montrer les sources théoriques auxquelles Viollet réfère : des membres du Grand-Orient (Auguste Delpech), ses collègues de la Ligue des droits de l’homme (qu’il a cofondée avec Ludovic Trarieux en 1898), ou encore le gratin du catholicisme libéral, à l’instar de l’abbé Joseph Brugerette ou de son ancien professeur Alexandre de Metz-Noblat. Ce qui étonne le plus est le libéralisme avancé de Paul Viollet, déjà connu pour sa défense des principes de 1789, mais qui soutient des thèses que la plupart des catholiques libéraux ne soutiennent pas, comme l’inexistence de liens entre l’encyclique Quanta cura et le Syllabus des erreurs modernes ! Ces deux textes, pourtant publiés par Pie IX le même jour, le 8 décembre 1864, 10e anniversaire de la proclamation du dogme de l’Immaculée Conception, visent tous deux à pourfendre les « monstrueuses erreurs » politico-religieuses de son temps, et sont considérés comme complémentaires : l’un étant un exposé doctrinal, l’autre un résumé, sous forme brève, des propositions condamnées (et sourcées, du moins dans la plupart des éditions, aux précédents textes pontificaux). Viollet voit dans le Syllabus non pas l’œuvre du magistère doctrinal de la papauté, mais simplement celle de catholiques intransigeants cherchant à « affaiblir la cause de la liberté » (p. 35). Dans cette veine, Paul Viollet rédige en 1904 un ouvrage historiciste sur l’infaillibilité pontificale, qui finit à l’Index des livres prohibés deux ans plus tard. Ses prises de position trop républicaines et libérales feront que même les « cardinaux verts », ces vingt-trois signataires de la Supplique aux évêques adressée en 1906 en soutien au gouvernement français contre l’intransigeance de saint Pie X, n’oseront demander à Viollet son soutien et sa participation à leur entreprise.
Les troisième et quatrième études sont relatives à l’œuvre et à la pensée de Maurice Hauriou, évoquant « les fondements de [s] a doctrine juridique et sociale » (p. 41-52) puis sa « théorie juridique [et] l’adhésion de la démocratie chrétienne » (p. 53-65). L’on apprend que le doyen de Toulouse, s’inscrivant dans le sillage du mouvement intellectuel sociologique, « récuse tout autant le mécanisme positiviste […] et le spiritualisme », sans adhérer pour autant au criticisme : « Hauriou lit La Réforme sociale nourri su saint‑simonisme de Frédéric Le Play et les travaux de l’écrivain Paul Bourget qui, dans Le Disciple (1889), essaie de montrer la solidarité de fait entre positivisme et criticisme dans le portrait de son héros, Adrien Sixte » (p. 43). Si Auguste Comte est souvent cité dans les travaux du juriste, Hauriou n’est pourtant qu’un « comtiste » mitigé, n’attendant pas une nouvelle religion pour l’Humanité, se satisfaisant du catholicisme. À la suite de Paul Bénichou, l’auteur attribue une importance extrême à l’œuvre et à la pensée de Pierre-Simon Ballanche, que l’on retrouverait sous la plume du professeur de droit, tous deux faisant « allégeance au christianisme comme religion civique » (p. 49). Si l’adhésion commune à cette « théodicée sociale » est établie, celle d’une filiation intellectuelle ne le semble pas, ou du moins, la démonstration ne convainc pas le juriste, qui reste ici en soif de textes. Appliquée aux événements contemporains de l’époque, cette vision sociale conduit Hauriou à juger de la loi de Séparation de 1905 comme étant « la dissociation raisonnable de la société religieuse, étatique et positive » (La science sociale traditionnelle). L’auteur montre ensuite l’adhésion de Maurice Hauriou au néo-catholicisme, pensé par Buchez, et compatible avec l’aveu selon lequel il fut « positiviste comtiste devenu positiviste catholique, c’est-à-dire comme un positiviste qui va jusqu’à utiliser le contenu social, moral et juridique du dogme catholique » (Principes de droit public, 1926). Le cercle néo-catholique de Toulouse est bien étudié, autour de Dumesnil, Pomairols, Pouvillon ou encore l’abbé Chatelard. La mise en exergue de cet aspect assez inédit explique bien le rôle central du juriste au sein du catholicisme français du début du XXe siècle, et doit conduire à relativiser très fortement son thomisme réputé, au profit d’un bergsonisme par ailleurs affiché. Toutefois, nous ne partageons pas la conclusion de l’auteur pour qui Hauriou, via sa théorie de l’Institution, « donnait à la tradition contre-révolutionnaire l’outil juridique qui lui permit de concrétiser dans la vie publique sa vision de la société et de l’homme » (p. 52). Cette affirmation semble annoncer une réception de l’œuvre du doyen chez les penseurs contre-révolutionnaires, qui n’eut jamais lieu, au contraire (v. les attaques de Maurras contre Hauriou, cf. Marc Millet, « La doctrine juridique pendant la Guerre : à propos de Maurice Hauriou et de Léon Duguit », Jus Politicum. Revue de droit politique, n° 15). De même, ses sympathies pour le Sillon de Marc Sangnier sont autant d’arguments contre une affiliation contre-révolutionnaire. Son prétendu catholicisme intégral concorde mal avec ces présupposés, et l’on voit mal comment l’inscrire (et à plus forte raison pour Viollet, libéral, républicain et fondateur de la LDH), « dans la tradition contre-révolutionnaire à caractère religieux » (p. 77).
La théorie de l’Institution, et il y a là de très bonnes pages de l’auteur, entend favoriser la renaissance sociale dans laquelle la religion est cantonnée au rôle d’une force de conservation sociale agissant harmonieusement avec un État fédérant toutes les composantes sociales » (p. 78). Elle présente des similitudes avérées avec certaines idées conçues par des saint-simoniens catholiques, comme les théories sociales de Georges Fonsegrive (p. 57). Le personnalisme fondamental d’Hauriou, repris par son disciple Georges Renard, postule que « toute justice est pour l’individu » et qu’il ne saurait exister « de justice que vis-à-vis des personnes ». Or, dans Morale et Société, Fonsegrive avançait, quelques années avant Hauriou, cette dichotomie entre « justice morale » et « justice sociale ». Mais l’éclectisme du Toulousain, combinant plusieurs écoles philosophiques et sociologiques, peut difficilement se résumer en une liste d’un ou deux maîtres à penser qu’il aurait suivis. Il procède à une adaptation du droit naturel à la doctrine de la démocratie chrétienne, qui influencera fortement l’Action catholique (p. 64).
Enfin, la dernière étude porte sur « les juristes catholiques et la laïcisation du droit, 1880-1948 » (pp. 67 ‑75). L’occasion d’étudier rapidement ces juristes (Gény, Renard, Cuche, Le Fur, Menthon, Teitgen, Prélot) est fournie par le vote de la loi du 1er septembre 1948 sur les loyers d’habitation, dont l’auteur retrace la genèse intellectuelle. Le débat, portant sur le droit de propriété et sa définition, intéressa aussi l’épiscopat, par le biais de la fonction sociale de la propriété.
Ces cinq études, ici réunies et dotées d’un pratique index nominum, permettent de regarder la doctrine juridique française d’un nouvel œil, de l’appréhender via son côté idéologique, marquée par la figure d’Auguste Comte, et, plus lointainement, par celle de Louis de Bonald. C’est un mérite rare que nos penseurs soient abordés sous un angle méthodologique qui n’est pas le nôtre, sachons remercier Jean‑Louis Clément d’avoir mené à bien cette tâche.