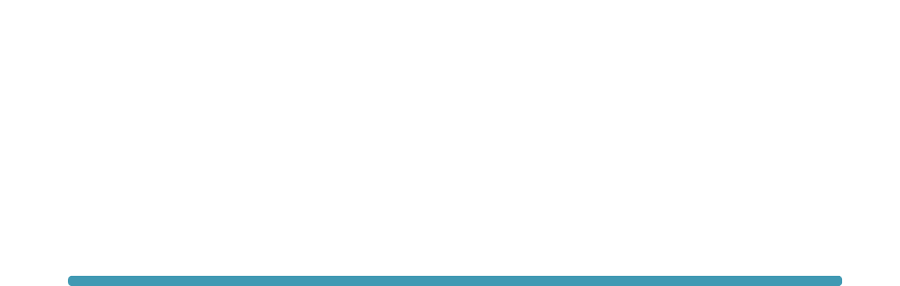L’enquête en procédure pénale est, étymologiquement, une recherche, un moyen d’aller chercher la vérité – en quête de – sur un soupçon d’infraction. La procédure pénale toute entière est dirigée vers cet objectif de découverte de la vérité, elle avance – pro cedere – et les premières étapes de la procédure sont précisément les enquêtes policières. Il s’agit là de cadres juridiques qui offrent aux autorités des pouvoirs en matière de recherche des preuves d’une infraction et du rattachement à son auteur.
Traitant de ces pouvoirs d’enquête, l’article 17 du Code de procédure pénale est mal rédigé1. Il dispose que les officiers de police judiciaire (OPJ) exercent les pouvoirs définis à l'article 14 ; or l’article 14 ne définit pas les pouvoirs de la police judiciaire mais lui assigne des buts : la police judiciaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions. Le texte de l’article 17 poursuit en indiquant que les OPJ reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 75 à 78 du Code. En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 53 à 67. Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.
Le fait de se focaliser sur le soupçon qu’une infraction a pu être commise distingue l’enquête de police judiciaire de l’enquête de police administrative2. La question de la judiciarisation du renseignement demeure l’un des enjeux marquants de l’évolution des règles relatives aux enquêtes pénales et administratives ces dernières années3.
Dans la mesure où les contrôles d’identité ne confèrent pas de véritables pouvoirs d’investigation – il peut néanmoins y avoir un recueil utile d’informations lors de telles opérations –, ceux‑ci seront écartés du champ de cette étude et ce bien qu’ils soient de nature à poser le même type de problème de double finalité possible, administrative et judiciaire, mais ce ne sont pas des enquêtes. Ils peuvent révéler ou participer à la constatation d’une infraction ou à l’interpellation d’une personne recherchée mais ils ne prévoient pas de pouvoirs d’investigation au sens strict. On s’en tiendra aux enquêtes ayant pour finalité d’élucider des faits constitutifs d’une infraction, ce qui met à l’écart les enquêtes spécifiques comme :
- l’enquête en cas de découverte d’un cadavre si la mort paraît suspecte, où le procureur se déplace et un médecin va déterminer les causes du décès (avec une autopsie si besoin, Comité de protection des personnes (CPP), art. 74) ;
- l’enquête en cas de disparition d’une personne mineure ou vulnérable : pendant huit jours la police peut rechercher les causes de la disparition (CPP, art. 74‑1) ;
- la recherche d’une personne en fuite qui peut conduire à enquêter pour découvrir l’individu faisant l’objet d’un mandat d’arrêt ou ayant été condamné (on peut même procéder à des écoutes téléphoniques, CPP, art. 74‑2).
Restent les enquêtes préliminaires et de flagrance. Dans ces phases d’investigation judiciaire, les « pouvoirs » sont les prérogatives légales qui appartiennent aux enquêteurs et magistrats et qui leur permettent d’accomplir des actes de police judiciaire. Faustin‑Hélie, comme le Code de procédure pénale d’ailleurs, mentionne, de façon plus contestable, les « droits » de la police judiciaire4, mais « droits » et « pouvoirs » seront ici tenus pour synonymes. Ces pouvoirs sont par nature coercitifs, les pouvoirs policiers étant fondés sur un titre de contrainte, porté par la loi dans un État de droit, titre qui fonde tous les actes de police5 au nom de la nécessité ou de l’urgence d’agir.
Plusieurs acteurs entrent en scène lors d’une enquête judiciaire pour exécuter, faire exécuter ou autoriser les actes coercitifs nécessaires à la découverte de la vérité pénale. Les enjeux sont donc essentiellement politiques dans la mesure où il s’agit de savoir qui peut faire quoi en matière d’actes coercitifs. Traiter de la question du contenu des pouvoirs (II) suppose donc d’abord d’identifier leurs titulaires (I).
I. Les titulaires des pouvoirs d’enquête
La procédure soulève toujours, au fond, une question de répartition des pouvoirs. Pour ce qui concerne les pouvoirs d’enquête, plusieurs protagonistes ont pu dans le passé ou peuvent encore aujourd’hui y prétendre : policiers, gendarmes, magistrats du parquet, du siège, préfets, policiers municipaux, agents privés, et demain, robots guidés par l’intelligence artificielle… L’enquête menée par un magistrat du siège est l’instruction préparatoire, toujours obligatoire en matière de crime. Elle était historiquement le cadre d’action de droit commun – en remontant au lieutenant criminel de l’ordonnance de 1670 – pour les enquêteurs, mais elle connaît depuis longtemps une lente agonie. Le Code d’instruction criminelle prévoyait l’enquête pour crime flagrant et l’instruction, cette dernière étant le droit commun. Mais les policiers prirent l’habitude d’enquêter même en l’absence de flagrance, avec une poursuite par citation directe par le parquet. La création du flagrant délit par la loi du 20 mai 1863 a accéléré ce déclin de l’instruction6. L’enquête dite officieuse qui se développait en dehors de la flagrance et de l’instruction devait aboutir à notre enquête préliminaire actuelle, légalisée dans le Code de procédure pénale de 1959 – et dont le renforcement constant des pouvoirs policiers achève de rendre inutile l’ouverture d’une instruction préparatoire en‑dehors des cas prévus par la loi et de l’hypothèse où une détention provisoire apparaîtrait nécessaire. C’est dire que la répartition et le développement des pouvoirs d’enquête dépendent largement de la pratique et ne sont politiquement jamais neutres. En témoigne la question des pouvoirs du préfet, que renforce encore le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (LOPMI) – devenu depuis cette communication la loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023. L’un des objectifs du ministère est de placer l’ensemble des services de police d’un département sous l’autorité du directeur départemental de la police nationale, lequel dépend du préfet7. Pour certains :
Cette réforme, ni utile ni juste, ne peut voir le jour en l'état. Elle heurte de front le principe constitutionnel d'indépendance de l'autorité judiciaire affirmé par l'article 64 de la Constitution8.
Si l’objectif est de simplifier l’organisation policière et de mobiliser des forces sur le terrain, le risque est de déshabiller les enquêteurs de police judiciaire, le tout sur fond de classique hiatus tenant au fait que la police judiciaire est placée sous l’autorité fonctionnelle des magistrats, mais aussi sous l’autorité hiérarchique du ministère de l’Intérieur. Bien que cela paraisse intellectuellement séduisant9, le rattachement de la police judiciaire au seul ministère de la Justice n’est pas pour demain. Il faut pourtant que les citoyens aient confiance dans l’indépendance politique des enquêtes – cela étant, les Français, si l’on en croit les sondages, n’ont pas non plus confiance dans leur justice. Le projet de loi conduit en réalité finalement à une espèce de généralisation du mode de fonctionnement de la préfecture de police de Paris.
Le problème de l’intervention du préfet dans la phase d’enquête n’est pas nouveau. L’article 10 du Code d’instruction criminelle de 1808, qui donnait aux préfets le pouvoir d’accomplir ou celui de requérir les officiers de police judiciaire de faire tous actes nécessaires à l’effet de constater les infractions et d’en livrer les auteurs aux tribunaux, a longuement été critiqué comme contraire à la séparation des fonctions administratives et judiciaires10. Ce pouvoir, qui permettait donc au préfet d’ordonner des actes coercitifs, y compris des perquisitions ou des gardes à vue, disparut en 1933 mais revint en 1935, puis dans un décret‑loi du 1er juillet 1939 en cas d’état de guerre ou de situation assimilable, et se maintiendra dans l’article 30 du Code de procédure pénale. Napoléon présidait la séance de travail sur cette question, la commission se demandant s’il fallait conférer aux préfets de tels pouvoirs en ce qui concerne les crimes contre la sûreté de l’État. Mais Napoléon souhaitait élargir ces pouvoirs à toutes les infractions : puisque le préfet dispose de forts moyens d’action en matière d’infractions à la sûreté de l’État, « pourquoi l’empêcher de diriger ces mêmes moyens contre les autres crimes11 ? ». Et de concilier alors le rôle du préfet et celui du procureur général : ce dernier ne devait pas commander le premier, mais le préfet allait lui envoyer les procès‑verbaux rédigés et le magistrat pourrait, soit tout recommencer, soit leur donner un acte judiciaire lorsqu’il les trouverait suffisants… La loi n° 93‑2 du 4 janvier 1993 finira par abroger l’article 30 du Code de procédure pénale, mais pas le décret‑loi de 1939 (en cas d’état de guerre), et la lutte contre le terrorisme à la fin des années 2010 va conduire le législateur à conférer de forts pouvoirs aux préfets et au ministère de l’Intérieur, à l’instar de ce qui existait pour l’état d’urgence, mais en transposant ces pouvoirs dans le droit commun (Code de la sécurité intérieure, articles L. 228‑1 à 712). Les actes de police administrative qui peuvent être ordonnés sont de nature à restreindre les libertés et peuvent révéler des infractions, de sorte que la question des liens entre enquêtes judiciaires et administratives se posera en contentieux – la Cour de cassation ayant pu admettre la compétence du juge judiciaire pour apprécier la légalité de perquisitions administratives décidées dans le cadre de l’état d’urgence lorsque ces perquisitions débouchent sur une procédure pénale13.
En tous les cas, les enquêteurs ne sauraient excéder leurs pouvoirs, l’intervention de différents acteurs étant susceptible de soulever des difficultés – ainsi, en vertu de l’article 57, alinéa 2, du Code de procédure pénale, sont irrégulières les saisies pour lesquelles l’officier de police judiciaire a requis la présence de deux policiers municipaux agissant dans l’exercice de leurs fonctions14.
Le projet de loi LOPMI déjà cité illustre la nécessité de simplifier la procédure dans la répartition des rôles. Ainsi est‑il judicieusement prévu de supprimer l'exigence d'une réquisition pour l'intervention des services de police technique et scientifique. La réquisition est un titre coercitif qui garantit les rapports juridiques avec le tiers requis : or la police technique et scientifique n’est pas un tiers. La loi présumerait aussi l’habilitation des enquêteurs à consulter des fichiers, ce qui est plus discutable compte tenu de l’importance du développement des fichiers en procédure pénale15.
Il est peut‑être bon de rappeler que, d’un point de vue théorique et quelque part historique, les pouvoirs des policiers et gendarmes devraient nécessairement être limités, parce qu’il s’agit d’actes d’instruction qui devraient donc en principe être réservés au juge d’instruction16. Mais ces pouvoirs sont consacrés par la loi en cas d’enquête préliminaire, de flagrance ou sur commission rogatoire, et chacun sait que c’est la police qui pilote en réalité les enquêtes, les magistrats n’ayant guère le temps de diriger réellement les investigations, ce qui est regrettable compte tenu de l’importance du contenu des pouvoirs d’enquête.
II. Le contenu des pouvoirs d’enquête
On pourrait distinguer les pouvoirs selon qu’ils sont intrusifs dans la vie privée ou coercitifs pour les libertés, mais c’est bien l’existence d’un titre de coercition qui justifie les atteintes portées aux droits fondamentaux : ainsi la coercition va justifier l’intrusion – exception faite du cas devenu assez résiduel où l’on peut s’opposer à une mesure intrusive, comme une perquisition en enquête préliminaire concernant des faits peu graves. En revanche, si un acte d’investigation n’est ni intrusif ni coercitif, les enquêteurs peuvent y recourir sans qu’il soit besoin d’un encadrement particulier du Code de procédure pénale. Par exemple, des enquêteurs peuvent fouiller un sac poubelle déposé dans un conteneur collectif par un individu surveillé17 : il n’y a pas d’atteinte à la vie privée selon la chambre criminelle, donc pas besoin d’autorisation judiciaire préalable à l'exploitation de son contenu.
À l’inverse, lorsque l’acte est coercitif ou intrusif et qu’il n’est pas réglementé, ce que certains appellent un acte innomé18 c’est‑à‑dire inconnu du Code de procédure pénale – et faute d’une jurisprudence suffisamment claire et prévisible apportant des garanties19 –, il ne devrait pas pouvoir être accompli : en procédure pénale, « tout ce qui n’est pas autorisé est interdit20 ». C’est bien pourquoi le Code de procédure pénale prévoit divers actes d’enquête dont le régime juridique dépendra du cadre d’investigation. Tous les étudiants préparant les sujets d’examens et concours de procédure pénale savent que pour traiter un cas pratique, il faut identifier le cadre d’enquête pour en déduire la légalité des actes opérés ; les pouvoirs dépendent de cette qualification. Ainsi une perquisition pourra‑t‑elle, selon les cadres d’enquête, être légale ou annulable. Mais ce n’est pas tout, puisque l’évolution du droit pénal contemporain ajoute à cet examen de légalité tenant au cadre l’existence de pouvoirs dérogatoires au droit commun, lorsqu’il s’agit notamment de lutter contre la criminalité organisée et le terrorisme. Dans chaque cadre d’investigation, des règles dérogatoires peuvent donc justifier l’accomplissement d’actes coercitifs particuliers. Par exemple, l’enquête préliminaire, ouverte très facilement, ne pouvait pas, autrefois, justifier l’usage de la contrainte21. L’évolution législative a cru bon toutefois d’introduire la coercition dans l’enquête préliminaire en la contrebalançant par un renforcement du contrôle opéré par un magistrat. Le meilleur exemple est encore la perquisition. Elle était non coercitive, donc soumise au consentement de l’occupant, dans l’enquête préliminaire jusqu’à ce qu’une loi du 9 septembre 1986 vienne permettre à un juge de contourner le refus de l’intéressé en matière d’infractions terroristes. Une loi du 15 novembre 2001 devait étendre cette exception à d’autres infractions, et la loi du 9 mars 2004 finira par généraliser cette dérogation pour tout crime ou délit punissable d’au moins cinq ans d’emprisonnement, le juge des libertés et de la détention pouvant autoriser la perquisition. La loi du 23 mars 2019 abaisse ce seuil à trois ans d’emprisonnement, de sorte qu’aujourd’hui finalement l’occupant ne peut s’opposer à une perquisition que pour de petites infractions. Plus grave, la loi de 2004 et celle du 3 juin 2016 vont permettre des perquisitions nocturnes : non domiciliaires « si les nécessités de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73 et 706‑73‑1 l'exigent », et domiciliaires « en cas d'urgence et pour les enquêtes préliminaires concernant une ou plusieurs infractions mentionnées au 11° de l'article 706‑73 », c’est‑à‑dire en matière de terrorisme, à condition toutefois que leur réalisation soit nécessaire afin de prévenir un risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique.
Chacun constate donc que le législateur procède par vagues successives, autorisant à titre exceptionnel des mesures qui finissent par pénétrer le droit commun. C’est ce qu’on pourrait appeler la « loi » du renforcement déraisonnable des pouvoirs d’investigations, aux termes de laquelle on commence par introduire une exception aux règles de droit commun, avant d’élargir le champ de l’exception, puis de permettre que l’exception devienne quasiment la règle.
Une autre « loi » se profile derrière celle‑ci : celle de l’adaptation aux progrès techniques. Chacun sait que les « écoutes téléphoniques », telles qu’on les appelle encore parfois, sont devenues aujourd’hui des interceptions judiciaires qui vont bien au‑delà des appels téléphoniques – les appels téléphoniques sont réservés aux démarcheurs en tout genre ! – et les malfaiteurs n’échappent pas à l’évolution des usages et communiquent par messageries. Ainsi donc, des bandits peuvent‑ils échapper à des interceptions de communications en procédant de la façon suivante : ils rédigent un brouillon de message, par exemple un courriel ; mais ils ne l’envoient pas à leurs correspondants puisqu’ils peuvent redouter d’avoir été placés sur « écoutes » ; en effet, ces correspondants peuvent détenir le mot de passe d’accès à la messagerie et aller lire le brouillon du message non envoyé, mais toutefois ainsi communiqué. Il fallait bien alors imaginer des dispositifs permettant l’accès aux messages stockés ou archivés. C’est ce qui avait posé problème dans un arrêt du 8 juillet 201522. Un juge d’instruction avait délivré une commission rogatoire afin d’intercepter les communications d’un détenu soupçonné de mener des infractions depuis sa cellule. Des courriels archivés avant la date de la commission rogatoire ont été obtenus et la Cour de cassation a dû juger que l’appréhension, l’enregistrement et la transcription de courriers électroniques archivés n’entrent pas dans les dispositions des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale relatifs aux interceptions judiciaires. Effectivement, ces données ont été échangées avant la décision d’interception, de sorte qu’on ne pouvait pas les intercepter… Il aurait fallu en l’espèce perquisitionner la cellule de l’intéressé et/ou son ordinateur, en respectant les formalités relatives à cet acte d’enquête. La loi a évolué alors, la loi du 3 juin 2016 a créé l’article 706‑95‑2 du CPP qui permettait au juge d’instruction, en matière de criminalité organisée, d’autoriser par ordonnance motivée l'accès, à distance et à l'insu de la personne visée, aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique. Depuis la loi du 23 mars 2019, donc depuis le 1er juin 2019, le juge d’instruction a le même pouvoir en ce qui concerne des crimes de droit commun. De surcroît, l’article 706‑95‑1 du Code de procédure pénale offre désormais les mêmes possibilités au cours d’une enquête :
Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73 et 706‑73‑1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée l'accès, à distance et à l'insu de la personne visée, aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique. Les données auxquelles il a été permis d'accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support.
Le problème dans cette espèce de loi de l’évolution est dans la légalité matérielle des pouvoirs des enquêteurs. Il est bien évident que le banditisme utilise voire invente des moyens techniques nouveaux, qui ne sont pas susceptibles de donner lieu légalement à une interception, à une saisie par les enquêteurs, car la loi est forcément en retard, elle suit le fait ; les enquêteurs vont alors s’adapter et quand même accomplir les actes permettant d’administrer la preuve pénale ; le juge interne interprète alors les textes existants afin de valider les procédures ou, parfois, il invalide le procédé ; la jurisprudence se prononce en effet sur la légalité matérielle des actes, classiquement la Cour de cassation a pu justifier de tels actes afin de sauver les procédures23 ; puis la Cour européenne des droits de l’homme, voire la Cour de justice de l’Union européenne, vont intervenir le cas échéant pour contredire la jurisprudence interne ; dans tous les cas, le législateur adoptera alors un texte afin d’encadrer la pratique de tel ou tel procédé de recherche de preuve et sécuriser la procédure pénale pour éviter des condamnations des juridictions européennes ou une abrogation du Conseil constitutionnel. La boucle est bouclée jusqu’au prochain usage d’un moyen technique nouveau… La machine peut toutefois s’enrayer lorsque les problèmes s’accumulent : ainsi du droit des réquisitions de données de connexion24.
Une troisième « loi » se dessine enfin : celle de la confusion et de la porosité entre la police judiciaire et la police administrative, des pouvoirs d’enquête étant octroyés « matériellement » à la police administrative25, ce qui justifie à son tour le renforcement de pouvoirs policiers pour les enquêtes judiciaires : ainsi des IMSI‑Catchers, procédés octroyés aux services de renseignements en 2015 puis à la police judiciaire en 201626, très utilisés en matière de stupéfiants alors qu’ils étaient présentés comme un outil de lutte contre le terrorisme. On entre alors dans une logique de police préventive, dans laquelle ce n’est plus le soupçon de commission d’une infraction qui légitime l’usage d’actes intrusifs ou coercitifs, mais la menace plus ou moins invisible qui pèse sur les intérêts du pays. Mais c’est sans doute là une vision de pénaliste attaché à un régime de libertés dans lequel la contrainte doit intervenir en cas d’infraction tentée ou consommée, alors que la police administrative devrait de son côté demeurer dans l’ombre comme l’aurait pensé Fouché.
Fort de ces constats, on comprend qu’il soit impossible de lister l’ensemble des pouvoirs d’enquête judiciaire.
Le Code de procédure pénale autorise bien des choses. Il permet aux enquêteurs de fouiller des lieux, d’obtenir des renseignements, des déclarations, mais aussi de surprendre des informations en interceptant des communications ou en s’immisçant dans des systèmes informatiques, ou encore de suivre les déplacements en temps réels d’individus. Ces perquisitions, réquisitions, auditions, interceptions judiciaires ou autres techniques spéciales, ainsi que la géolocalisation sont bien évidemment encadrées par la loi et ne sont pas toujours susceptibles d’être employées, et pas dans les mêmes conditions, notamment d’autorisation. Il existe des actes de droit commun et des actes dérogatoires. Cette distinction doit être couplée à celle des cadres d’investigation. L’autorité qui dirige les enquêteurs n’est pas la même selon qu’il y a instruction – c’est le juge d’instruction –, enquête de flagrance – une certaine autonomie est laissée aux OPJ –, enquête préliminaire – le procureur doit autoriser préalablement les actes, et si l’on est dans le registre d’actes dérogatoires, l’autorisation du juge des libertés et de la détention sera le plus souvent requise en phase d’enquête.
S’agissant de la preuve numérique, de plus en plus de pouvoirs sont octroyés aux magistrats et policiers dans le dessein de recueillir des données numériques – captation de données informatiques27, cyber‑patrouilles28, etc. Créée en 2017, l’Agence nationale des techniques d’enquêtes numériques judiciaires (ANTENJ) est chargée du pilotage et de la gestion de la Plate‑forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ). Son expertise peut également être sollicitée pour l’emploi de plusieurs techniques d’enquêtes, comme la mise au clair de données chiffrées. L’ANTENJ gère aussi le stockage des preuves numériques.
La loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 a tenté d’élargir ces dispositifs intrusifs, qu’elle renomme techniques spéciales d’enquête, aux crimes de droit commun, mais le Conseil constitutionnel a – pour l’instant – refusé cet élargissement généralisé29. Le législateur entendait autoriser le recours à des techniques d’enquête particulièrement intrusives pour des infractions ne présentant pas nécessairement un caractère de particulière complexité, sans assortir ce recours des garanties permettant un contrôle suffisant par le juge du maintien du caractère nécessaire et proportionné de ces mesures durant leur déroulé. Aux yeux du Conseil :
Le législateur n’a donc pas opéré une conciliation équilibrée entre, d’un côté, l’objectif de recherche des auteurs d’infractions et, de l’autre, le droit au respect de la vie privée, le secret des correspondances et l’inviolabilité du domicile30.
Quant aux cyber‑patrouilles, de leur vrai nom enquêtes sous pseudonyme, elles sont étendues à tous les crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement commis par voie de communications électroniques. Le Conseil constitutionnel juge en effet que le législateur n’a pas méconnu le droit à un procès équitable et qu’il n’a pas opéré une conciliation déséquilibrée entre l’objectif de recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée31. Comme l’a écrit Jean Pradel :
La loi passe donc d’un système éclaté à un système unique englobant toutes infractions punies d’une peine privative de liberté. Cette extension ne pose pas de difficulté au regard des exigences constitutionnelles puisqu’il n’est pas porté atteinte au respect de la vie privée et qu’est maintenue la règle que les actes des enquêteurs ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions32.
Au total, il existe un arsenal de moyens d’enquête considérable, dont la lisibilité est rendue complexe par ce que Messieurs les professeurs Guinchard et Buisson appellent un « répertoire commun » et un « répertoire spécial33 » d’actes de recherche de preuve. La tendance est à l’élargissement des actes dérogatoires particulièrement intrusifs – on parle bientôt dans le projet de loi de réforme du Code de procédure pénale de pouvoir déclencher à distance des smartphones afin de constater en temps réel ce qu’en fait l’utilisateur ou ce qu’il dit. La question des pouvoirs en appelle donc nécessairement une autre : celle de la possibilité, pour la défense, de soulever des causes de nullité afin de faire respecter la légalité procédurale, notamment dans des procédures incidentes, au besoin avec le soutien de la jurisprudence européenne – et même si elle va parfois très loin comme en matière de réquisitions de données (v. supra). On ne sait plus bien qui de Churchill ou de l’oncle de Spiderman (ou d’un autre encore) l’a dit mais « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ».