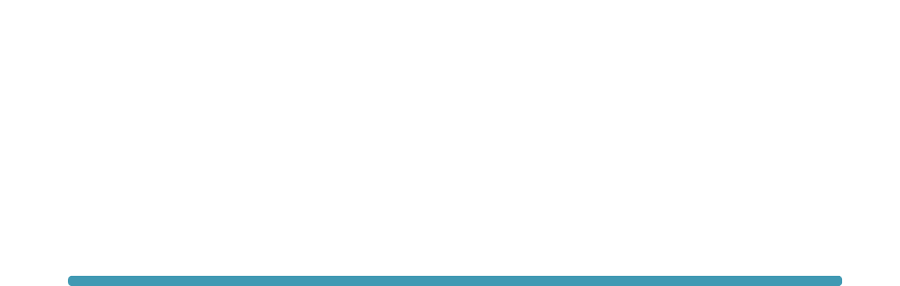Que peut-on ajouter de plus à un phénomène dénoncé depuis plus de quarante ans et qui a donné lieu à une série ininterrompue de contentieux depuis tout aussi longtemps ? Qui ne sait toujours pas que les plages du Finistère sont polluées par une prolifération d’algues vertes toxiques, due à l’épandage des exploitants agricoles, et qui perdure en dépit des nombreuses condamnations provenant des juridictions judiciaires, des juridictions administratives et même de la Cour de justice de l’Union européenne ? Ces informations constituent désormais des lieux communs que l’on accueille avec une sorte de résignation attristée.
Ce qui peut en revanche surprendre, c’est l’identité des parties ou l’objet des recours intentés pour mettre un terme à la pollution. Des associations ou, plus rarement, des particuliers attaquent les collectivités territoriales, et les collectivités territoriales, ou les associations attaquent l’État et, parfois, c’est la Commission européenne qui lance un recours en manquement contre ce même État français. Quant au type de contentieux, il est généralement de pleine juridiction, introduit aux fins d’obtenir une réparation, mais il arrive aussi que ce soit un contentieux de légalité visant à l’annulation d’un acte administratif. Il s’ensuit que le responsable désigné de la pollution devant les juges est la personne publique, surtout l’État. La constance de cette désignation, des années soixante-dix à nos jours, met en évidence l’absence d’un autre acteur, pourtant largement évoqué dans les décisions de justice. Cette absence flagrante, cette présence sous-entendue, c’est celle de l’exploitant agricole.
Il ne s’agit pas de jeter l’opprobre sur une profession. L’ensemble du secteur agroalimentaire détient une part de responsabilité dans la pollution des plages bretonnes. Pour autant, cela ne suffit pas à dédouaner les agriculteurs. Leur action, qu’elle soit téléguidée ou décidée de leur propre chef est la cause objective de la prolifération des algues vertes. Dès lors, il est légitime de s’interroger sur les raisons du silence entourant le rôle des agriculteurs et la prépondérance donnée inversement à l’État dans l’origine de la pollution.
Parmi les explications possibles, on peut avancer celle d’une approche trop utilitariste du droit de l’environnement et, plus particulièrement, de la notion de responsabilité environnementale.
Le droit de l’environnement s’est développé au cours du XXe siècle à l’occasion des contentieux fondés sur les troubles de voisinage, puis des procédures engagées à la suite de grandes catastrophes environnementales. On peut citer à titre d’exemple le naufrage de l’Amoco Cadiz et la marée noire que le pétrolier a provoquée en 1978. En résumé, le droit de l’environnement est né de la notion de responsabilité, de sorte qu’il entretient avec elle une relation privilégiée. Elle va ainsi spontanément s’imposer dans toute réflexion sur la lutte contre la pollution et même sur la prévention de la pollution. Mais comme il s’agit d’une notion juridique, définie dans un cadre contentieux, son application conduit à des configurations préétablies dont il s’avère impossible de sortir dès lors que le processus est engagé. L’individu ou l’entité qui veut lutter contre une pollution par la voie juridictionnelle invoquera la notion de responsabilité et, par conséquent, il devra désigner un ou des responsables et, pour avoir une chance de gagner son procès, il choisira le responsable le plus à même de réparer le dommage, autrement dit le plus solvable. La notion de responsabilité est ainsi faite qu’il faut passer par un tri préalable pour atteindre le but recherché.
Ce mécanisme explique la situation actuelle, dans laquelle la responsabilité juridique de l’État est mise en avant pour combattre la prolifération des algues vertes (I). Elle ne saurait toutefois cacher la responsabilité des agriculteurs qui, à défaut d’être reconnue juridiquement, demeure théorique (II). Pour sortir de ce cadre où est enfermé le débat sur les algues vertes, il faudrait peut-être repenser les prémisses du raisonnement et envisager en plus du principe de responsabilité l’application d’un autre principe, celui du pollueur-payeur (III).
I. La responsabilité juridique de l’État
Avant que la responsabilité de l’État ait été dénoncée devant les juridictions, il a fallu passer par d’autres étapes dans lesquelles les requérants attaquaient en priorité les communes. D’un point de vue territorial, cela semble plus logique puisque la pollution frappe les plages, c’est-à-dire des lieux relevant de la compétence communale. Les associations de défense de l’environnement invoquaient le dommage pour la santé et pour l’environnement. Les communes, sommées de nettoyer les plages à leurs frais, attaquèrent le département du Finistère devant le tribunal administratif. Le département, condamné à indemniser les communes, saisit à son tour les juges administratifs afin d’obtenir le versement d’indemnités de la part de l’État. C’est là une description très sommaire de quarante ans de contentieux, comprenant une multitude de jugements des tribunaux administratifs bretons et d’arrêts des cours administratifs d’appel.
Les moyens soulevés ont évolué au fur et à mesure que le niveau territorial de responsabilité a été relevé. De l’obligation de nettoyer les plages à la charge des communes, on est passé ensuite à l’obligation, pour l’État, de contraindre les exploitants agricoles à respecter les normes environnementales ; c’est ce dernier moyen qui a fructifié, de juridictions en juridictions. L’État s’est vu rappeler, par ce biais, l’obligation de respecter ses devoirs : le devoir d’appliquer la directive européenne sur la protection des eaux contre la pollution au nitrate et le devoir de surveillance ou de réglementation des activités soumises à la police des installations classées.
Dans un arrêt du 1er décembre 2009, la Cour administrative d’appel de Nantes pointe ainsi les carences de l’État en matière d’installations classées : malgré les prescriptions de l’art. 511-1 et suivant du Code de l’environnement, l’État ‑– en la personne de son préfet — n’a pas procédé aux contrôles auxquels doivent être soumises les exploitations agricoles. Quant aux éleveurs, d’abord exemptés de l’obligation de demander l’autorisation préfectorale de s’installer, ils ont bénéficié par la suite de régularisations massives.
L’inertie de l’État face à ses propres obligations fait apparaître une succession de fautes qui ont persisté, malgré les nombreuses condamnations en justice. Une telle constance dans l’illégalité conduit à se demander si les fautes de l’État ne tiennent pas lieu en réalité de politique agricole, si en d’autres termes, elles ne sont pas l’expression d’une volonté de ne pas faire. En suivant cette perspective, on peut considérer que le versement des indemnités constitue un coût assumé, entrant dans le budget de la politique agricole fantôme. L’État semble de la sorte opposer politique agricole et politique environnementale, privilégiant la première au détriment de la seconde. La Cour des comptes déplore ainsi, dans un rapport de 2001, « le caractère accessoire de la question environnementale en regard du pilotage économique du secteur porcin »1. L’inertie de l’État n’est cependant pas réservée au seul problème de la pollution de l’eau par les algues vertes. Elle se retrouve dans une autre affaire, portant sur la pollution de l’eau potable. En 2001, la société Suez Lyonnaise des Eaux, condamnée par le juge judiciaire à indemniser des consommateurs pour avoir distribué de l’eau impropre à la consommation, engage devant le tribunal administratif de Rennes une action récursoire contre l’État. La société obtient une indemnisation pour le préjudice d’image, ainsi que le remboursement intégral des indemnités versées aux consommateurs. L’État, lui, est jugé responsable pour carence fautive dans la mise en œuvre des contrôles agricoles imposés par la police des installations classées2.
La faute de l’État est établie devant les juridictions. La persistance de la faute, comme sa généralisation au-delà de la pollution par les algues vertes, renforce sa portée. L’État est donc responsable, sans le moindre soupçon de doute. Mais il est avant tout responsable de laisser perdurer une pollution dont on ne saurait l’accuser d’être l’auteur. Celui qui a pollué est multiple et indivisible. Il s’agit des exploitants agricoles.
II. La responsabilité théorique des agriculteurs
Si la responsabilité de l’État a été démontrée au cours de plusieurs procédures juridictionnelles, il en va autrement de celle des agriculteurs. En l’absence de reconnaissance formelle de leur responsabilité, celle‑ci demeure théorique. De même, il serait exagéré d’évoquer leur faute puisqu’elle n’a pas été déclarée par les tribunaux. On peut simplement mentionner le fait des agriculteurs dans la production des algues vertes. Tout en restant aussi évasif que le droit le permet, il est cependant possible d’affirmer ce fait en reprenant la définition donnée par la Cour administrative d’appel de Nantes dans l’arrêt précité de 2009 : « Le phénomène de prolifération des ulves [est] dû essentiellement aux excédents de nitrates issus des exploitations agricoles intensives »3. Reste alors à expliquer la sorte d’immunité dont bénéficient les exploitants agricoles et grâce à laquelle ils ont jusqu’à présent échappé aux sanctions juridictionnelles fondées sur le régime de la responsabilité.
Il convient d’emblée de relever que les autorités françaises n’ont pas usé de la faculté, accordée par la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale, d’exclure de son champ d’application les activités d’épandage agricole4. Néanmoins, la loi du 1er août 2008, portant transposition de la directive, prévoit que son régime ne s’applique pas aux dommages « causés par une pollution à caractère “diffus”, sauf s’il est démontré le lien de causalité entre les dommages et les activités des exploitants »5. Cette hypothèse conduit à exclure les agriculteurs du régime de la responsabilité environnementale visé par la loi,6 car la pollution provoquée par les algues vertes n’est pas le fait d’un seul agriculteur. Sa nature diffuse empêche d’établir tout lien de causalité entre l’activité d’un exploitant déterminé et le dommage à l’environnement.
À défaut de saisir les tribunaux, les autorités publiques pourraient agir de manière préventive, par l’application de textes encadrant les activités agricoles. On peut citer à titre d’exemple la législation sur les installations classées à des fins environnementales. Elle prévoit l’obligation pour les éleveurs de demander une autorisation préfectorale lorsqu’ils possèdent un nombre déterminé de bétails (Code env., art. L. 512-1 et s.). Un deuxième exemple de réglementation est fourni par le système des zones en excédent structurel d’azote (c’est-à-dire des zones où la quantité d’azote produite par les déjections animales dépasse la capacité d’absorption des sols) (Code env. art. R. 211-82). Dans les deux cas cités, les pouvoirs publics ont mis en place des instruments normatifs susceptibles de limiter la pollution agricole, sans toutefois obtenir des résultats à la hauteur de leurs ambitions. Comme le dénonce la Cour des comptes dans le rapport de 2001, les deux régimes font l’objet d’une application très tolérante à l’égard des agriculteurs, lesquels sont souvent soustraits aux contrôles et aux sanctions nécessaires à l’effectivité de la réglementation. De son côté, la Cour de justice de l’Union européenne constate, dans un arrêt de 20017, que les programmes de résorption pour les zones d’excédent structurel et le Programme « Bretagne Eau Pure » concernent uniquement les secteurs les plus pollués de Bretagne, sans prendre en compte les secteurs dans lesquels les eaux superficielles présentent « des taux préoccupants de nitrates » (§ 35).
L’indulgence des autorités publiques françaises à l’égard des agriculteurs se manifeste d’une autre manière, par le recours régulier à des mesures incitatives visant à convaincre les agriculteurs de modifier leurs pratiques. Les mesures s’accompagnent d’aides financières, mais comme aucune sanction n’est prévue pour vaincre les résistances, le succès de ce type de stratégie repose uniquement sur la bonne volonté des agriculteurs8.
La solution à la pollution par les algues vertes ne viendra pas, de toute évidence, d’une impulsion politique, mais l’on peut aussi douter de l’efficacité d’un régime juridique fondé essentiellement sur la notion de responsabilité.
III. Principe de responsabilité et principe du pollueur-payeur
Bien qu’il existe des actions en justice susceptibles d’être engagées sur le fondement de la responsabilité des agriculteurs, il vaudrait mieux emprunter d’autres voies pour lutter contre la prolifération des algues vertes en Bretagne. Le choix des actions en justice s’avère trop aléatoire. Il faudrait déjà trouver le demandeur – association, collectivité territoriale ou autres – qui accepterait d’engager une action contre un ou plusieurs agriculteurs. Le risque étant de stigmatiser un secteur économique essentiel pour la Bretagne, peu de justiciables oseraient se lancer dans une telle démarche. Si d’aventure cette première étape était franchie, le demandeur devrait ensuite réunir les conditions indispensables au succès d’une action en responsabilité, à savoir la preuve du fait dommageable, du préjudice et du lien de causalité entre les deux. Sans compter sur la démonstration préalable de l’intérêt à agir.
Normalement, la responsabilité environnementale est fondée sur la faute, comme le rappelle le Conseil constitutionnel dans une décision de 2011. Le Conseil appuie son raisonnement sur l’art. 4 de la Charte de l’environnement, qui pose le principe de la responsabilité du pollueur9. Le demandeur doit ainsi établir la faute, condition quasiment impossible à réaliser dans le cas de la pollution agricole, en raison de la pluralité des pollueurs. Mais il n’est pas davantage assuré de gagner en optant pour le régime de la responsabilité objective consacré par la loi du 8 août 2016, relative au préjudice écologique (nouvel art. 1246 du Code civil). Même s’il est dispensé dans ce cas de démontrer l’existence d’une faute10, il continuera de se heurter à la difficulté principale d’une pollution diffuse. C’est ce qui apparaît dans les considérants de la directive de 2004 : « La responsabilité ne constitue pas […] un instrument approprié face à la pollution à caractère étendu et diffus, pour laquelle il est impossible d’établir un lien entre les incidences environnementales négatives et l’acte ou l’omission de certains acteurs individuels » (consid. 13).
La CJUE a donné à la directive une interprétation plus nuancée : il est toujours possible pour un État membre d’adopter une réglementation qui permet de présumer un lien de causalité, sous réserve qu’il existe des « indices plausibles susceptibles de fonder sa présomption ». Un des indices demandés est celui de la proximité de l’installation polluante avec la zone de pollution11. La jurisprudence de la Cour de justice fournit à la responsabilité issue de la directive une dimension objective. Mais, en réalité, c’est le principe même de responsabilité qui semble inapproprié dans le cas de la pollution des plages bretonnes : d’une part, sa mise en œuvre est compliquée et, d’autre part, elle conduit dans le meilleur des cas à une réparation, nécessairement limitée eu égard à la gravité du dommage subi par l’environnement12. Enfin et surtout, cette réparation intervient a posteriori. Or, l’idéal serait de prévenir le dommage, d’empêcher sa réalisation. Le principe le mieux adapté à cet objectif n’est ni le principe de responsabilité, ni même le principe de précaution (d’une portée trop limitée), mais c’est le principe du pollueur-payeur.
Il n’est pas rare de confondre le principe de responsabilité et celui du pollueur-payeur. La CJUE se laisse aller à cette tendance dans l’arrêt précité du 9 mars 2010, inclinaison encouragée par une rédaction ambiguë de la directive de 200413. Les constituants français ont pour leur part nettement distingué les deux principes lors de l’adoption de la Charte de l’environnement : ils ont sciemment écarté le principe du pollueur-payeur au profit de la reconnaissance du principe de responsabilité (art. 4), au motif que le premier principe avait l’inconvénient d’accorder un droit de polluer.
Il s’agit là d’une interprétation restrictive du principe. L’économiste anglais, Arthur Cecil Pigou, qui l’avait découvert dans les années trente, le concevait comme posant l’obligation, pour le pollueur, de verser une contribution égale au montant de sa pollution, en incluant les coûts directs comme les coûts cachés (les « externalités négatives »). La confusion avec le principe de responsabilité vient en partie du vocabulaire utilisé puisque, dans les deux hypothèses, on emploie le terme de réparation. Cependant, si la réparation constitue une indemnisation en matière de responsabilité, il s’agira d’un paiement dans le cas du principe du pollueur-payeur. L’idée est d’intégrer l’opération de pollution dans les coûts du pollueur afin de l’inciter à modifier ses comportements. On écarte de cette manière la notion de responsabilité et les limites qui lui sont propres, par exemple les causes exonératoires, les notions de dommage diffus, de partage de responsabilité ou encore d’action récursoire. C’est l’un des avantages principaux du principe du pollueur-payeur.
Un autre de ses avantages, et pas des moindres, apparaît dans sa mise en œuvre. Elle peut conduire à l’instauration de taxes, telles que la redevance pollution diffuse ou la redevance élevage. Certes, le montant de ces redevances est notoirement trop faible, en raison, là aussi, de l’indulgence des autorités publiques à l’égard des agriculteurs, mais cette application décevante ne saurait effacer l’intérêt de l’instrument fiscal en matière environnementale : sa nature dissuasive contribue à une prise de conscience de la part des contribuables, ici les agriculteurs.
La fiscalisation de la pollution agricole conduit à un constat qui fera office de conclusion : il existe des instruments fiscaux, plus faciles à utiliser que les procédures en justice fondées sur la responsabilité ; il existe un principe du pollueur-payeur, plus adapté au cas de pollution diffuse que le principe de responsabilité ; il existe des solutions clefs en main. Il suffit maintenant de les actionner.