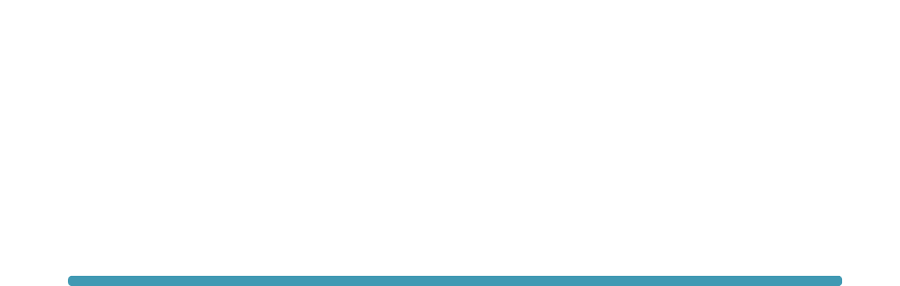I. Sources
L’article 41 de l’ordonnance du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts qui déclarait la propriété du roi « de tous les fleuves et rivières portant bateaux de leur fonds sans artifice et ouvrages de mains » y a apporté la réserve des « droits de pêche, moulins, bacs et autres usages que les particuliers peuvent y avoir par titres, possessions valables auxquels ils seront maintenus ». Ce dispositif a été confirmé par un édit d’avril 1683 précisant que sont concernés « [les] titres de propriété authentiques faits avec les rois nos prédécesseurs, en bonne forme, auparavant l’année 1566 [NB : l’Édit de Moulins de 1566 a proclamé l’inaliénabilité du domaine de la Couronne] (v. Championnère, De la propriété des eaux courantes, Paris 1846, p. 657 s., n° 382).
La loi des 15-28 mars 1790 relative aux droits féodaux a maintenu dans leurs droits mouliniers et usiniers, alors même qu’ils étaient entachés de féodalité et a enjoint aux corps constitués de veiller à leur conservation. Ce dispositif a été confirmé par l’article 14 du décret des 22 novembre et 1er décembre 1790 relatif aux domaines nationaux, aux échanges et concessions, et aux apanages a maintenu ces droits :
L’Assemblée nationale confirme les ventes et aliénations pures et simples sans clause de rachat, même les inféodations, dons et concessions à titre gratuit sans clause de réversion, pourvu que la date de ces aliénations à titre onéreux ou gratuit soit antérieure à l’ordonnance de février 1566 (v. Mestre, Le régime juridique des usines fondées en titre : 1930 DH, chr. p. 57).
« Laisser l’anarchie détruire tous les moulins, c’eût été remplacer la révolution par la famine », expliquait Dalloz pour justifier que la loi des 15-28 mars 1790 relative aux droits féodaux ait maintenu dans leurs droits mouliniers et usiniers, alors même qu’ils étaient entachés de féodalité et ait enjoint aux corps constitués de veiller à leur conservation (Dalloz, Répertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence, Paris, 1852, T.XIX, p. 402, n° 290). La chose fut cependant contestée dans son principe, notamment par Merlin, qui se demandait comment des seigneurs justiciers, agents subalternes dont les fonctions n’ont jamais « perdu leur nature primitive et originelle de fonctions publiques » et qui « n’ont jamais pu prendre le caractère d’une propriété », ont pu transmettre le caractère de propriété sur les objets sur lesquelles elles s’exerçaient en concédant des droits auxdits mouliniers et usiniers :
Un seigneur justicier n’a jamais pu se considérer comme propriétaire de sa justice, ni, par une suite nécessaire, des rivières soumises à sa justice (Merlin de Douai, Recueil alphabétique des questions de droit qui se présentent le plus fréquemment dans les tribunaux, Paris, 1820, 3e éd. T. II, p. 101).
Ces droits ont également pu être acquis lors de la vente des biens nationaux, sous réserve qu’ils comportent effectivement une aliénation de droits à l’usage de l’eau, ce qui n’est pas le cas, par exemple, d’une vente du 21 germinal an VI, qui ne conférait à l’acquéreur aucun droit à l’usage de l’eau, mais se bornait à lui ouvrir une faculté de prise d’eau sur la chaussée du moulin de Bazacle, appartenant à des tiers (CE, 25 mai 1990, req. n° 84813, Andrieu et Ratery).
Le Conseil d’État et la Cour de cassation ont confirmé l’existence de ces droits dits « fondés en titre » ou ayant une existence légale : « ni les lois révolutionnaires, ni la législation intermédiaire, ni le Code civil n’ont porté atteinte aux droits régulièrement émanés de la puissance féodale au profit des particuliers non-seigneurs » pose ainsi en principe la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 17 juillet 1866, Grimardias : DP 1866, I, 391), à la suite du Conseil d’État (notamment CE, 18 juin 1852, Roussille : Rec. p. 249).
Consécration : l’article L. 210-1 du Code de l’environnement qui ouvre le titre du Code de l’environnement consacré à l’eau et aux milieux aquatiques prévient que ce n’est que “dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, (que) l’usage de l’eau appartient à tous”.
Notamment, l’édit de Moulins n’étant pas doté d’une force rétroactive, il n’a pu être opposé à des droits acquis sur des territoires postérieurement à son édiction, mais antérieurement au rattachement desdits territoires à la couronne française. À leur égard, c’est donc la date dudit rattachement et non celle de l’édit de Moulins qui marque le départ au-delà duquel un droit d’eau ne pourra pas être considéré comme fondé en titre.
Par exemple, dès l’instant où le Béarn n’a été rattaché à la France qu’en 16201, il a été jugé qu’un moulin établi sur une section domaniale du Gave d’Oloron-Sainte-Marie dont l’existence était attestée depuis mars 1585, c’est-à-dire, postérieurement à l’édit de Moulins, mais antérieurement au rattachement du Béarn au Royaume de France, devait être regardé comme fondé en titre2. Ensuite, par différents textes confiscatoires3, l’État révolutionnaire a pris possession des biens ecclésiastiques comme de ceux des hospices ou de ceux des émigrés.
Considérés comme intangibles sauf consentement de la Nation sous l’empire de la loi des 22 novembre et 1er décembre 1790, ces biens furent finalement mis à la vente pour financer la Révolution.
Ces ventes nationales furent ensuite considérées comme inviolables tant par la Constitution du 22 frimaire an VIII que par la Charte de 1814.
D’un point de vue jurisprudentiel, après quelques hésitations4, le juge administratif renonça finalement à distinguer, parmi les usines vendues, celles disposant de titres antérieurs à 1566 de celles autorisées ou simplement tolérées postérieurement à cette date.
Il en résulte que tous les établissements disposant d’un droit d’eau sur le domaine public et vendus comme biens nationaux doivent être considérés comme fondés en titre indépendamment de la date du titre en ayant originellement autorisé l’exploitation5.
Le législateur contemporain a rejoint le juge puisqu’il considère, à son tour, à l’article L. 3111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) que « le domaine public maritime et le domaine public fluvial sont inaliénables sous réserve des droits et des concessions régulièrement accordés avant l’édit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux ».
Preuve de leur prégnance sur le domaine public, les établissements fondés en titre ne sont pas même assujettis au paiement des redevances domaniales6.
II. Preuves
Les titulaires contemporains de ces droits rencontrent cependant deux difficultés, liées à un problème matériel et juridique :
– établir dans un premier temps l’existence de leurs droits ;
– dans un second temps, établir leur consistance.
A. Existence
Sur le premier point, le Conseil d’État a estimé « que sont regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale les prises d’eau sur des cours d’eau non domaniaux qui, soit ont fait l’objet d’une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux ; qu’une prise d’eau est présumée établie en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux dès lors qu’est prouvée son existence matérielle avant cette date » (CE, 5 juillet 2004, req. n° 246929, SA Laprade Énergie : Rec. CE. p. 294 ; JCPA 2004, n° 1846, obs. Rouault ; AJDA 2004, p. 2219, obs. Sablière ; RFD adm. 2004,103 4, concl. Lamy).
Si les juridictions admettent tous « titres ou documents » (CE, 8 avril 1987, req. n° 44092, Époux Jory), la matérialité de l’ouvrage peut substituer le titre « papier ». Comme le relève Ph. Marc, “compte tenu du caractère ancien de ces titres et de la difficulté à les produire la jurisprudence fait preuve d’une certaine mansuétude en admettant qu’il ne soit pas toujours nécessaire de produire les titres authentiques de vente pour qu’une prise d’eau soit déclarée « fondée en titre »” (Marc, Les cours d’eau et le droit, Éditions Johanet 2006, p. 111). Ainsi, une prise d’eau est présumée établie en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux dès lors qu’est prouvée son existence matérielle avant cette date.
B. Consistance
C’est cette même mansuétude qui anime les juridictions lorsqu’il s’agit de rapporter la consistance du droit. Ainsi, la circonstance légale d’une prise d’eau doit “être présumé conforme à sa consistance effective actuelle, du moins s’il [n’est] alléguée par l’Administration aucun fait précis duquel on puisse inférer que la quantité d’eau utilisée a été augmentée depuis la date à laquelle l’usine a acquis son “existence légale”” (Rougeaux, Les prises d’eau « fondées en titre » : CJEG 1973, p. 65). Ainsi, dans l’arrêt « SA Laprade Énergie », le Conseil d’État a estimé que « un droit fondé en titre conserve la consistance qui était la sienne à l’origine » et jugé que la force motrice théoriquement disponible doit être « appréciée au regard de la hauteur de la chute d’eau et du débit du cours d’eau ou du canal d’amenée ».
La Cour de cassation se situe dans la même veine : dans l’arrêt « Fédération du Puy-de-Dôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique », elle valide l’analyse des premières juridictions concernant la détermination de la consistance du droit : l’expert s’est principalement fondé sur « la hauteur de chute du moulin relevée par l’état statistique des usines sur cours d’eau de 1863, document le plus proche de 1789 » ainsi que sur un arrêté préfectoral du 9 mai 1906 autorisant le rehaussement du barrage voisin et précisant qu’il était possible d’y procéder « sans nuire à la marche de l’usine supérieure ». La confrontation de ces données à celles de la Société civile immobilière propriétaire du barrage devait permettre de conclure à une hauteur autorisée de barrage fondée en titre plus modeste que celle alléguée par la SCI, solution que retient la Cour de cassation, dès lors que la Cour d’appel a déterminé souverainement la consistance légale de l’usine « suivant les méthodes d’évaluation et les éléments d’appréciation qui lui sont apparus les plus appropriés ». Si l’on se rapproche de l’arrêt « SA Laprade Énergie », toute modification de ce droit est soumise « au droit commun des installations hydrauliques », impliquant une autorisation administrative préalable, pour autant que les caractéristiques du cours d’eau permettent de l’accorder.
La détermination de la consistance du droit fondé en titre relève donc de l’appréciation souveraine des juridictions du fond (Cass. civ. 3e, 8 février 2006, SCI du Batifort, Bull. civ. III no 31). S’agissant d’un moulin installé sur une rivière, cette appréciation prend en compte son état avant travaux pour déterminer toute modification éventuelle (CE 25 mai 1990, Mayrac, no 62978 ; CE 19 décembre 1994, min de l’environnement, no 105165).
Également à propos de l’affaire du « Moulin de Batifort » constituée d’un barrage construit sur la rivière La Couze-Chambon, servant à la production d’électricité et qui a donné lieu à de nombreuses jurisprudences. L’affaire est d’importance, car en application de l’article 29 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, maintenant codifié à l’article L. 511-4 du Code de l’énergie, les établissements bénéficiant d’un droit fondé en titre, installés sur les rivières, sont dispensés de toute autorisation administrative préalable, sauf le droit de l’administration de leur imposer des mesures indispensables pour éviter les inondations (CE 9 juin 1937, Loury, Rec. p. 575).
Ainsi, à partir d’états statistiques sur les barrages et sur les cours d’eau remontant à différentes périodes, soit les années 1862, 1863, 1890, 1906, 1924, 1946 et 1991, l’expert judiciaire dont les conclusions ont été reprises par l’arrêt du 22 mai 2003 de la cour d’appel de Riom, a fixé à 454,36 m la hauteur de l’ouvrage autorisée par le droit fondé en titre, celle-ci résultant des relevés les plus anciens, effectués en 1862, 1863 et 1890. La Cour administrative d’appel de Lyon, pour sa part, en s’appuyant sur un schéma établi par les Ponts et chaussées en 1906, a jugé que la hauteur autorisée par le droit fondé en titre, en tenant compte du solde de la chute non utilisée sous la roue du moulin, s’établissait à 455,10 mètres, ce qui correspond à la hauteur actuelle du barrage, d’où sa décision de n’ordonner aucun arasement.
La SCI du Batifort fait valoir que doit être retenue l’analyse de la Cour administrative d’appel de Lyon, suivant laquelle il ne ressort ni des pièces du dossier ni du rapport d’expertise judiciaire que la consistance de l’ouvrage aurait été modifiée, de sorte que l’obligation d’abaissement du seuil du barrage à la cote de 454,36 mètres n’était pas justifiée.
On observera cependant que pour arrêter la hauteur du barrage à cette cote, la Cour d’appel s’est appuyée sur les mesures, rappelées par l’expert judiciaire, prises en 1862, 1863 et 1890, soit les 4 dates les plus proches de la période à laquelle remonte le droit fondé en titre, antérieures au 4 août 1789. On ne voit pas dès lors ce qui justifie de retenir les mesures remontant à une date plus récente, calculées au vingtième siècle, quand bien même les chiffres de 1906 intégreraient une donnée qui n’apparaît pas dans les états antérieurs (solde de la chute d’eau sous le moulin).
Il s’ensuit que la cour d’appel de Riom a fixé à bon droit la hauteur du barrage, déterminant la consistance du droit fondé en titre, à 454,36 mètres, sans qu’il soit besoin d’envisager une nouvelle expertise, qui ne serait pas de nature à modifier les informations déjà recueillies sur la période la plus ancienne.
III. Modifications
La consistance légale du droit caractérise la force motrice à laquelle l’usinier a droit : il peut effectuer tous travaux utiles, en particulier pour rationaliser l’utilisation de cette force motrice, mais il ne peut pas augmenter la consistance légale de son installation. Autrement dit, il ne peut pas dépasser le niveau maximum de débit d’eau auquel il a droit ni, de ce fait, accroître la force motrice théoriquement disponible, appréciée au regard de la hauteur de la chute d’eau et du débit du cours d’eau ou du canal d’amenée. Ce qui lui autorise la réalisation de travaux comme notamment le rétablissement d’une digue à la hauteur légale fondée en titre (sans surélévation). À défaut, il ne peut pas se prévaloir d’un droit fondé en titre.
De fait, si le bénéficiaire d’un droit fondé en titre peut faire effectuer tous les travaux qu’il juge utile pour améliorer l’usage qu’il tire de la force motrice d’un barrage, il ne peut sans autorisation, procéder à des transformations visant à augmenter sa consistance légale (arrêt SA Laprade précité). Au cas de modification substantielle ayant pour effet d’augmenter cette consistance, le propriétaire de l’installation ne saurait exciper d’un droit fondé en titre pour s’opposer à la mise en demeure du préfet de procéder à des aménagements (CE 18 janvier 1999, M. Tampon, no149174).
Le juge administratif considère que n’a pas à être soumise au régime de l’autorisation ou de la concession fixé par la loi du 16 octobre 1919, l’usine qui a amélioré son rendement par la mise à profit de progrès techniques sans pour autant accroître la force motrice dont elle pouvait légalement disposer7.
Cette solution a même été étendue aux hypothèses où les aménagements réalisés affectent non pas l’outillage intérieur, mais les ouvrages extérieurs du moulin8.
Ensuite, si une entreprise a été au-delà de sa consistance légale et se voit désormais soumise à la législation de 1919, ladite consistance n’est pas pour autant frappée de caducité. De fait, les droits fondés en titre ne s’inclinent pas complètement devant le régime légal et doivent, à l’inverse, se combiner avec celui-ci.
C’est ainsi que, de manière classique, le juge administratif considère que la consistance légale procédant du titre fondateur doit être déduite de la puissance motrice globale pour déterminer si l’entreprise est soumise au régime de la concession ou de la déclaration9.
A contrario, il faut admettre qu’un retour à la consistance légale d’une usine permettra à cette dernière d’échapper à nouveau au régime de la loi du 16 octobre 1919.
IV. Perte des droits
Le droit fondé en titre ne se perd pas par non-usage, dès lors qu’il n’est pas démontré que la force motrice de l’ouvrage ne serait plus encore susceptible d’être utilisée par son détenteur.
De nombreuses prises d’eau ont, en effet, été réactivées après une longue période d’inactivité tant à des fins d’agrément que pour des motifs économiques.
L’administration comme les utilisateurs de l’eau se sont donc trouvés confrontés à des propriétaires remettant en eau des ouvrages inutilisés depuis plusieurs décennies et souvent dans des états proches de la ruine.
Les litiges n’ont pas manqué de naître, l’administration ayant parfois tendance à arguer de la caducité des droits fondés en titre du fait de leur non-utilisation prolongée. La doctrine administrative a même été validée par certains juges du fond10.
Tel n’est toutefois pas l’avis des juridictions suprêmes.
Par trois arrêts récents et successifs, le Conseil d’État a rappelé que « ni la circonstance que ces ouvrages (hydrauliques) n’aient pas été utilisés en tant que tels au cours d’une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit de prise d’eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls à remettre en cause la pérennité de ce droit »11.
La Cour de cassation n’est pas d’un autre avis lorsqu’elle estime que la perte d’un droit d’usage d’eau ne se présume pas du non-usage de celui-ci tant que les propriétaires n’ont pas expressément renoncé à l’exploitation d’un moulin12.
Elle rappelle en la matière que « la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction de son titulaire et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer »13.
Néanmoins, prévient le Conseil d’État dans ses arrêts précités, la force motrice produite par les eaux courantes ne peut faire l’objet que d’un droit d’usage et en aucun cas d’un droit de propriété. Il en résulte, pour la Haute Juridiction, qu’un « droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d’eau ».
Là encore, le juge administratif, en dépit des termes de sa jurisprudence, est plus bienveillant qu’il n’y paraît à l’égard des usiniers.
D’une part, ainsi qu’évoqué précédemment, l’état de délabrement des bâtiments est indifférent, seul l’état des ouvrages et la restitution de l’eau étant pris en considération.
D’autre part, le juge administratif n’exige nullement que les biefs, canaux et autres digues soient en état de fonctionner.
Il apprécie, en fait, si « la force motrice de l’ouvrage subsiste pour l’essentiel ».
Il en découle que, sans que cela n’affecte le titre dont peut se prévaloir l’usinier, des digues pourront être partiellement détruites, des canaux obstrués ou envahis par la végétation (Aff. Laprade), des étangs asséchés et encombrés de débris (Aff. Sablé) ou des ouvrages partiellement délabrés (Aff. Arriau).
Ce n’est donc que si la remise en état des ouvrages hydrauliques suppose des travaux considérables quasiment équivalents à une reconstruction que le juge estimera que le droit fondé en titre sera perdu.
Pour prétendre bénéficier d’un droit fondé en titre, l’usinier devra, en outre, démontrer qu’il n’a pas modifié la consistance légale de la prise d’eau, c’est-à-dire, qu’il n’a pas accru le volume d’eau octroyé à l’origine.
V. Éviction et conséquences indemnitaires
La jurisprudence civile comme administrative est concordante pour admettre que la force motrice produite par l’écoulement d’eaux courantes ne peut pas faire d’un droit de propriété et ne fait l’objet que d’un droit d’usage. Il ne s’agit donc que d’un droit réel immobilier, attaché au fonds, ce qui implique qu’en cas d’expropriation du fonds, l’usinier n’a pas de droit à une indemnité distincte de celle à laquelle il avait déjà droit pour l’expropriation totale du fonds.
L’intérêt de la détermination de la nature du droit est donc principalement indemnitaire, en cas d’éviction.
Il faut distinguer à ce titre les cours d’eau domaniaux des cours d’eau non domaniaux :
- Cours d’eau domaniaux : selon l’article L. 2124-9 Code général de la propriété des personnes publiques, « Les prises d’eau mentionnées à l’article L. 2124-8 et autres établissements créés sur le domaine public fluvial, même avec autorisation, peuvent toujours être modifiés ou supprimés. Une indemnité n’est due que lorsque les prises d’eau ou établissements dont la modification ou la suppression est ordonnée ont une existence légale ».
Toutefois, il n’y a pas droit à indemnité lorsque – notamment – les mesures sont prises pour éviter les inondations.
- Cours d’eau non domaniaux : selon l’article L. 215-10-I du Code de l’environnement,
- Les autorisations ou permissions accordées pour l’établissement d’ouvrages ou d’usines sur les cours d’eau non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants : (…)
- Dans l’intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette révocation ou cette modification est nécessaire à l’alimentation en eau potable de centres habités ou en est la conséquence ;
- Pour prévenir ou faire cesser les inondations ;
- Dans les cas de la réglementation générale prévue à l’article L. 215-8 [Le régime général de ces cours d’eau est fixé, s’il y a lieu, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d’utilisateurs de leurs eaux avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis, après enquête d’utilité publique, par arrêté du ministre dont relève le cours d’eau ou la section du cours d’eau] ;
- Les dispositions du I et du I bis sont applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu des articles L. 214-1 à L. 214-6, ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu’aux établissements ayant une existence légale et aux entreprises concédées ou autorisées en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique. Les modifications apportées en application du I bis du présent article aux concessions visées par la loi du 16 octobre 1919 précitée n’ouvrent droit à indemnité que si elles entraînent un bouleversement de l’équilibre économique du contrat (…).
Ce dispositif s’applique aux établissements fondés en titre (CE, 11 octobre 1985, Lemoine : CJEG 1986, p. 401, note Pilate) et le préfet peut valablement limiter ou supprimer les droits du titulaire « pour un motif d’intérêt général, et notamment pour prévenir les crues en amont de l’installation » (CAA Douai, 26 mars 2009, Sté centrale de Flavigny-le-Grand, req. n° 07DA01281 – CAA Nancy, 3 mars 2005, Sté Azimut, req. n° 00NC01263).
Les moulins fondés en titre ont donc ici une situation préférentielle puisque seule leur catégorie bénéficiera d’une indemnisation en cas de modification ou de suppression de leur prise d’eau, et ce, quel qu’en soit le motif.
Sujétions nouvelles
De manière traditionnelle, la jurisprudence administrative a toujours considéré que « l’administration a le droit de régler dans un but d’utilité générale et pour assurer le libre écoulement des eaux, le régime des Moulins établis sur les rivières et (que) ce droit s’applique aussi bien aux Moulins établis avant 1789 qu’à ceux dont l’établissement est postérieur à cette date »14.
Le législateur a, ensuite, pris le relais pour confirmer que les droits fondés en titre ne réduisaient pas à néant les pouvoirs de l’administration en charge de l’intérêt général.
C’est ainsi que l’article L. 215-7 du Code de l’environnement relève que « l’autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d’eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux. Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés ».
Dans le même sens, l’article L. 215-8 du Code de l’environnement précise que « le régime général de ces cours d’eau est fixé, s’il y a lieu, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d’utilisateurs de leurs eaux avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis, après enquête d’utilité publique, par arrêté du ministre dont relève le cours d’eau ou la section du cours d’eau ».
Par ailleurs, l’article L. 2132-6 CG3P, tel qu’il est issu de l’article 27 du Code du domaine public fluvial, signale que « nul ne peut construire ou laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l’écoulement des eaux ou à la navigation sous peine de démolition des ouvrages établis ou, à défaut, de paiement des frais de la démolition d’office par l’autorité administrative compétente ».
C’est, sur ces fondements, que le juge administratif a pu considérer qu’était légale la décision n’autorisant la remise en état d’une usine fondée en titre qu’à la condition que la hauteur du barrage soit abaissée d’un mètre afin de prévenir les inondations15 alors même que, hors cette hypothèse, le barrage aurait pu, semble-t-il, être reconstruit sans autorisation.
De même, sera légal l’arrêté prescrivant la suppression d’un vannage sur un moulin fondé en titre au motif que les débris du bief faisaient obstacle au libre cours des eaux en période de crues16.
La préservation du milieu aquatique fait, pour sa part, l’objet de dispositions spécifiques susceptibles d’avoir des retentissements sur l’exploitation des usines fondées en titre et le juge administratif estime, de manière générale, que « les règles applicables à l’exploitation (des) ouvrages (hydrauliques) sont susceptibles d’être changées à tout moment pour la sauvegarde d’intérêts propres au domaine qu’ils occupent, au nombre desquels figure la protection du milieu naturel »17.
Ainsi, l’article L. 214-18 du Code de l’environnement précise que « tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite ». Cette obligation, conformément au § 4 de la même disposition, pèse de la même façon sur les installations en activité au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2006.
Dans le même sens, et de manière générale, l’article L. 432-6 du Code de l’environnement, à la suite de l’article L. 214-17 du même Code, impose que « dans les cours d’eau ou parties de cours d’eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. L’exploitant de l’ouvrage est tenu d’assurer le fonctionnement et l’entretien de ces dispositifs (…) »18.
Sur ces fondements, le juge administratif affirme ainsi sans nuance que « dans l’exercice de ses pouvoirs de police de l’eau, l’État peut imposer à l’exploitant de toute installation existante, y compris fondée en titre, des conditions destinées à préserver les milieux naturels aquatiques19 ».
Par ailleurs, l’article L. 215-10 I bis dispose que, à compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d’eau classés au titre du I de l’article L. 214-17, les autorisations ou permissions accordées pour l’établissement d’ouvrages ou d’usines peuvent être modifiées, sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que leur fonctionnement ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.
Cette disposition en vertu de l’article L. 215-10 II est expressément applicable aux établissements ayant une existence légale.
Enfin, indépendamment de l’exercice de pouvoirs inhérents à la police de l’eau, l’administration peut être amenée à modifier la force hydraulique d’une installation notamment en réalisant des ouvrages publics à proximité de cette dernière.
En ce cas, l’application du droit commun de la responsabilité administrative amènera la personne publique à indemniser l’usinier, soit sur le fondement de la responsabilité sans faute, lorsque la victime est un tiers par rapport à l’ouvrage20, soit sur le fondement de la responsabilité pour faute, lorsque l’ouvrage réalisé souffre d’un défaut d’entretien21.