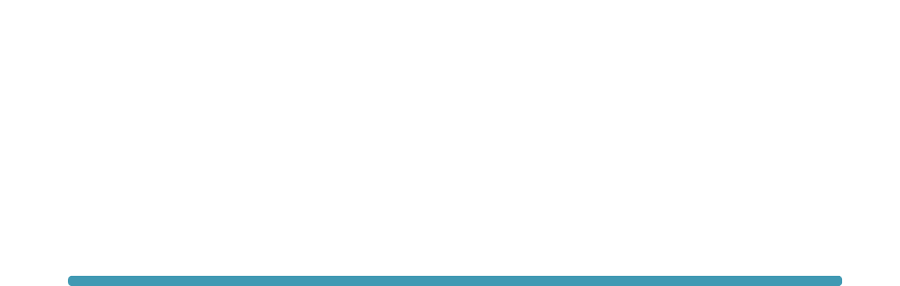Aujourd’hui nous portons la voix pour les silencieux que sont l’eau et les êtres qui la peuplent afin de sensibiliser ceux qui manient le verbe, les fonds publics, les pouvoirs publics, l’autorité administrative et judiciaire, à œuvrer pour une justice pour l’eau.
Le droit pénal de l’environnement est un droit jeune issu d’une prise de conscience nouvelle qui a connu des balbutiements. Il a pris de l’importance considérable depuis ces dernières années. Des sanctions sont prises par le droit pénal de l’environnement, et notamment pour les atteintes à l’eau et aux êtres qui la peuplent. On commence peut-être à voir sacraliser le principe de la délinquance de l’eau, même si le scepticisme reste de rigueur. C’est un droit qui a sa propre particularité, sa propre autonomie.
La répression pénale existe, mais, dans la pratique, son application est demeurée longtemps défaillante. Il suffit pour cela de faire le ratio entre les constatations d’atteinte au droit de l’environnement et les poursuites effectives qui s’en suivent. Les statistiques démontrent que le taux de poursuite est très faible. « Les peines sont constantes dans leur faiblesse » avec aucun effet vraiment coercitif et dissuasif, surtout en présence souvent de personnes morales puissantes avec une capacité à créer des emplois et faire vivre des familles dans des territoires hexagonaux reculés. Je pense aux grands groupes industriels, comme les industries pharmaceutiques par exemple. Le chantage économique induit presque pour certains un droit à la pollution.
Ce qui est sûr, c’est que le droit pénal de l’environnement est aujourd’hui mieux armé.
I. Le cadre du droit pénal de l’eau
Cet arsenal juridique pour faire face aux atteintes à l’eau s’articule autour d’un triptyque, en l’occurrence : L. 432-2, L. 216-6, et L. 218-73 du Code de l’environnement.
La pollution des eaux douces trouve son origine répressive en France en 1829, avec une répression limitée aux braconniers pour devenir plus générale et toucher les délits de rejets notamment industriels. Cette tendance à la répression des rejets sera consacrée par une ordonnance de 1959, devenue l’article 434 du Code rural puis L. 232-2 du Code rural. Cette construction aboutira à l’article L. 432-2 du Code de l’environnement (2 ans et 18 000 euros d’amende).
Ce délit ne permettait pas d’appréhender toutes les formes de pollution des eaux ni certains dommages relatifs à la pêche en eaux douces ; exclusivement défini par l’atteinte aux intérêts piscicoles, il ne pouvait étendre ses effets aux nappes phréatiques.
Puis, s’opère l’extension vers l’harmonisation pour les eaux douces ou salées, superficielle ou souterraine, close ou libre domaniale ou non. L’article L. 432 - 2 est devenu une disposition phare du droit de l’environnement.
Un texte complémentaire a été créé en 1992 (loi) pour compléter l’article L. 432-2 du Code de l’environnement : l’article L. 216-6 du Code de l’environnement (2 ans et 75 000 euros d’amende), avec une plus grande acuité sur la peine par rapport à L. 432-2 du Code de l’environnement. Cet article consacre un délit plus large pour sanctionner les pollutions autres que celles nuisant aux poissons.
Un troisième texte existe même, qui est l’article L. 218-73 du Code de l’environnement, qui est à la faune marine ce que l’article L. 432-2 est au poisson d’eau douce.
Donc 3 délits possibles au visa de ces textes. Mais les peines encourues n’étaient pas les mêmes.
Le champ d’application de l’article L. 432-2 du Code de l’environnement est restreint aux cours d’eau et aux canaux dans la limite de salure des eaux ainsi qu’aux plans d’eau.
Le champ d’application de l’article L. 216-6 du Code de l’environnement inclut les dispositions de l’article L. 432-2, mais va bien au-delà puisqu’il embrasse les eaux souterraines aussi bien que superficielles et s’étend à la mer territoriale.
Ces 2 articles ont en commun la définition de rejet.
L’article L. 432-2 inclut non seulement la destruction des poissons, mais encore toute atteinte à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire. C’est-à-dire même quand il n’y a pas de destruction directe du poisson. C’est le cas des rejets, même si les produits en question ne sont pas intrinsèquement toxiques : résidus naturels, eau chauffée puis rejetée… (exemples : petits pois, sciure de bois…).
Le déversement n’a pas à être obligatoirement direct : épandage, boue, herbicides puis ruissellement…
Il n’est en principe pas nécessaire de caractériser l’élément moral, cela peut être un délit d’imprudence.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré qu’étaient non intentionnels les délits punis par les articles L432-2 et L216-6 du Code de l’environnement. Selon l’article 121-3 du Code pénal, il n’y a pas de délit sans intention, sauf qu’en matière environnementale des textes spéciaux consacrent les délits par imprudence ou négligence. Cependant avec la loi Fauchon du 10 juillet 2000 relative aux délits non intentionnels, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage ne sont pénalement responsables que si on démontre une faute délibérée ou caractérisée.
Autres causes d’exonération de responsabilité pénale :
- la contrainte, qui doit être irrésistible et imprévisible (caractéristiques de la force majeure) (incident mécanique, défaillance technique, ou aléas climatiques sauf que la jurisprudence ne les considère pas comme exonératoires) ;
- et le respect des normes administratives de rejet. Si l’article L. 432-2 n’attribue aucun caractère justificatif à l’observation des normes administratives de rejet, il n’en va pas de même de l’article L. 216 ‑6 qui prévoit une constitution du délit si les normes administratives n’ont pas été respectées.
L’article L. 216-6 est bien plus exonératoire à ce niveau-là et n’est pas un outil privilégié de défense des milieux aquatiques. L’article L. 216-6 est relatif à la pollution des eaux.
L’article L. 432-2 est relatif à la destruction des poissons et peu importe que les conditions d’autorisations administratives aient été respectées, il y aura sanction.
Ces délits restent une source jurisprudentielle féconde. Ces textes définissent et répriment, sans se fonder sur des définitions règlementées et administratives, ce qu’est une atteinte au droit de l’environnement. Mais ces articles sont limités au domaine de l’eau et de la pollution.
II. En pratique la prise en considération de la partie civile en la matière
Pour être efficace, il faut être crédible. La constitution de partie civile (articles 87 et 419 du CPP) doit intervenir pour des structures qui statutairement protègent, gèrent et concourent à des objectifs précis de protection de l’eau et du milieu aquatique. Il doit y avoir un objet social précis dans les statuts. Les statuts doivent avoir été approuvés en AG selon vote de ses adhérents.
J’entends par là qu’il faut et un intérêt et une qualité à agir au visa des articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code de l’environnement. Une association dont les statuts viseraient la protection de l’esturgeon n’a pas vocation à être très crédible si elle se constitue partie civile sur une pollution commise sur le Haut-Allier par exemple, zone emblématique de fraie des saumons de l’Atlantique où l’esturgeon n’évolue pas et y est même absent.
Il faut des associations agréées (par arrêté préfectoral) de protection de l’environnement, dont les statuts, la procédure d’agrément et les prérogatives sont définis par l’article L. 141-1 du Code de l’environnement (c’est-à-dire agréées et déclarées depuis au moins 5 ans à la date des faits). Ce sont souvent les AAPPMA (associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique), les fédérations de pêche et des associations locales très connues pour leur investissement s’agissant de la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. Il vaut mieux avoir des parties civiles fédérées, souvent face à des lobbies industriels et pharmaceutiques.
La plainte est généralement déposée contre X ou contre toute autre personne physique ou morale que l’enquête permette de déterminer, afin d’éviter un retour de boomerang : une plainte pour dénonciation calomnieuse ou en dénonciation de délit imaginaire. Simple en gendarmerie ou commissariat. Ou plainte au procureur de la République par LR/AR (compétent ratione loci).
En cas d’avis de classement sans suite, ou faute du Parquet d’avoir répondu après un délai de 3 mois malgré une relance par LR/AR : dépôt de plainte avec CPC au doyen des juges d’instruction, qui met en mouvement l’action publique afin d’obtenir l’ouverture d’information et accès au dossier à la partie civile par le canal de son avocat. L’inconvénient lors de cette phase est que le juge d’instruction sollicite une consignation qui peut être dissuasive pour des associations dont l’assise financière est précaire.
Le dossier peut faire l’objet d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. En cas d’ordonnance de non-lieu, un appel peut être interjeté dans les 10 jours et on se retrouve devant la chambre de l’instruction.
Quand la procédure pénale s’arrête au stade de l’instruction sans appel de l’ONL, on peut tenter sa chance devant le juge civil en indemnisation.
La procédure de la citation directe par acte d’huissier est envisageable, mais souvent très glissante, car on boycotte le JI et le Parquet qui peut requérir une relaxe à l’audience à l’encontre du prévenu. C’est une solution envisageable lorsque l’on a un dossier solide, mais ce n’est jamais le cas en pratique.
III. S’agissant de la réparation des préjudices
La première difficulté est de quantifier le préjudice. Ceci est souvent difficile, mais les données sont indispensables (prélèvements macro benthos avec protocole d’échantillonnage, pêches électriques…). D’autant qu’il faut quantifier le préjudice avec une certaine urgence et instantanéité. Il y a sinon difficulté de démontrer l’impact… surtout quand les eaux sont vives et que les preuves filent au fil du courant de nos rivières…
Il est nécessaire de faire des relevés directement après la pollution : ONEMA (Office national de l’eau et du milieu aquatique) (rapports de constatation), DREAL (Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement), qui sont des établissements chargés de mission de police de l’eau et de la nature avec des rapports et des PV.
En premier lieu, la remise en état doit être recherchée quand celle-ci est possible et nonobstant les mortalités piscicoles qui ont pu être générées (qui seront indemnisées). Sur l’action publique devant le tribunal correctionnel, un ajournement avec injonction de remettre en état est coercitif, mais très pédagogique.
Les décisions de justice sont publiées par voie de presse.
La réparation des conséquences dommageables de la pollution : préjudice matériel, préjudice économique, préjudice piscicole : perte de truites farios, déterminée selon la productivité du système aquatique considéré selon la formule dite de « Leger, Huet et Arrignon », en tenant compte de la longueur du cours d’eau dégradé en totalité ou partiellement.
Le préjudice écologique consacré par une loi de 2016 sur la biodiversité, en faisant son apparition dans le Code civil (article 1386-19 et suivants du Code civil), déjà reconnu dès 2012 par la jurisprudence, mais ne reconnaissant pas le préjudice écologique pur, est également indemnisable, distinct du préjudice personnel. Il s’entend par l’atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices tirés par l’homme de l’environnement. Ce préjudice reconnaît à la nature une valeur à elle toute seule.
L’action en responsabilité liée au préjudice écologique se prescrit par 10 ans (article 2226-1 du Code civil) à compter de la connaissance de la manifestation du préjudice. Délai de prescription de 6 ans (3 ans avant) pour les délits (Loi du 27 février 2017), mais maintien du délai de 1 an pour les contraventions ; sinon délai spécial du droit de l’environnement de 30 ans (en matière civile).
Il se définit comme l’atteinte directe portée à l’environnement et découlant de l’infraction qui lui confère un caractère autonome original en rapportant la preuve de l’atteinte et du décès de nombreux animaux. Ce préjudice s’entend par une remise en état (c’est-à-dire une réparation en nature, c’est-à-dire une restauration du milieu écologique endommagé) ; si cela est impossible ou partiellement impossible, il y a indemnisation. Il appartient au juge du fond d’évaluer lui-même ce préjudice écologique (Cass. Crim. 22.03.2016) (Arrêt de référence en matière de préjudice écologique). Ils doivent suppléer à la carence des Parties pour l’évaluer, en ayant recours à une mesure d’instruction, par exemple en désignant un expert qui sera chargé de la quantifier, ce qui est d’autant plus difficile en l’absence de nomenclature précise, comme DINTHILHAC en matière de préjudice corporel par exemple.
Les méthodes d’évaluation du dommage écologique subi sont basées sur le principe de l’équivalence dans le sens où les ressources restaurées doivent être du même type, de la même qualité et de la même quantité que les pertes subies :
- les méthodes d’évaluations HEA (Habitat equivalency analysis) et REA (Ressource equivalency analysis) sont basées sur l’identification d’un proxy qui est un indicateur écologique ou biologique représentatif du milieu endommagé, en calculant les pertes enregistrées pendant toute la durée d’impact du dommage.
Calcul technique et complexe basé sur un recueil de données sur le terrain très fastidieux ;
- la méthode d’évaluation biophysique qui est élaborée par le ministère : cette méthode se subdivise de manière bicéphale, l’une simple pour les dommages de moindre gravité, l’autre plus complexe pour les dommages graves. L’inconvénient reste le coût.
Conclusions
L’enjeu majeur aujourd’hui est la reconquête de l’environnement, et notamment de la qualité des eaux. Il s’agit effectivement d’un enjeu majeur même au plan régional et qui plus est en région Auvergne, château d’eau de la France, où la nature préservée est le principal attrait.
C’est un droit qui doit fédérer. Cela passe par une entente des associations de la protection de l’environnement entre elles. Les magistrats ne sont pas toujours réceptifs au droit de l’environnement, ce que l’on peut comprendre, ils ne peuvent pas faire preuve de la même acuité pour un auteur d’infraction à la législation des stupéfiants et un braconnier de grenouilles en période de reproduction.
Les orientations de la politique pénale en matière d’atteinte à l’environnement doivent s’intensifier. Il faut une collaboration entre Parquets, administrations et associations de protection de l’environnement. « La police administrative sans la menace d’une sanction pénale est une infirme », disait Michel Thenault, conseiller d’État et ancien Préfet de Région. Par exemple, la désignation de magistrats référents pour le contentieux droit de l’environnement dans les Parquets et Parquets généraux.
Il est nécessaire de développer les partenariats pour que tout le monde soit sensibilisé pour cette cause qui doit être commune. Les TIG par exemple pourraient être consacrés à la remise en état du milieu, la dépollution, le nettoyage des rivières… Le message passe par l’éducation et la formation… mais il faudrait une tendance générale à la pénalisation et à la réparation en nature des milieux. Actuellement, les indemnisations allouées par les juridictions sont faméliques.